Philosophie – Fiches de lecture
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Fiche de lecture n° 30-1
Eléments contextuels
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est un penseur (ou un philosophe par hasard, selon Helvétius ?) du siècle des Lumières. Il présente lui-même ce qui constitue sa philosophie (L. Jaffro, M. Labrune) : le Discours sur les sciences et les arts ; le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ; et l’Émile ou De l’éducation. Le Contrat social se retrouve dans le Second Discours [l’inégalité] et au livre V de l’Émile.
Le Contrat social est l’aboutissement du projet d’un ouvrage sur les institutions politiques, restreint finalement aux Principes du droit politique, sous-titre du Contrat social. Rousseau initie ce projet en 1742, alors qu’il est secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise. Le Contrat social est publié en 1762.
Synthèse globale
Dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau décrit le passage de l’homme de l’état de nature à celui de l’état sauvage, puis à un état civil, premier état social où l’homme demeure soumis à des lois, des conventions, qui ne font qu’augmenter les inégalités. Il faut trouver une forme de convention qui combine les avantages de l’état naturel à ceux de l’état social, en garantissant liberté et égalité : c’est le “Contrat social”.
La structure de l’ouvrage se fonde sur un ordre des raisons qui est le plan de l’État (Commentaire du Contrat social, p. 60) :
- Fondement de l’État : ce qui a précédé (les premières sociétés, le “droit” du plus fort, l’esclavage), le pacte social, le principe de souveraineté, les lois, la théorie du peuple, la liberté et l’égalité, l’universalité de la pensée politique ;
- Le gouvernement de l’État : les formes de gouvernement, les suffrages et les élections, la politique et la religion.
Livres I et II – Livres III et IV
Livres I et II – Plan- Synthèse – Extraits
La pagination renvoie à l’édition du Contrat social dans la collection “Les Classiques de la Philosophie”, Le Livre de Poche. Les notes numérotées sont celles de cette même édition.
Avertissement
Rousseau indique que le Contrat social est une partie de son projet de traité sur les institutions politiques, “abandonné depuis longtemps.” C’est le morceau “le plus considérable” et “le moins indigne”. “Le reste n’est déjà plus.”
Livre I
Il débute par l’exposé de la légitimité de Rousseau pour rédiger ces “principes du droit politique » :
On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. p. 67.
Chapitre I. Sujet de ce premier livre
L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. p. 68.
[…] tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug, et qu’il le secoue, il fait mieux ; car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter. Ibid.
Il faut distinguer la force de la contrainte. L’ordre social comme droit n’est pas naturel, mais basé sur des conventions.
Chapitre II. Des premières sociétés
La famille est le modèle de société politique le plus ancien et le seul naturel : “le chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants”.
Rousseau évoque Grotius, Hobbes, et rapporte la conception d’Aristote sur l’esclavage :
Tout homme né dans l’esclavage naît pour l’esclavage, ren n’est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu’au désir d’en sortir : ils aiment leur servitude […]. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. p. 70.
[Voir aussi la fiche de lecture : La Boétie, Discours de la servitude volontaire.]
Chapitre III. Du droit du plus fort
Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir. […] Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? p. 71.
La force est une violence non légitime, non fondée en droit comme peut l’être la puissance ou le pouvoir (note n° 7, p. 267).
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. p. 72.
Chapitre IV. De l’esclavage
L’autorité d’un homme sur un autre n’est pas naturelle. C’est par convention qu’une autorité devient légitime.
Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable, un tel acte est illégal et nul […]. Dire la même chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous ; la folie ne fait pas droit. p. 73.
Les hommes naissent libres, nul n’a le droit de disposer de leur liberté (voir la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). Un père ne peut pas aliéner ses enfants.
Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. […] Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. pp. 73-74.
Comme la force peut être contraire au droit, les termes “esclavage” et “droit” sont incompatibles.
Chapitre V. Qu’il faut toujours remonter à une première convention
Rousseau oppose l’agrégation (la soumission de la multitude à une seule force unique) et l’association (“l’unité résultant du concours de volontés libres”, L. Jaffro, p. 665). Il faut distinguer le troupeau du peuple.
Avant donc que d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant nécessairement antérieur à l’autre est le vrai fondement de la société. p. 78.
Chapitre VI. Du pacte social
Le problème fondamental s’énonce ainsi :
“Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant.” p. 79.
Le pacte (ou contrat) social se résume en ces termes :
Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. p. 80.
Les volontés individuelles s’associent pour devenir la “volonté générale” d’un moi commun. Rousseau donne la définition de chaque terme du contrat :
- République ou corps politique : la personne publique (ou morale) formée par tous les membres associés et unis par cet acte d’association, notion synonyme d’État , de souverain, de puissance ;
- Peuple : nom collectif des associés, composé de citoyens (participants à l’autorité souveraine), terme synonyme de sujets (soumis aux lois de l’État).
Chapitre VII. Du souverain
Le pacte social est un engagement de chacun envers soi-même, obéissant à la volonté générale, en tant que citoyen, sujet, et membre du peuple souverain.
[…] quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie pas autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre […]. p. 83.
[A comparer à la phrase de Sartre : “l’homme est condamné à être libre” (fiche de lecture – Sartre, L’existentialisme est un humanisme).]
Chapitre VIII. De l’état civil
Rousseau reprend sa doctrine : l’homme passe de l’état de nature à l’état civil où apparaît la moralité et la notion de devoir.
Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. p. 84.
La liberté morale est la seule à rendre l’homme maître de lui-même, par l’obéissance à la loi qu’il s’est prescrite.
[A rapprocher de la notion de liberté chez Kant : “Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont […] une seule et même chose.” (Fondements de la métaphysique des mœurs, Cf. Bibliographie).]
Chapitre IX. Du domaine réel
Le “domaine réel” correspond au droit de propriété (note n° 20, p. 276).
Rousseau présente les conditions du droit de premier occupant :
- Que le terrain ne soit habité par personne ;
- “Qu’on en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister” ;
- Qu’on en prenne possession “par le travail et la culture”.
Rousseau fait ensuite une critique du colonialisme, notamment celui de la conquête espagnole de l’Amérique du Sud.
Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussitôt le maître ? Suffira-t-il d’avoir la force d’en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d’y jamais revenir ? Comment un homme ou un peuple peut-il s’emparer d’un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu’elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun ? p. 86.
[Voir aussi la critique de la colonisation par Kant dans Vers la paix perpétuelle (Cf. bibliographie).]
Le droit de propriété est toujours subordonné au droit de la communauté.
Rousseau termine le livre I par cette précision sur le contrat social :
[…] au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. p. 88.
Livre II
Chapitre I. Que la souveraineté est inaliénable
Je dis donc que la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même : le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. p. 89.
La volonté générale vise l’égalité collective, universelle ; elle est nécessairement unanime. Quand les volontés individuelles ne sont que des “préférences”. La volonté générale ne peut pas se donner “des chaînes pour l’avenir”. Ce serait le retour du droit du plus fort.
Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. p. 90.
Chapitre II. Que la volonté souveraine est indivisible
La souveraineté ne peut pas se diviser : la volonté générale est celle de tous (le “corps du peuple”). Si la volonté n’est que celle d’une partie du peuple, c’est une volonté particulière, “un décret tout au plus.”
Rousseau fait une analogie entre le corps politique et le corps humain. Les politiques tentent de diviser la souveraineté selon ce à quoi elle se rapporte : le pouvoir législatif ou exécutif, les impôts, la justice, l’intérieur, les affaires étrangères, etc.
Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus. […] Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques ; après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. p. 91.
Chapitre III. Si la volonté générale peut errer
La volonté générale “tend toujours à l’utilité publique”, mais le peuple peut se tromper dans ses délibérations ou être trompé.
On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. p. 93.
Chapitre IV. Des bornes du pouvoir souverain
L’État est une “personne morale” qui doit assurer sa conservation. Rousseau reprend l’analogie avec le corps humain : l’homme a un “pouvoir absolu sur tous ses membres”, la souveraineté a le même pouvoir, guidée par la volonté générale.
Le pacte social crée l’égalité de tous : tous ont les mêmes devoirs et les mêmes droits.
Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. p. 97.
Les individus disposent de leurs biens et de leur liberté. Lorsqu’une affaire est particulière, ce n’est pas le “souverain” qui s’en charge. La situation des associés du contrat est plus avantageuse que l’état naturel : leur liberté est protégée par l’État, là où ils devaient assurer eux-mêmes leur propre sécurité.
Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai ; mais aussi nul n’a jamais à combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui fait notre sûreté une partie des risques qu’il faudrait courir pour nous-mêmes sitôt qu’elle nous serait ôtée ? p. 99.
Chapitre V. Du droit de vie et de mort
La sécurité (ou sûreté) garantie par le pacte social donne au souverain un droit sur la vie des contractants, pour la conserver mais aussi pour défendre l’État.
Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. pp. 99-100.
Rousseau étend le droit de vie et de mort aux crimes, sans prôner la peine de mort systèmatique. Le criminel cesse d’être un citoyen pour devenir un ennemi de l’État, qui a rompu par ses actes le pacte social.
Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a le droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger. […] Dans un État bien gouverné il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de grâces, mais parce qu’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit. p. 101.
[A rapprocher de la notion socratique “Nul n’est méchant volontairement”, voir l’article Platon, Timée ou De la Nature – Les maladies de l’âme.]
Chapitre VI. De la loi
Par le pacte social nous avons donné l’existence au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. pp. 101-102.
Le contrat social crée le concept de peuple souverain, il faut maintenant le faire vivre. C’est la fonction de la loi.
Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi ? Tant qu’on se contentera de n’attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre et quand on aura dit ce que c’est qu’une loi de la nature on n’en saura pas mieux ce que c’est qu’une loi de l’État. p. 102.
La loi de l’État est un acte de la volonté générale où le peuple statue sur l’ensemble qu’il forme, c’est-à-dire sur une matière elle aussi générale.
La loi est ce qui donne vie à l’État, au corps social ; en ce sens, elle est la pensée du souverain : quand le peuple pense, sa pensée est loi. Note n° 28, p. 284.
La loi est universelle, dans la volonté qui la détermine, et dans l’objet dont elle traite. La loi est la pensée de l’universel.
[Cette universalité de la loi se retrouve chez Kant dans cette formulation de l’impératif catégorique : “Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle.” Cf. Fiche de lecture Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs.]
J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain […]. p. 104.
La forme du gouvernement peut être une démocratie, une aristocratie et même une monarchie, tant que c’est la volonté générale qui guide le gouvernement, celui-ci est républicain pour Rousseau.
Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le peuple soumis aux lois en doit être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société. p. 104.
Même si “la volonté générale est toujours droite”, il est nécessaire que le jugement du peuple soit guidé, éclairé : c’est le rôle du législateur.
Chapitre VII. Du législateur
Le législateur doit être d’une intelligence supérieure, vivre les passions humaines sans les éprouver, connaître la nature humaine sans en être, être heureux indépendamment du bonheur des hommes, etc.
Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. p. 106.
Le législateur est une fonction à part dans l’État : il commande aux lois mais il ne commande pas aux hommes. Mais il ne détient pas non plus le pouvoir législatif.
Celui qui rédige les lois n’a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif […] on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu’après l’avoir soumise aux suffrages libres du peuple. p. 108.
C’est la sagesse seule qui doit guider le législateur.
Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler à l’oreille, ou trouver d’autres moyens grossiers d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler au hasard une troupe d’insensés, mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra avec lui. pp. 109-110.
Chapitre VIII. Du peuple
Dans les chapitres VIII, IX et X, Rousseau esquisse “une théorie du peuple du point de vue du législateur” (note n° 33, p. 286). C’est ce que le législateur doit connaître d’un peuple pour rédiger ses lois.
La plupart des peuples, ainsi que des hommes, ne sont dociles que dans leur jeunesse ; ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont sont établies et les préjugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer ; le peuple ne peut même pas souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l’aspect du médecin. p. 111.
Selon Rousseau, certains peuples peuvent même ne jamais atteindre la maturité nécessaire pour qu’ils se soumettent à des lois. C’est le cas de la Russie des tsars, où la pensée de Rousseau se fait prémonitoire.
L’empire de Russie voudra subjuguer l’Europe et sera subjugué lui-même. Les Tartares, ses sujets ou ses voisins, deviendront ses maîtres et les nôtres. Cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l’Europe travaillent de concert à l’accélérer. p. 112.
Chapitre IX. Du peuple (suite)
Rousseau utilise à nouveau l’analogie : la Constitution d’un État est comme la conformation du corps humain, l’importance de sa taille est déterminante.
Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu’il ne saurait passer, et duquel souvent il s’éloigne à force de s’agrandir. Plus le lien social s’étend, plus il se relâche ; et en général un petit État est proportionnellement plus fort qu’un grand. p. 113.
Les dépenses d’administration augmentent à mesure que l’État s’agrandit. De multiples strates administratives “épuisent continuellement les sujets” et mènent l’État “à la veille de sa ruine.” L’application des lois et notamment des sanctions des abus est difficile. Le peuple est éloigné de ses chefs et la multitude du peuple peut créer une multitude de mœurs.
[…] le peuple a moins d’affection pour ses chefs qu’il ne voit jamais, pour la patrie qui à ses yeux est comme le monde et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. […] Les chefs accablés d’affaires ne voient rien en eux-mêmes, des commis gouvernent l’État. p. 114.
L’État ne doit pas non plus être trop petit, risquant d’être engloutis par des États plus grands “comme les tourbillons de Descartes”.
[Descartes explique ainsi le mouvement des astres par le truchement d’une hypothèse selon laquelle la matière du ciel où sont les planètes, tourne en rond sans cesse, telle un tourbillon qui aurait le Soleil à son centre, autour duquel les planètes tournent tout en tournant sur leur essieu. Élodie Cassan, Les tourbillons de Descartes.]
La conservation de l’État dépend plus de la force de sa Constitution et de son gouvernement que de la taille de son territoire.
Chapitre X. Du peuple (suite)
Un corps politique se mesure par sa géographie, sa démographie et le rapport entre les deux.
Ce sont les hommes qui font l’État, et c’est le terrain qui nourrit les hommes ; ce rapport est donc que la terre suffise à l’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d’habitants que la terre peut en nourrir. p. 116.
Ce rapport n’est pas fixe : il dépend de la nature des terres, du climat, de la “fécondité des femmes”. Rousseau décrit sa vision personnelle du monde qui lui est contemporain.
Ainsi l’on s’étendra beaucoup dans un pays de montagnes, où les productions naturelles, savoir les bois, pâturages, demandent moins de travail, où l’expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines […]. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer […] parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre, que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu’on a d’ailleurs plus de facilité pour délivrer le pays, par les colonies, des habitants dont il est surchargé. p. 117.
La dernière partie de la phrase concernant la colonisation est sans doute ironique (Cf. Chapitre IX. Du domaine réel).
La condition essentielle et indispensable pour instituer un peuple et un Etat est “qu’on jouisse de l’abondance et de la paix”. Hors de cette condition, l’État en crise risque d’être renversé.
Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de troubles pour faire passer, à la faveur de l’effroi public, les lois destructives que le peuple n’adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l’institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l’œuvre du législateur d’avec celle du tyran. pp. 117-118.
Rousseau décrit le peuple le plus adapté à la législation :
- Déjà lié par un début de convention sans avoir porté le “joug des lois” ;
- Sans coutumes trop anciennes ;
- Sans crainte d’être envahi ou de se quereller avec d’autres, et pouvant leur résister ;
- Où chacun peut être connu de tous et où les charges conférées sont supportables ;
- Indépendant, ni riche, ni pauvre, se suffisant à lui-même ;
- “Qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau.”
Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation, est moins ce qu’il fait établir que ce qu’il faut détruire ; et ce qui rend le succès si rare, c’est l’impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. p. 118.
Rousseau a une nouvelle prémonition sur l’avenir de l’Europe (Napoléon Bonaparte naîtra en 1769, sept ans après la publication du Contrat social).
Il est encore en Europe un pays capable de législation ; c’est l’île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J’ai quelque pressentiment qu’un jour cette petite île étonnera l’Europe. p. 119.
Chapitre XI. Des divers systèmes de législation
La finalité de toute législation est la liberté et l’égalité.
La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l’État ; l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. p. 119.
L’égalité n’est pas l’équivalence de la puissance ou de la richesse. Mais celles-ci ne doivent s’exercer que si elles sont légitimes.
[…] quant à la puissance, elle soit au-dessous de tout violence et ne s’exerce qu’en vertu du rang et des lois et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. p. 119.
Rousseau fait des recommandations de systèmes de législation et des orientations selon la situation du pays, toujours en lien avec la géographie et la démographie (Cf. Livre II, chapitre X) :
- Promouvoir l’industrie et l’art pour développer les échanges dans les pays aux terres peu fertiles ou trop peuplés ;
- Privilégier l’agriculture dans les pays peu peuplés aux terres fertiles ;
- Développer le commerce et la navigation dans les pays de rivages.
Il faut allier les caractéristiques naturelles du pays et ses lois (autrement dit la loi de la nature au droit). Rousseau exprime ici des préoccupations qui s’apparentent à l’écologie en tant que science sociale (“Études des relations réciproques entre l’homme et son environnement moral, social, économique” – cnrtl.fr).
Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît par la nature des choses, que l’un tende à la servitude et l’autre à la liberté, l’un aux richesses, l’autre à la population, l’un à la paix, l’autre aux conquêtes, on verra les lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et l’État ne cessera d’être agité jusqu’à ce qu’il soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire. p. 121.
Chapitre XII. Division des lois
La législation s’ordonne selon trois relations qui déterminent trois types de lois :
- Entre le souverain (le peuple en tant que corps politique) et l’État : les lois politiques ;
- Entre les citoyens : les lois civiles ;
- Entre l’individu et la loi : les lois criminelles.
Une quatrième forme de loi fait “la véritable constitution de l’État” : ce sont les mœurs, les coutumes et l’opinion. Seules les lois politiques sont l’objet du Contrat social.
Bibliographie
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Éd. Le Livre de Poche, Coll. Les Classiques de la Philosophie.
Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, PUF, Coll. “Quadrige”, pp. 1132-1142.
Élodie Cassan, Les tourbillons de Descartes.
Conseil constitutionnel, Présentation générale.
Laurent Jaffro, Monique Labrune, Gradus philosophique, GF Flammarion, pp. 661-667.
Legifrance, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Montesquieu, De l’esprit des lois.
Wikipédia – Jean Bodin, Les Six Livres de la République.
Voir aussi
Fiches de lecture :
- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social – 2. Du gouvernement de l’État (Livres III et IV) ;
- Fidel Castro, L’Histoire m’acquittera ;
- Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs ;
- Kant, Vers la paix perpétuelle ;
- La Boétie, Discours de la servitude volontaire ;
- Sartre, L’existentialisme est un humanisme ;
- Spinoza, L’Éthique : Livre III – De l’origine et de la nature des sentiments.
Note philosophique : Platon, Timée ou De la Nature – Les maladies de l’âme.
Dsirmtcom, octobre 2020.
Philosophie, Mardi c’est philosophie, Rousseau, Contrat social, Fiches de lecture, État, principe, politique, droit, société, souverain, liberté, égalité, loi, législation, législateur, peuple, citoyen, sujet, démocratie, aristocratie, monarchie, anarchie, ochlocratie, oligarchie, gouvernement, roi, prince, vertu, religion, esclavage, servitude, force, volonté, pouvoir, éthique, universel, particulier, Cité, Lumières, Machiavel, Montesquieu, Platon, Kant, Spinoza, Castro, La Boétie, Sartre, Descartes
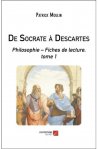

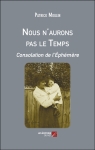


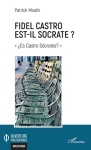
5 commentaires sur “FL – Rousseau, Du contrat social – 1. Du fondement de l’État (Livres I et II)”