Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Philosophie – Fiches de lecture
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Fiche de lecture n° 22
Eléments contextuels
Sartre est connu comme un philosophe du mouvement existentialiste. Les éléments fondamentaux de sa doctrine sont les suivants : “l’existence précède l’essence” ; l’homme est “condamné à être libre”, “C’est dans le néant seul qu’on peut dépasser l’être”. L’homme existe d’abord et il se définit après, l’homme est condamné à inventer l’homme en néantisant son passé, il est libre de se choisir.
L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie. Sartre, L’existentialisme est un humanisme.
Livre inachevé de Sartre, composé de deux parties (Ouragan sur le sucre et Ouragan sur le sucre II (appendice). Sartre vient de terminer la Critique de la raison dialectique. Ouragan sur le sucre reprend les réflexions de Sartre à la suite de ses voyages à Cuba en 1949 et en 1960.
L’indépendance de Cuba a été proclamée en 1902, après quatre siècles de colonisation par l’Espagne. En 1949, l’île est sous un régime considéré comme démocratique. La libération de Cuba suite à la révolution menée par Fidel Castro a lieu le 1er janvier 1959.
Synthèse globale
Le premier voyage cubain de Sartre commence à Santiago de Cuba en 1949, après avoir visité Haïti. Sartre donne une première synthèse de l’histoire cubaine, d’abord sous colonisation espagnole, puis sous dépendance étatsunienne. Le pays a pour monopole le sucre et le tabac. Il se rend ensuite à La Havane, capitale de Cuba. Sartre décrit le régime politique cubain, alternant démocratie et tyrannie.
Le deuxième voyage de Sartre a Cuba a lieu en 1960. Il est invité par Carlos Franqui, directeur du journal organe de la Révolution, qui vient de triompher le 1er janvier 1959, à se rendre compte par lui-même sur place de ce qu’est le régime de Fidel Castro.
Sartre présente Fidel Castro, celui qui, dès sa jeunesse, est en puissance l’incarnation du peuple en personne. Il résume son parcours de l’individu jusqu’à l’incarnation de la totalité du peuple souverain.
Il compare le chemin et la transformation accomplie par Fidel Castro à ceux de Jean de la Croix, religieux mystique espagnol , qui a écrit : “Pour arriver à être tout, veillez à n’être rien en rien”.
Selon Sartre, il ne peut pas y avoir de Terreur avec Castro. La Terreur implique l’affrontement d’une partie du peuple contre une autre, et donc la fin de la totalité incarnée Par Castro.
Sartre voit en Castro une double personnalité : le dirigeant de Cuba et son propre agitateur ; docteur Castro et Fidel l’activiste. Castro utilise la télévision pour communiquer largement, et se déplace lui-même pour avoir un contact direct avec les Cubains.
L’histoire d’Huber Matos, ancien compagnon de révolution de Castro, devenu commandant d’une garnison, illustre la double personnalité de Castro. Huber Matos, en désaccord avec la politique du mouvement castriste, est soupçonné de mener une insurrection dans sa caserne. Le “docteur Castro”, dirigeant de Cuba, fait un discours télévisé, puis, Fidel l’activiste se rend sur place pour éviter une intervention par la force. Après avoir échangé avec la foule présente, il réussit à mettre fin à l’insurrection et fait arrêter Matos, qui est condamné à vingt ans de prison.
Sartre termine ce texte par un nouveau portrait de Castro, le déclencheur de la Révolution, celui qui n’a jamais supporté l’injustice. En prenant “l’intérim” du peuple, Castro a sacrifié l’individu qu’il était. Il incarne le peuple souverain, mais il est devenu “une abstraction bardée de privilèges”.
Plan du texte, synthèse et extraits
La pagination des citations renvoie à l’édition citée en bibliographie.
I. 1949
La “question noire”
Lors de son voyage en 1949, le questionnement de Sartre sur Cuba est orienté vers la “question noire”, autrement dit le racisme. Il compare Cuba à Haïti, la “perle noire des Caraïbes”, qu’il vient de visiter.
En Haïti, je m’oubliais, j’avais une fausse innocence : j’eus le tort de vouloir conserver en moi, par fidélité, l’animosité de l’île noire [Haïti] contre l’île blanche [Cuba] et de contempler Santiago à travers Port-au-Prince et ses lunettes de verre fumées. p. 157.
Il arrive à Santiago de Cuba, la seconde ville du pays après sa capitale, La Havane. Après quelques années passées sous la dictature de Gerardo Machado, l’île est alors une République, qui redeviendra une dictature après le coup d’État de Fulgencio Batista, le 10 mars 1952.
A Santiago, Sartre découvre un “grouillement d’hommes et de couleurs”. La chemise portée par tous – hommes de toutes couleurs de peau – est la “Guayabera”, de couleur blanche et dotée de grandes poches, utilisée à l’origine par les cueilleurs de goyaves (“guayaba” en espagnol). On répond à Sartre que l’unité des noirs et des blancs se fonde sur la lutte pour l’indépendance et contre le pays colonisateur qu’est l’Espagne.
Éléments d’histoire
Note : certaines précisions historiques, indiquées ici et dans la suite de cette fiche de lecture, ne sont pas mentionnées par Sartre, et proviennent d’autres sources (voir bibliographie).
Christophe Colomb débarque à Cuba le 28 octobre 1492. A partir de 1510, Diego Velazquez annexe Cuba au nom du royaume d’Espagne et comme sa conquête. Il introduit également la canne à sucre. Les indiens autochtones de l’île sont en partie massacrés ou utilisés comme main d’oeuvre. Le chef indien Hatuey, considéré comme le premier rebelle d’Amérique du Sud, est fait prisonnier assassiné, brûlé sur un bûcher en 1512, par les Espagnols. Ceux-ci pratiquent ensuite la traite d’esclaves noirs, pour compenser la disparition des indiens indigènes. L’Espagne règne sur Cuba en ayant le monopole du sucre – produit par la culture de la canne à sucre – et du tabac. Au XVIIIe siècle, les “vegueros”, des planteurs de tabac, se révoltèrent en vain contre le monopole espagnol (voir l’article du site cubania.com, Le long voyage du tabac).
[…] le créole était né : on nomme ainsi les blancs de sang pur, dont la famille vient d’Europe mais dont les intérêts s’opposent à ceux de la patrie d’outre-mer. C’est le sucre et le tabac qui prirent d’anciens Espagnols et les transformèrent en Cubains. p. 159.
Au XIXe siècle, la possession de l’île a été source de conflit entre l’Espagne et les États-Unis. Ces derniers intéressaient particulièrement les partisans cubains de l’esclavagisme.
[…] les États-Unis présentaient alors le double et surprenant avantage d’être le modèle des démocraties et de conserver, dans le Sud, l’esclavage. Pour un pays fait de noirs et de blancs, garantir la liberté des blancs en conservant les noirs dans les chaînes, c’est un tour de force […]. p. 160.
Les esclavagistes demandèrent l’annexion par les États-Unis, les planteurs réclamèrent l’intégration à l’Espagne. Aucun des deux états ne donna suite à ces demandes.
Les Cubains comprirent qu’ils ne seraient jamais des Espagnols à part entière ni jamais des Américains. Ces deux routes barrées, une seule resta : l’indépendance. p. 160.
Un nouveau conflit éclata entre les États-Unis et l’Espagne en 1898, après qu’un navire de guerre américain, le Maine, explosa de façon mystérieuse dans la baie de La Havane, causant la mort de 250 marines. Après la déroute de la flotte espagnole face aux USA, un traité de paix fut signé. Le 1er janvier 1899, le gouverneur espagnol, Jimenez y Castellanos, donna les clés de La Havane au général américain John Brooke. Le destin de Cuba dépendit alors des États-Unis.
L’Espagne perdit et s’en alla. Le peuple avait forgé son unité dans les combats, les Cubains se donnèrent une Constitution démocratique, vendirent leur sucre très cher aux États-Unis, devinrent une Nation souveraine. Il est vrai que le héros de la guerre, Martí – mort peu auparavant – n’avait cessé de répéter : “Le pays qui commerce avec un seul pays meurt.” Mais c’était pour ouvrir les yeux des Cubains sur leurs relations commerciales avec l’Espagne. p. 161.
Ségrégation ou discrimination ?
Sartre visite un bidonville – a priori de personnes “noires” – de Santiago, où il voit seulement des femmes, un “matriarcat de prostitués”, des enfants, mais pas d’hommes. Le sous-emploi est lié à l’exploitation de la canne à sucre, qui ne fournit du travail que cent vingt jours par an, soit quatre mois. D’autres hommes attendent de devenir adulte pour atteindre “l’âge officiel de chômer” et “chômer sans moralité”. Ils prennent référence sur “les grands gangsters du cinéma”, les seuls qu’ils ne méprisent pas.
La misère des noirs est liée au passage du statut d’esclave – nourris toute l’année – à celui de salarié – cent vingt jours de salaire. Ils souffrent aussi de la préférence donnée aux blancs pour le travail.
Deux jeunes Cubains disent à Sartre qu’il n’y a pas de ségrégation mais une discrimination. Ils donnent l’exemple de noirs qui peuvent être reçu dans “le meilleur restaurant de Cuba”, s’ils payent. Cette discrimination sera moins visible à La Havane, où les blancs pauvres adoptent les religions d’origine africaine, délaissant l’Espagne catholique.
Santiago reste une ville coloniale “par son architecture et par ses moeurs”. Le “préjugé raciste” est présent, même s’il tend à disparaître. La condition des métis est difficile, mais ils réagissent “par l’ambition”, et veulent “devenir l’élite cubaine”.
La Havane et les “problèmes généraux de Cuba”
Sartre se rend à La Havane, passant “de la question raciale aux problèmes généraux de Cuba”. Depuis qu’elle était devenue une République, cinquante ans auparavant (voir plus haut les éléments d’histoire). Cuba s’était changée en “Caverne des voleurs”. La corruption régnait sur les hommes politiques, candidats honnêtes au départ qui se changeait en “bandit” une fois élu. Il y eut une alternance entre régime parlementaire et dictature.
Comme elle était belle sous l’Empire, la République ; comme elle était intègre la dictature, en Démocratie. Les gens s’imaginent qu’un homme, s’il gouverne seul, est plus honnête qu’une Assemblée ? Pourquoi ? Parce qu’il n’a que deux mais pour voler ? p. 168.
Gerardo Machado devint président De Cuba en 1925. Il changea la constitution pour prendre les pleins pouvoirs, transformant le pays en une dictature. Il fuit le pays en 1933, en emportant un chargement d’or, suite à la crise économique de 1929 (la Grande Dépression) ayant entraîné des grèves générales à Cuba. S’ensuivit une période où le futur dictateur Fulgencio Batista mit en place des présidents “marionnettes”, avant de prendre le pouvoir comme président, puis comme président, puis comme dictateur après le coup d’État de 1952.
Un parti démocratique se revendiquant du héros national José Martí fut créé sous le nom de parti “Authentique”. José Martí (1853-1895) a créé en 1892, lors de son exil aux États-Unis, le premier parti démocratique de Cuba, le “Partido Revolucionario” (Parti Révolutionnaire). Après la fuite de Machado en 1933, des élections eurent lieu et le parti Authentique obtint de nombreuses voix. Ramón Grau San Martin devint président du Conseil, et corrompu…
C’était Parsifal sur le retour, les bons démocrates le soutinrent. Je devinai la suite : “au bout d’un an tout le monde volait ?” Mon interlocuteur, un médecin, me considéra d’un air surpris : “Au bout d’un an, pourquoi ? Le jour même.” Mais quelqu’un le corrigea : “Non, ils mirent tout de même deux mois à se corrompre.” pp. 168-169.
Le futur dictateur Batista, alors sergent dans l’armée cubaine, profita de cette corruption politique pour commencer à installer son pouvoir, avec ses présidents “marionnettes”.
A cet instant de l’histoire cubaine, on préférait un dictateur militaire à deux cents députés mais on le supportait sergent mieux qu’on eût fait colonel. A Cuba les dictateurs étaient des répits : vite détrompé, le peuple cubain se rechargeait en silence de ses haines et de ses espoirs. p. 169.
Batista fut ensuite président de 1940 à 1944. Une nouvelle Constitution démocratique fut promulguée mais non appliquée pour cause, officiellement, de guerre mondiale. Les élections de 1944 firent partir Batista, qui se réfugia aux USA dont il “aimait le patronage” et les conseillers. Le parti Authentique prit le pouvoir jusqu’au coup d’État de 1952. L’opposition prit la forme d’un autre parti, se réclamant également du héros national José Martí : le parti orthodoxe.
N’importe : authentique, orthodoxe, ce n’est pas sérieux […]. Au mont Saint-Michel, il y a des Mères Poulard authentiques qui prétendent descendre par la chair de la vieille aubergiste et d’autres qui sont orthodoxe et qui jurent de faire l’omelette aussi bien qu’elles, fortes d’en avoir retrouvé la recette écrite de sa main. p. 170.
Les politiques et les fonctionnaires tombèrent à nouveau dans la corruption. La prostitution et les jeux de hasard se développèrent. La richesse et la corruption était liées à l’industrie sucrière.
“L’ennui, c’est qu’il en faut ! Si mal qu’il nous fasse vivre, c’est par lui que nous vivons.” Et l’un d’eux ajouta avec l’agrément de tous : “Notre pays est soumis à cette loi d’airain : pas de sucre, pas d’île ! Le sucre enrichit les riches, nous savons qu’il appauvrit les pauvres de jour en jour davantage. Mais que voulez-vous y faire ? C’est notre lot.” p. 175.
Démocratie et tyrannie se ressemblaient et ne différaient que par le sang versé par le dictateur. Partout, “l’implacable Déesse Canne” répandait la “Démoralisation”. C’était le destin de Cuba, illustré par la pièce du jeune auteur cubain de l’époque, Virgilio Piñera, Electra Garrigó, qui “reprend à son compte le mythe d’Électre en le transposant dans un climat de révolution” (source : Les Solitaires Intempestifs).
En chemin pour reprendre l’avion qui le ramène à Paris, Sartre rencontre un citoyen des États-Unis qui lui propose de l’accompagner à l’aéroport.
Il m’apprit en chemin l’incroyable sollicitude de son pays pour Cuba : depuis cinquante ans les USA avaient la générosité d’acheter aux Cubains leur sucre au-dessus du prix mondial. “Nous avons, dit-il en souriant, de ces faiblesses. Cette île est si belle que nous l’entretenons comme une danseuse.” p. 177.
Le chapitre se termine par une réflexion de Sartre sur le retour au pouvoir de Batista en 1953.
J’appris, avec six mois de retard, en 1953, que la Démocratie cubaine avait cédé la place une fois de plus à la dictature […]. Je conclus : “Ces gens-là n’ont que ce qu’ils méritent” et je tirai le trait. C’était, j’en conviens, de l’étourderie. p. 178.
II. Octobre 1959 – Février 1960
Cette partie relate le voyage de Sartre à Cuba en 1960. Il y donne son analyse de Fidel Castro, du chef des insurgés à la souveraineté “absolue dans son absolue faiblesse”.
En France, Fidel Castro est d’abord apparu dans le “silence de nos journaux”, comme le chef d’une insurrection cubaine. Au départ, on parla plus des rebelles lorsqu’ils organisèrent l’enlèvement du coureur automobile Fangio.
“L’Operación Fangio”
Note : les éléments ci-dessous sont en partie issus de l’article de Michel Porcheron, Le rapt de Fangio à Cuba, comme le raconta Maurice Trintignant.
Le coureur automobile Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde de Formule 1, doit participer au deuxième grand prix de Cuba. Cette course a été créée en 1957 par Batista, dans le but d’attirer des touristes fortunés, notamment venant des USA. Le circuit se déroule dans la ville de La Havane, sur le Malecón, célèbre avenue du bord de mer. Fangio gagne la première édition en 1957. Il est enlevé la veille du grand prix de 1958, par les rebelles du mouvement du 26 juillet, dont le chef est Fidel Castro. Le mouvement castriste est dénommé ainsi en référence à l’attaque de la caserne de Moncada, le 26 juillet 1953 à Santiago de Cuba, par les rebelles emmenés par Castro.
L’Argentin Juan Manuel Fangio (1911-1995) sera « retenu patriotiquement » quelques 26 heures. Si le compte est bon, le groupe était formé de quelque 26 hommes et femmes (7) ça ne s’invente pas. Michel Porcheron, Le rapt de Fangio à Cuba, comme le raconta Maurice Trintignant.
Lorsque Fangio fût relâché par ses ravisseurs, il déclara qu’il avait été bien traité, en rédigeant ces quelques lignes le 24 février 1958 : “J’enregistre qu’au cours de mon aimable enlèvement, j’ai été traité avec des attentions cordiales, j’ai seulement demandé des excuses pour cette situation indépendante de ma volonté. Sincèrement.” (Traduction par mes soins sur la base du fac-similé du message de Fangio).
[…] dans le livre « Fidel Castro, Biographie à deux voix, Fayard/Galilée, 2006. I.Ramonet écrit aussi : « La nouvelle fait le tour du monde. L’objectif était précisément de dénoncer aux yeux de l’opinion publique internationale la situation à Cuba » que Batista dirigeait d’une main de fer, appuyé par le gouvernement de Washington. Le dictateur était loin de penser que dix mois plus tard il serait obligé de fuir La Havane. Ibid.
Batista voulait attirer l’argent des riches américains, et les rebelles castristes voulaient faire connaître leur cause au monde entier. Ce sont eux qui alors ont atteint leur objectif médiatique. Fangio est revenu à Cuba en 1981. Il y a rencontré Fidel Castro et quelques-uns de ceux qui avaient participé à l’époque à son enlèvement. L’un des anciens ravisseurs déclara : “Il ne nous a pas seulement pardonné, il nous a compris.”
1er janvier 1959, An I de la Libération nationale
La victoire des révolutionnaires castristes est déclarée officiellement le 1er janvier 1959. Le même jour, Fidel Castro entre à Santiago de Cuba et le Che Guevara, avec Camilo Cienfuegos fait de même à La Havane. Batista a fui à Saint-Domingue la veille, le 31 décembre 1958.
Ni Sartre, ni les Français ne réagissent positivement à cette libération de Cuba.
Castro vainqueur, c’était un scandale ; les modérés condamnaient cette révolution de cinglés, les gens de gauche l’approuvaient mais se désolèrent d’avance, sûrs qu’on l’écraserait dans l’oeuf. p. 180.
Sartre reçoit alors la visite de Carlos Franqui, directeur de Revolución, qui est le journal du mouvement du 26 juillet. Créé en 1959, il deviendra ensuite le quotidien Granma après sa fusion avec le journal du parti socialiste populaire Noticias de Hoy. Franqui avait participé à la guérilla et notamment dirigé Radio Rebelde, la radio créée par Che Guevara pour promouvoir les objectifs de la révolution. Il vient pour inviter Sartre, celui qui a écrit sur les révolutions sans jamais en avoir vécu une, à venir à Cuba pour connaître la véritable Révolution cubaine. Il argumente pour tenter de vaincre la réserve de l’écrivain.
« Depuis vingt ans, vous criez dans le désert que les choses ne vont pas comme il faut. Or, elles vont comme il faut chez nous : si vous restez ici à vous tordre les bras sans jeter un coup d’oeil sur ce que nous essayons de faire, cela revient à casser votre plume. Vous avez écrit sur la liberté, sur la justice : eh bien, cessez d’écrire ou venez les chercher à Cuba. » p. 181.
Sartre décrit l’état de l’opinion publique en France sur la situation politique de Cuba. Les journaux communistes félicitent froidement ce jeune gouvernement révolutionnaire de juste dix mois, mais restent critiques sur l’attitude anticommuniste de Castro. La Réforme agraire est également critiquée : soit “c’est le vol” par la spoliation des propriétaires actuels ; soit elle trop peu ambitieuse par son maintien de la propriété dans sa redistribution des terres.
Le demi-choeur de droite reprend : c’est la destruction systématique de l’individu ; les coopératives partout ! Plus de capitaux privés : le socialisme. Pire encore : le capitalisme d’Etat. Le demi-choeur de gauche répond : hélas, non ! on n’a pas touché à la petite épargne, les industriels ont conservé intacts les taux de leur profit, les commerçants vivent de leurs gains et les rentiers de leur rente, comme au temps de Batista. Match nul. p. 182.
Les premiers considèrent le régime castriste comme une dictature, puisqu’aucune élection n’a eu lieu ; les seconds le considèrent comme une démocratie encore jeune. Le reproche vient aussi sur la mise en oeuvre d’un “culte de la personnalité”, par la diffusion massive de portraits de Castro. Les interlocuteurs cubains venus rencontrer Sartre avec Franqui reprochent alors aux médias français de ne s’informer qu’auprès des agences de presse nord américaines.
« Une chose est claire : jamais avant le 1er janvier 1959 les Cubains n’ont vécu la démocratie. De ce premier de l’an date une métamorphose irréversible : ce n’est pas seulement qu’ils ont pris connaissance du régime démocratique, c’est qu’ils en ont pris le goût ; on ne le leur ôtera plus. » p. 183.
Ils parviennent ainsi à convaincre Sartre de venir à Cuba pour voir la réalité par lui-même.
“Est-ce que la littérature peut dire oui ?”
Le 20 février 1960, Sartre et Simone de Beauvoir, arrivés la veille à Madrid, débutent leur trajet vers Cuba. Ils prennent un avion de la compagnie Cubana, qui organise alors deux allers et retours hebdomadaires Madrid-Cuba. Sartre élabore durant ce trajet une réflexion globale sur la situation de Cuba et ce qu’il conçoit de son rapport particulier d’écrivain à cette situation d’un peuple. Le Cuba sartrien de 1949 vient voir le Cuba castriste de 1960.
Sartre doute d’abord de l’intérêt “d’aller chercher au-delà des mers une raison nouvelle de désespérer”. Les Français sont partagés, à moitié esclaves et à moitié indépendants, entre les deux blocs que sont les USA et l’URSS. La problématique de Cuba diffère au moins par sa plus grande proximité géographique des USA que de l’URSS.
On lui offre un numéro de Revolución, dans lequel Virgilio Piñera, l’auteur d’Electra Garrigó, a rédigé un article à propos de la venue de Sartre :
« N’allons pas demander des conseils aux écrivains étrangers : ils en seraient les premiers surpris. Puisque celui-ci nous fait le plaisir de nous rendre visite, interrogeons-le sur lui, sur les difficultés qu’il rencontre dans son métier, parlons-lui des nôtres. Soyons convaincus — si mince que soit notre bagage — qu’il apprendra de nous autant que nous apprendrons de lui. » pp. 186-187.
Sartre fait une nouvelle comparaison, entre la France, l’Europe et Cuba, et cette fois dans le domaine de la culture. Face à la culture cloisonnée de l’ancien monde, Cuba a “un peuple, une culture”. La culture littéraire est notamment à créer par la Révolution.
Ils n’en sont qu’aux semailles mais la récolte peut être bonne ; chez nous la récolte est faite : elle ne vaut rien du tout. Et puis surtout, dans notre Europe, qu’est-ce qu’un écrivain peut faire ? Vendre sa plume ou dire non. Les plumes vendues sont trop légères : elles grattent mais ne marquent pas. Les autres font des pages d’écriture : « Non ! non, non, non. Non. » Ça, les auteurs cubains savent le faire : ils ont connu, de 1952 à 1959, les splendeurs et la détresse des « cris écrits » ; ils ont dit non à Batista en caractère latin, gothique, cyrillique, en clair ou par les chiffres de la poésie : qu’ai-je à leur dire qu’ils n’aient durement appris pendant la tyrannie, la résistance et la guerre ? pp. 187-188.
Sartre résume par cette question l’enjeu des écrivains cubains : “Est-ce que la littérature peut dire oui ?” Une littérature peut-elle conserver ses exigences, tout en approuvant un régime, et sans se limiter à n’être qu’un moyen de propagande ? Les Européens n’ont jamais su le faire. Les Cubains doivent décider à commencer à prendre ce chemin, à se mettre en mouvement.
[…] ce sont des bleus, des conscrits, mais ils échappent à ma sagesse en inventant leur chemin : je ne puis ni, certes, les guider ni même les suivre ; si l’on nous réunit, je serai le sédentaire, ils seront les hôtes de passage. […] Le passé vient voir Cuba : il n’est pas méchant, le passé, il est même utilisable à la condition de ne jamais prendre son avis […]. p. 189.
Sartre est l’Ancien monde, et les Cubains sont une “Nation révolutionnaire”. L’article de Piñera lui redonne pourtant sa “place d’homme, au beau milieu des relations humaines”.
La fin du temps du mépris
Sartre pense au Cuba de dix ans auparavant, à la résignation face à un destin enchaîné à la seule culture de la canne à sucre.
« Pas de sucre, pas d’île. Rien. Silence et bonne humeur. Le moindre geste entraîne une avalanche, la ruine. Pour éviter la famine, acceptons la faim chronique et le sous-emploi. En un mot : putain le sucre t’a faite et putain tu resteras. » p. 190.
Il examine le chemin qu’a pris le peuple cubain, métamorphosant la honte ressentie face à ce destin semblant inéluctable, d’abord en “sentiment révolutionnaire”, et finalement, par leurs actes, en un sentiment de fierté. Sartre voit dans cette métamorphose le remplacement d’un destin par une praxis.
[Praxis :] chez Marx et les marxistes : relation dialectique entre l’homme et la nature par laquelle l’homme en transformant la nature par son travail se transforme lui-même […]. L.-M. Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines.
Refusant la résignation devant un destin “naturel” imposé par le monopole sucrier, le peuple cubain transforme ce destin par les actes révolutionnaires, les écrits littéraires notamment, et se transforme ainsi dans le même temps. Sartre reprend la comparaison avec la situation en France.
Nous sommes encore très loin d’être fiers, nous autres Français : c’est que nous n’avons pas renoncé à nous cacher notre honte. […] Il y a la journée des Mères, bientôt celle des Pères, celle de l’Armistice ou de la Victoire : à quand la journée de Honte nationale ? p. 190.
Sartre, avec ce nouveau voyage à Cuba, vient vérifier que la métamorphose est encore possible pour la France. Lorsqu’il parle de la honte française, il évoque vraisemblablement les tortures de la guerre d’Algérie (1954-1962), qui ne semble pas déranger les Français de l’époque (“voilà cinq ans qu’on torture – et les travailleurs ni les ménagères ne semblent très incommodés”).
Sartre espère voir en Cuba la preuve (et la chance) d’une véritable Révolution, mais il a encore des doutes.
Aux Cubains de me persuader qu’on peut encore changer la vie et que, pour nous aussi, le temps du mépris prendra fin. p. 191.
Fidel Castro selon Jean-Paul Sartre
A partir de cet endroit du texte et jusqu’à la fin de celui-ci, Sartre développe son analyse de la personnalité de Fidel Castro.
Biographie synthétique de Fidel Castro
Source : www.fidelcastro.cu/
Fidel Castro est né le 13 août 1926 à Birán, localité située à l’Est de Cuba, dans la province actuelle d’Holguín. Son nom complet est Fidel Alejandro Castro Ruz. Son père, Angel Castro Argiz, était propriétaire d’une plantation de canne à sucre. Sa mère, Lina Ruz González, était issue d’une famille paysanne de Pinar del Río, ville située à l’Ouest de Cuba, à 156 km de La Havane.
Il va à l’école de Birán, puis dans des établissements catholiques privés, à Santiago de Cuba, puis à La Havane chez les Jésuites. Il obtient son baccalauréat de lettres en 1945. Après des études de droit, il obtient son doctorat en 1950 et commence à exercer comme avocat, en défendant gratuitement des gens pauvres.
Le 26 juillet 1953, il prend d’assaut la caserne Moncada à Santiago de Cuba avec un groupe de rebelles. Cette opération échouera et Fidel Castro sera jugé puis emprisonné. Lors de son procès, il assume lui-même sa défense, dans une plaidoirie publiée ensuite sous le titre L’Histoire m’acquittera (en espagnol : La Historia me absolverá). Il est amnistié deux ans plus tard et s’exile au Mexique, où il va préparer la libération de Cuba avec Che Guevara.
Le 2 décembre 1956, il revient à Cuba avec des rebelles et débarque sur la côte Sud-Est avec le bateau Granma. Commencent des années de lutte depuis la Sierra Maestra, qui aboutissent à la libération de l’île le 1er janvier 1959, quand Castro entre à Santiago de Cuba, pendant que le Che Guevara et Camilo Cienfuegos entrent à La Havane.
Fidel Castro devient premier ministre du Gouvernement révolutionnaire le 13 février 1959. Il conduit le pays jusqu’en juillet 2006, où il renonce à ses fonctions pour raisons de santé. Il meurt à La Havane, le 25 novembre 2016, à l’âge de 90 ans. Il repose au cimetière de Santa Ifigenia, à Santiago de Cuba.
La vraie quête de Fidel
Sartre commence par une courte analyse des origines familiales et de l’adolescence de Fidel Castro. Rappelons que “L’existence précède l’essence” est la doctrine de Sartre. Celle de Castro débute dans le milieu familial, une “communauté aristocratique”, où chaque membre de la famille était “une incarnation particulière de la Maison”, une “personne concrète” dans la totalité qu’est le groupe familial. La première essence de Castro serait donc forgée dans l’appartenance à un tout, ici la famille. Les périodes d’exil auraient été vécues par Castro comme une séparation et une réduction à l’élément qu’est l’individu, exilé de sa famille. Castro rechercherait ainsi dans une nouvelle essence, la “vie plénière” à redevenir une totalité, à s’épanouir en devenant “enfin tout l’homme”. Cette totalité était le peuple cubain, découvert avec le début de “sa révolte”.
Il avait rencontré le groupe le plus large : non pas un ensemble organisé mais l’organisation de tous les ensembles ; non pas une totalité singulière et contestée par d’autres : mais le tout ; tous les hommes de l’île, en dehors de cela rien. p. 192.
“Le peuple en personne”
A cet endroit du texte, Sartre semble juxtaposer l’existence et l’essence. Fidel Castro a toujours incarné le peuple cubain : il est “déjà l’île entière” (la mise en italique est de Sartre), il est “le peuple en personne”. Il existe, et son essence première, originelle, est déjà d’incarner le peuple. Sartre reprend la conception du mouvement d’Aristote : ce qui est en puissance, autrement dit ce qui n’est pas encore mais qui peut être – le marbre d’une future statue – ; ce qui est en acte, c’est-à-dire qui existe, qui est réalisé – la statue achevée (voir ces notions dans le Carnet de Vocabulaire). Castro, celui qui sera en acte le “chef de ces futurs tribuns du peuple” est en puissance dans l’individu qu’est Fidel, l’écolier sage, le docteur en droit. L’essence originelle devient la véritable essence qui suit l’existence : Castro quitte l’individu qu’il était, “ce lieu géométrique des négations” pour se projeter vers son avenir (la Révolution “à venir”). Son projet est de “se faire peuple”.
[…] Castro s’appliquera à dépouiller ces qualités de leurs dernières marques individualistes : il n’est pas plus courageux que ses camarades, il est le peuple en acte, c’est-à-dire la source de tous les courages ; la passion de donner à ces insulaires la souveraineté dans leur île […]. p. 193.
Castro passe de la négation du simple individu – son existence -, au choix du projet d’être le “peuple en personne” – son essence. Nous retrouvons ici une démonstration de l’existentialisme tel que Sartre le conçoit.
Quand nous disons que l’homme se choisit, nous entendons que chacun d’entre nous se choisit, mais par là nous voulons dire aussi qu’en se choisissant il choisit tous les hommes. Sartre, L’existentialisme est un humanisme.
Fidel l’individu choisit d’être Castro, celui qui sera responsable de ce qu’il est, et qui s’engagera par son projet envers le peuple cubain.
Le temps de témoigner
Durant son exil au Mexique, Fidel Castro prépare l’insurrection qui commencera avec le débarquement du Granma à Cuba (voir plus haut la biographie synthétique). Il est approché par des exilés cubains, issus du parti “Authentique”. Ceux-ci veulent s’allier avec lui pour reproduire leurs “routines politiques” de représentants se réclamant d’un peuple voué de son côté à rester divisé par des partis ou doctrines diverses. Fidel Castro refuse leurs propositions d’alliance. Sa conception de la Révolution n’avait rien de commun avec les visions politiciennes de cette “élite représentative”.
Les compatriotes de Fidel lui rappelaient sans cesse sa naissance, ses succès, sa vie : c’était un piège ; il refusa d’emprunter les yeux de ses adversaires pour se revoir sous les traits d’un particulier. […]. Tactiquement, il refuse toute autre limitation que celle de la Souveraineté nationale : s’il est le peuple, les autres sont le désordre ; il s’oppose à eux comme la plénitude concrète à des abstractions, comme la personne collective à des individus. p. 195.
Castro débarque avec le Granma à Cuba après son exil mexicain. Après l’attaque de l’armée de Batista, les survivants du Granma se réfugient dans les montagnes de la Sierra Maestra. Deux ans de lutte commencent, durant lesquelles les témoignages des martyrs de la guérilla font grandir le nombre de paysans, d’étudiants, de déserteurs de l’armée de Batista, qui rejoignent les rebelles.
Ces résistants sont morts pour la Nation : la Nation c’est Castro, au sommet de l’île ; il donne un sens à leurs souffrances. Réciproquement ces mortelles douleurs, à tour de rôle, le consacrent, témoignent que Fidel est l’incarnation souveraine. pp. 195-196.
Sartre résume le parcours de Fidel Castro, de l’individu à l’incarnation du peuple souverain, en trois étapes ainsi qualifiées : la passion, la tactique, le devoir. Lorsque, au début, il se défait de l’individu en lui, il le fait par la passion de donner aux Cubains la souveraineté sur leur île. Face aux politiciens exilés, sa tactique est de refuser leurs sollicitations individualistes pour aller vers une plénitude collective. Enfin, devant le ralliement au mouvement rebelle, le “premier signe” donné par le peuple, il répond à un devoir éthique. Castro ne commande pas au peuple, il n’est pas un de leurs représentants, pour qui il n’a que du mépris.
Son mépris des représentants, je ne le comprends que trop : je l’étendrais, pour ma part, à toutes les élites. Laissons : Castro s’indignait surtout que les représentants voulussent montrer le chemin aux représentés : suivez le guide ! p. 196.
Le peuple s’unit “autour de Castro” et “en lui”. Sartre y voit même le “Dieu d’Aristote”, qui est la cause, le “premier moteur”, du mouvement perpétuel de toutes choses, tantôt en acte, tantôt en puissance. Pour Aristote, ce premier moteur produit l’unité (Métaphysique, 1075b), et c’est naturellement que les êtres et les choses se mettent en mouvement. Ainsi, Castro montre aux Cubains qu’ils sont un peuple qui existe. Et c’est naturellement que ce peuple converge vers lui, sans qu’il soit nécessaire à Castro de commander aux Cubains. Le guerrier paysan vivait la souffrance du peuple, jusqu’à être le peuple.
Pour dégager la souveraineté de sa gangue, il fut le peuple au pire de la condition populaire : non par goût mais parce qu’il fallait commencer par là. On peut l’appeler à juste titre un transformateur d’énergie, puisqu’il attirait en lui les privations, la misère, pour en faire une force. Mais, du coup, perdant son individualité, il gagna sa personne : il fut le peuple et puis aussi l’homme qui était le peuple. p. 197.
Cette “incarnation de la totalité”, cette volonté d’unification, d’unité, se retrouvent même dans les paroles de Castro :
Il juge rarement de manière explicite mais tous ses discours sont imprégnés de morale : on y trouve le refus vraiment populaire de distinguer la valeur d’un homme, d’un geste, et le sentiment qu’ils inspirent. Valeur d’usage, valeur éthique, déterminations de la sensibilité : trois aspects qu’on sépare d’ordinaire et qu’il unit comme le peuple a toujours fait, à juste titre. p. 198.
Sartre cite une anecdote sur ce besoin d’unification. Castro lui dit, parlant de la campagne vide de travailleurs : “C’est triste aujourd’hui, parce que c’est dimanche.” L’absence du peuple des travailleurs rappelle le temps de la désunion. Le travail désormais rassemble le peuple pour assurer l’indépendance du pays, pour améliorer la vie de la population et de ses enfants. La campagne du dimanche, vide de ses travailleurs, est vécue par Castro “comme un nouvel exil”.
“Pour arriver à être tout, veillez à n’être rien en rien”
Sartre effectue une analogie entre Fidel Castro et un religieux mystique du XVIe siècle, Jean de la Croix.
Fidel, à partir du débarquement, n’est même plus une incarnation particulière du tout : son objectif est de gagner les Cubains à une entreprise totale en s’y jetant le premier comme un peuple tout entier. A ses propres yeux — pour eux seuls — il n’est personne parce qu’il est le commencement de tout. Cela signifie, en d’autres termes, qu’il atteint à la souveraineté nationale par la voie ascétique du dépouillement. p. 199.
Sartre utilise un vocabulaire mystique : l’incarnation, le commencement, la voie, l’ascèse, le dépouillement. Il paraphrase plus loin la parabole du chas d’une aiguille. Dans la Bible, elle indique qu’il est plus facile de faire passer un chameau par le chas d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu (Matthieu 19:24). Ici, Sartre évoque la nécessité que les “masses cubaines” passent par le chas d’une aiguille pour accéder à l’union, via la révolution. Mais le peuple ne passerait par là que si un chef les y précède.
Castro devint Nation et personne par sa décision de dépouiller sa personnalité ; et cette décision, à son tour, les Cubains la jugèrent inébranlable en devinant qu’elle était lui-même, au plus profond de ce que les Espagnols nomment corazón, amour et courage et colère et générosité, un mot que Fidel aime et dont il se sert et qu’on traduira — en tous les sens — par le mot français de coeur. p. 199.
Nous retrouvons ici une autre notion de la doctrine de Sartre : l’homme est condamné à être libre. Castro n’a pas d’autre choix que de devenir Nation, et de quitter son essence originelle – ou son existence première – de fils d’un propriétaire colon. “L’option” est “obligée”.
Sartre voit l’origine de cette transformation dans la culture religieuse espagnole, et précisément dans le “dénuement” prôné par un moine carmélite du XVIe siècle, Jean de la Croix (Juan de la Cruz, 1542-1591).
C’est Jean de la Croix qui a écrit : « Pour arriver à être tout, veillez à n’être rien en rien » p. 200.
La notion de néant – “rien en rien” – fait son apparition. Sartre y a consacré son ouvrage majeur, L’Être et le Néant, dont le sous-titre est “Essai d’ontologie phénoménologique”. Il y est donc question de l’être – humain -, et de sa liberté, c’est-à-dire, selon Sartre – qui joint aussi Descartes et les Stoïciens à sa conception -, son pouvoir de sécréter un néant qui isole la réalité humaine. Il faut d’abord passer par le néant pour dépasser l’être : “pour arriver à être tout, veillez à n’être rien en rien”. Descartes découvre le Cogito, “je suis ; j’existe” en organisant le néant autour de lui, par le doute hyperbolique : il met tout en doute, ce qui l’environne et ce qui est en lui (ses préjugés, ses perceptions par les sens, etc.).
[…] l’interrogation est, comme le doute, une conduite : elle suppose que l’être humain repose d’abord au sein de l’être et s’en arrache ensuite par un recul néantisant. C’est donc un rapport à soi au cours d’un processus temporel que nous envisageons ici comme condition de la néantisation. Nous voulons simplement montrer qu’en assimilant la conscience à une séquence causale indéfiniment continuée, on la transmue en une plénitude d’être et, par là, on la fait rentrer dans la totalité illimitée de l’être […]. Sartre, L’Être et le Néant, p. 69.
C’est la néantisation de Fidel en tant qu’individu qui va lui permettre de devenir Nation ; c’est la néantisation de Jean de la Croix qui va réunir en lui l’âme à Dieu.
L’orgueil des fous
Sartre compare ainsi le révolutionnaire et le mystique, qui tous deux renoncent à ce qu’ils étaient en tant qu’individu, pour devenir une totalité : une Église unifiée ; un peuple souverain. ll y voir aussi un autre point commun : “l’orgueil fou”. Il ne s’agit pas ici de la vanité, du désir vain d’Épicure, qui guide aveuglément vers la possessions de richesses, la recherches d’honneurs personnels ou même de crimes. L’orgueil des fous que sont Jean de la Croix et Castro relève de la fierté ; fierté d’être mandatés, d’être missionnés. Le moine mystique décrit sa “nuit obscure” (Noche oscura), son chemin pour trouver Dieu dans le néant.
Castro, lui, va plus loin : il ne dit pas seulement qu’on peut mais qu’on doit faire ce qu’il a fait. Un rebelle dans la Sierra, un étudiant torturé dans les prisons, c’est Fidel lui-même. Il le sait, il l’a dit : malgré les coups, les supplices, il faut tenir : ce sera le commandement et la passion de n’importe qui. Mais n’importe qui, s’il tient quand il faut, agit de son mieux. Et ce mieux n’est pas dépassable car c’est le meilleur de l’homme. p. 202.
Castro se néantise pour devenir la totalité, et son orgueil vient de sa conviction qu’il pense “comme tout le monde”. Sa pensée, ses actions sont celles du peuple cubain. Sartre définit ainsi l’orgueil de Castro :
[…] tout homme est tout l’homme, même dans l’impuissance moléculaire, même dans la dispersion. Mais il ose rarement se voir ; l’orgueil fou est un acte : j’efface tout et je recommence. p. 202.
La fierté de Castro réside dans son dénuement : il a tout effacé de ce qui être possédé par propriété. Il a choisi “d’être et de faire”, il a refusé tout ce qui est de l’ordre de l’avoir. Comme il refuse les possessions, il refuse aussi les pouvoirs institutionnels.
Castro n’a pas le pouvoir : son orgueil est de l’être. Cela veut dire que le peuple seul est souverain ; Castro suscite, du milieu de la foule et par le même acte, l’union populaire en lui et autour de lui ; ces milliers d’hommes sont le peuple et chacun d’eux en est une incarnation plénière, Castro comme ses voisins. p. 204.
Comme dans la parabole du chas de l’aiguille utilisée plus haut, Castro précède le peuple cubain. Il échange avec lui en cherchant toujours l’intégration de chacun dans cette totalité qu’est la nation, sans effets de discours, sans privilégier ni lui ni son auditoire.
Expliquer une mesure, en montrer aux autres la nécessité, c’est poursuivre jusqu’au bout le dépouillement, refuser les mystères des pouvoirs et jusqu’au privilège chèrement acquis de la connaissance ; vous en savez autant que moi : ou cette phrase est une mystification du peuple par le chef et du chef par lui-même ou elle est l’orgueilleuse extermination par le chef de tous ses mérites. p. 205.
Après la néantisation de l’individu pour devenir Nation, c’est la néantisation de “l’institution d’État” au profit du renforcement de la souveraineté du peuple. Ce “dépérissement de l’État” n’est pas la mise en oeuvre d’une anarchie – étymologiquement, l’absence de commandement -, mais l’incarnation, déjà exposée, de la Nation, c’est le transfert de l’autorité du peuple dans la personne de Castro, individu préalablement anéanti ou néantisé selon la terminologie de Sartre.
La vocation révolutionnaire
Castro devient la Nation, c’est la première étape de la souveraineté du peuple. Dès 1960, Sartre pose la question de l’après Castro.
[…] tout le monde sait à Cuba qu’il est irremplaçable. Ses collaborateurs directs sont des hommes excellents, d’autres hommes excellents vont grandir ou vont naître. Mais, justement, ce n’est pas l’excellence que les Cubains aiment en Castro : c’est leur union, fragile encore, qu’il abrite et protège. p. 205.
Le Castro incarnant la Nation cubaine, le peuple souverain ne risque-t-il pas d’être un obstacle pour toute institution qui prendra son relais à son départ ? Sartre va analyser la vocation révolutionnaire qui fait l’originalité de Castro, et qui semble le rendre irremplaçable .
Orgueil fou, générosité biffée, révolte devant toute injustice, c’est la vocation révolutionnaire de Castro. p. 207.
Nous avons vu précédemment l’orgueil fou. La générosité est la “principale tentation” de Castro. Notons que nous sommes encore devant un vocabulaire mystique. Dans le domaine religieux chrétien, la “tentation” est une épreuve à laquelle Dieu soumet l’homme pour vérifier sa foi. “Ne nous soumets pas à la tentation” est une des phrases de la prière dite du Notre-Père. Il ne faut donc pas succomber à la tentation si l’on veut dépasser cette épreuve. Castro n’y succombe pas en tant qu’individu : il ne se fait pas héros libérateur des pauvres, il ne donne rien (en tant qu’individu répétons-le). Il se “consacre” – encore un terme mystique – à Cuba. Il agit, et par ses actes, il donne à Cuba sa totalité.
Cette générosité, souplement balancée par ce sens constant du besoin chez les autres — « le droit de chacun sur tous » et par conséquent sur Castro —, il l’a mise sous le contrôle de la colère et son incessante rébellion la dégraisse de toute solennité. p. 207.
Chacun a le droit sur tous, chacun a le droit sur Castro ; mais Castro a-t-il le droit sur tous ? La colère qui contrôle sa générosité peut-elle se convertir en Terreur ? La Terreur, ce serait une partie du peuple qui impose le silence à l’autre partie : plus d’unité, plus de totalité.
La Terreur dehors, ce serait la Terreur en lui, l’effondrement du Tout qui légitime son autorité, le retour des violences qui se sont exercées en lui et sur ses compatriotes quand Batista régnait. Précisément parce qu’il ne peut plus vivre sans être le Tout au milieu du Tout, Castro ne peut vouloir la Terreur en aucun cas[…]. p. 207.
Castro est “l’homme de l’Unité”. Instaurer la Terreur, c’est revenir au temps de la désunion, au temps du règne des tyrans. Castro ne peut pas vivre sans l’union de tous, c’est “sa manière d’être”. Dans L’Être et le Néant, Sartre écrit que “C’est dans le néant seul qu’on peut dépasser l’être”. Pour que la Terreur soit, il faut que Castro cesse d’être “l’être” qui incarne l’Unité. La Terreur serait alors le néant qui dépasse l’être qui incarne l’Unité :
« Pas de Terreur avec Castro. » L’union qu’il a faite, qu’il fait et refait sans cesse, hors de lui et en lui, ne peut en aucun cas se fonder sur le silence qu’une moitié de son coeur, qu’une moitié du peuple imposerait à l’autre moitié. p. 207.
“Je dirai ce que j’ai compris”
Ce qui se passe à Cuba est singulier. Les institutions classiques, les régimes “d’appellation contrôlée” ne conviennent pas à Cuba, tout comme la Révolution cubaine ne peut pas s’appliquer ailleurs que sur cette île, qui ne compte alors que six millions d’habitants. Lors d’une conversation, Castro demande de façon directe à Sartre s’il a le sentiment que les Cubains vivent sous une dictature. Sartre répond par la négative et fait part de la relation particulière qu’il a perçue entre Castro et les Cubains. Celia Sánchez, une proche de Castro est présente. Elle a notamment participé à la Révolution. Voici comment elle décrit cette relation particulière :
« Ils pensent tous qu’ils ont des droits sur lui. Vous avez vu l’ouvrier noir ? De quel ton impérieux il exigeait de Fidel la prudence. Il leur appartient : voilà le fond de l’affaire. Autant que leurs fils et plus que leur femme. On arrête son auto, on lui fait violence : chaque membre de la collectivité nationale exige de régler les affaires de la nation — en tant qu’elles le concernent — avec Castro seul et d’homme à homme. » p. 208.
Il semble difficile de pratiquer un tel exercice du pouvoir ailleurs qu’à Cuba, et en particulier dans “la vieille et riche Europe”.
De ses conversations avec Castro, et de ce qu’il va observer, Sartre va exposer le double aspect de celui qu’il voit comme “à la fois le dirigeant de Cuba et son propre agitateur”.
Je dirai ce que j’ai compris : en un mot ce qui vient de lui et de moi; ce que j’ai reconstruit d’après ma trop courte expérience du régime et d’après ses réponses ou ses silences. p. 208.
Castro dirige en communiquant au moyen des médias. Il utilise notamment la télévision, qu’il fait installer dans toutes les coopératives. Les Cubains peuvent ainsi l’entendre expliquer, user de pédagogie pour faire comprendre les décisions.
Cette communication orale passe aussi la barrière de l’analphabétisme, encore très présent sur l’île. En 1957, le taux d’analphabétisme dans la population rurale de plus de dix ans est de 43% (source : J.-F. Bonaldi). La campagne massive d’alphabétisation débutera le 29 août 1960. Le 22 décembre 1961 Cuba se proclame Territoire Libre d’Analphabétisme. Le taux d’analphabétisme est alors passé à 3,9% de la population totale des Cubains.
Fidel est l’homme de la Télé : il en use sans cesse ; il raisonne, explique lentement, avec application, on le voit penser ce qu’il dit. D’un même coup, il rend la Raison moins abstraite en l’incarnant — et l’auditeur plus universel en apparaissant à chacun dans l’exacte mesure où il se montre à tous. p. 209.
Dans la plupart des régimes, une fois le temps de la communication effectuée, des “déclarations officielles”, des réunions sont organisées par “l’administration centrale” pour mettre en oeuvre les décisions politiques, de les transcrire en actions. A Cuba, Sartre découvre que c’est Castro lui-même qui assure lui-même ce temps de l’action, prenant ainsi “des fonctions d’activiste”. L’activisme est une méthode politique ou syndicale qui prône l’action directe (cnrtl.fr). C’est la méthode choisie par Castro : il se rend sur place, pour avoir un contact direct avec les Cubains. Et c’est ainsi que chacun peut s’approprier la souveraineté incarnée par Fidel Castro.
Il n’y a pas un Cubain qui ne s’attende chaque jour à voir surgir Castro : c’est cela, peut-être, qui achève de les individualiser ; par cette raison, en effet, ils ruminent leur idée fixe — critique, invention, réorganisation du secteur — pour pouvoir la lui offrir un jour. Qu’il l’accepte, ils auront gouverné. p. 211.
Il n’y a pas d’intermédiaire, ni du côté du dirigeant qui délèguerait l’activisme à des “militants locaux”, ni du côté du peuple, qui n’a pas besoin de représentants pour dialoguer en direct avec le “pouvoir suprême”. Castro incarne Cuba à tous les niveaux.
Castro est à la fois l’autorité du sommet et la puissance de la base. p. 212.
Castro parle avec les Cubains pour qu’ils se sentent autorisés à être exigeants, eux aussi, et pour partager la conscience révolutionnaire et l’appartenance à la Nation. Castro conduit les Cubains là “où ils veulent aller”.
Sartre termine cette partie avec l’image dédoublée du dirigeant cubain : Docteur Castro le chef, et Fidel “l’agitateur aux ongles noirs”. Il va l’illustrer par l’histoire d’Huber Matos.
X. Histoire d’Huber Matos
Éléments biographiques sur Huber Matos
Note : ces éléments biographiques sont issus notamment de l’article Huber Matos (1918-2014), révolutionnaire puis dissident cubain, ainsi que d’un entretien avec Huber Matos (voir bibliographie). Ils sont donc un complément au texte de Sartre.
Huber Matos Benítez, né le 26 novembre 1918 à l’Est de Cuba (à Yara, ancienne province d’Oriente, actuellement Granma). Il est décédé en 2014 à Miami en Floride (Wikipédia). Il participe à la Révolution au côté de Castro : les deux hommes entreront ensemble, avec Camilo Cienfuegos, à La Havane en janvier 1959. Après le triomphe de la Révolution, il est nommé commandant militaire de la province de Camagüey. En désaccord avec Castro sur l’abandon d’élections libres, prévues par la Constitution de 1940 et inscrite au programme de la guérilla, ainsi que sur l’emprise des membres de l’ancien parti communiste, alliés tardifs de la Révolution, il présente sa démission le 20 octobre 1959 à Castro en expliquant qu’il ne veut “pas devenir un obstacle à la révolution”. Castro le soupçonne de préparer un coup d’État, et le fait arrêter avec ses officiers le 21 octobre 1959. Il est ensuite jugé et condamné à vingt ans de prisons pour “trahison et sédition”. A sa libération, il part au Costa Rica, où il fonde fonde l’association Cuba indépendante et démocratique. Il s’installe ensuite en Floride où il finira ses jours.
Le duel Castro-Matos n’aura pas lieu
Après son combat avec les rebelles révolutionnaires, Huber Matos fut nommé commandant de garnison. Sartre le décrit comme faisant partie de la “fraction la plus à droite du mouvement clandestin” : Matos souhaite le retour du parlementarisme, autrement dit de représentants du peuple élus par ce dernier.
Il semble avoir été de ceux qui souhaitaient la restauration de l’honnêteté politique et du parlementarisme, quelques aménagements pour soulager les pauvres, peut-être la promesse ou même la mise en route d’une réforme agraire modérée. Sur ces divergences fondamentales — qui s’accusèrent de jour en jour — des conflits personnels ont pu jouer : mais c’est la situation objective qui les porte jusqu’à l’incandescence. Le contrecoup de la Réforme agraire fut la révolte de Matos et de sa garnison. p. 213.
Le soupçon d’une conspiration se porte sur lui quand un dissident de la Révolution, parti aux États-Unis fait des déclarations contre le régime de Castro. D’un côté, Matos aurait des “amis” aux USA, et d’un autre côté, la mise en oeuvre de la politique de la Révolution devenait urgente.
Note : La Réforme agraire consistait dans la redistribution des terres aux paysans, en les confisquant aux grands propriétaires. La famille de Castro faisait partie de ces propriétaires, et la ferme familiale aurait été la première à faire partie de ces terres redistribuées aux paysans cubains.
Devant la nouvelle propagée d’une insurrection de la garnison commandée par Matos, Castro pouvait user de la force en utilisant l’armée rebelle comme une “armée régulière”, mais au risque d’être considéré comme un nouveau tyran, imposant son pouvoir pour “écraser une jeune rébellion”.
Matos était un Cubain comme Castro, et Castro, s’il était une incarnation de la Nation, n’était pas pour autant un “représentant du peuple”, issu légitimement d’une élection.
Non : le duel Castro-Matos n’aurait pas lieu. La Nation seule avait qualité pour juger les insurgés. p. 215
Sartre présente la solution choisie par Castro pour résoudre ce conflit, en reprenant son image dédoublée. Dans un premier temps, le “docteur Castro” intervient avec un discours télévisé : c’est le dirigeant qui s’exprime. Pour le deuxième temps, Castro fixe un rendez-vous sur place aux habitants de Las Villas, lieu de la caserne des insurgés.
La foule fut exacte : elle vit briller dans le ciel un oiseau de feu ; mais le docteur Castro n’était pas dans son hélicoptère : quand celui-ci se posa, Fidel en sortit seul. Il pénétra dans la foule et la foule se transforma ; il l’entraîna devant le portail de la caserne. Derrière les murs, aux meurtrières, il y avait des soldats avec des fusils, le doigt sur la gâchette. Fidel leur tourna le dos franchement et parla. pp. 213-214.
Fidel l’activiste est sur place, pour analyser, expliquer, pour que la foule devienne “l’instance suprême et l’unique juge de Matos”. Il fallait choisir entre la Réforme de la Révolution et une politique plus modérée, comprenant des élections et prenant en compte qu’une partie de la population, ouvriers et commerçants, n’étaient pas concernés directement par la Réforme agraire. Après des heures d’explications, Fidel l’activiste rallia la majorité de la foule à sa cause.
A l’instant où ces masses se fondirent en un peuple, Matos fit ouvrir les portes à deux battants ; le souverain entra, innombrable et majestueux, les soldats se rendirent et Fidel, sans une arme, mit le chef des insurgés en état d’arrestation. pp. 217-218.
Notons les termes très emphatiques utilisés par Sartre, qui a priori n’a pas été le témoin direct des faits.
Huber Matos est jugé par un tribunal de rebelles, qui le condamne à vingt ans de prison. La lourdeur de la peine serait liée aux “amis bavards [de Matos] qui diffamaient le régime à New York, à Washington”. Sartre explique ensuite que Matos “a disparu dans l’indifférence”, et que l’aile droite du mouvement révolutionnaire, qu’il représentait”, fut ainsi isolée. Il termine cette partie sur Huber Matos par une nouvelle déclaration emphatique.
Castro gagnait : ce sourcier n’opérait pas lui-même : il faisait sourdre de partout le pouvoir ; le peuple et Fidel sortirent de l’épreuve renforcés : celui-là découvrit sa force irrésistible, celui-ci s’affirma comme le ferment perpétuel de la souveraineté. p. 218.
Est-ce Moïse, frappant le rocher pour faire jaillir l’eau de source pour étancher la soif de son peuple (Exode 17.1-7), que Sartre a en tête avec cette symbolique du sourcier ? Auparavant, précipitant la chute de Matos, Castro fond les masses en un seul peuple, tel Moïse refermant les eaux de la mer Rouge sur les Égyptiens pour sauver son peuple. Sartre a écrit : “Je parie sur l’homme, pas sur Dieu”, en référence au pari de Pascal sur l’existence de Dieu. Sartre semble ici parier sur un Castro souverain, comme une incarnation divine. Mais Sartre est aussi celui qui passe pour s’être “toujours trompé” (voir bibliographie). Faut-il alors penser avec Jean Daniel, qui déclare : “Il vaut mieux s’être trompé avec Sartre que d’avoir eu raison avec Raymond Aron” ?
XI.
Dans cette dernière partie de l’appendice d’Ouragan sur le sucre, Sartre fait à nouveau le portrait du “révolutionnaire par vocation”, comme se définit Castro.
Ceci n’est pas une expérience
Sartre propose à Castro de présenter le régime cubain “comme une expérience de démocratie directe”. Castro lui répond que ce n’est pas une expérience. Le sens du terme “expérience” doit sans doute être compris ici comme une “expérimentation”, autrement dit la réalisation par un expérimentateur d’une expérience censée produire un phénomène ou un résultat attendu pour confirmer une hypothèse.
Sartre analyse ainsi la réponse négative de Castro : Cuba était prête à “faire sa Révolution”, celle-ci était devenue nécessaire. La seule condition pour que ce changement s’opère était que quelqu’un donne “le départ”. Castro n’était pas un expérimentateur cherchant à vérifier une hypothèse, il était le “starter”. Le signal du départ fut l’assaut contre la caserne de la Moncada, le 26 juillet 1953.
“Je suis révolutionnaire par vocation”
Sartre reprend l’historique de celui qui se déclare “révolutionnaire par vocation”. Enfant, adolescent, étudiant, Castro n’a jamais pu supporter l’injustice sans réagir. Il assimila son injustice personnelle à celle du malheur qui frappait la Nation cubaine.
[…] transformé d’un coup, il fut pour la première fois l’île entière se résumant dans un seul homme et prenant en lui conscience de sa malédiction, il connut qu’il ne se délivrerait pas sans que ses compagnons de chaîne se libérassent. p. 220.
Castro semble ici le prisonnier délivré de la Caverne de Platon, découvrant la véritable réalité et la nécessité de la liberté, puis revenant dans la Caverne pour sauver ses anciens “compagnons de chaîne”. Dans l’Allégorie de la Caverne, le prisonnier devenu philosophe, de retour dans son ancienne geôle, subit un sort funeste en mourant sous les coups de ses “compagnons”, Castro ici sauve le pays, les “masses”, et se sauve lui-même. La vocation de Castro était de fondre “six millions de solitudes en ce État souverain : Cuba”.
“Une abstraction bardée de privilèges”
Mais pour sauver Cuba, il fallait que Castro s’oublie lui-même. Il était le seul à pouvoir accomplir cette tâche.
[…] il était navigateur parce qu’il possédait la première carte abyssale de Cuba. p. 221.
Il avait analysé le “côté obscur” de Cuba, avec ses institutions corrompues et ses tyrans. Il avait perçu les prémices de ce peuple “déjà présent comme négation”. Il devait accomplir la mission de révéler ce peuple à lui-même.
La révolte de Fidel, en cette première phase, visait beaucoup moins renverser le régime qu’à vaincre la résignation p. 222.
Sartre voit pourtant dans cette révolte une perte pour Castro : il oublia de “sauver sa vie”. Retrouve-t-il ici le sort funeste réservé au prisonnier de la Caverne ? Castro avait pris le risque de devenir “par intérim le peuple”. Une fois devenu Nation, il délaissa l’individu qu’il était.
Mais quand il se fut élevé jusqu’à l’unanimité de cette souffrance et de cette souveraineté, le révolté se désintéressa de ses ennuis personnels. Rien de passionnant, il faut l’avouer : le fils d’un propriétaire foncier avait acquis le titre de docteur en droit, s’était marié ; peu après, son ménage brisé, il retrouvait son vieux malaise, ses hargnes ; qu’est-ce qu’on pouvait faire pour lui ? p. 222.
Castro avait voulu à un certain moment “être le premier partout”. Mais en incarnant le peuple cubain, le titre de premier n’avait pas d’autre sens que de le séparer à nouveau de ce peuple “rassemblé en lui”. Il ne lui restait plus qu’à devenir un être abstrait, dont la souveraineté incarnée ne pouvait laisser place au concret de l’individu qu’il avait été. Il était devenu “une abstraction bardée de privilèges”.
Bibliographie
Jean-Paul Sartre, Ouragan sur le sucre ; Ouragan sur le sucre II (appendice), Les Temps modernes, n° 649, 2008 ; L’Être et le Néant.
Aristote, Métaphysique.
Jean-François Bonaldi, L’Histoire m’acquittera.
Jean-Claude Buhrer, Le Crépuscule du Castrisme, Entretien avec Huber MATOS Héros de la Sierra Maestra et figure mythique de la révolution cubaine
Jean de la Croix, La Nuit obscure de l’âme.
Cubania.com, Le long voyage du tabac.
René Descartes, Méditations métaphysiques ; Discours de la méthode.
DK, Cuba, Guia visuales, 2019.
Bertrand Ferrux, Jean Paul Sartre : un engagement cubain.
Fidelcastro.cu, Fidel Castro Ruz : Soldat révolutionnaire.
Paulo A. Paranagua, Huber Matos (1918-2014), révolutionnaire puis dissident cubain.
Virgilio Piñera, Electra Garrigó, Les Solitaires Intempestifs.
Jean-François Poirier, Cuba no ? Cuba si !, L’Humanité, 4 octobre 2008.
Polémica Cubana, Entretien avec Carlos Franqui, commandant de la guérilla et ministre de la culture.
Michel Porcheron, Le rapt de Fangio à Cuba, comme le raconta Maurice Trintignant.
Eugenio Suárez Pérez, La campagne d’alphabétisation : une campagne épique !
Arnaud Tomès, Petit lexique sartrien.
Michel Winock, Sartre s’est-il toujours trompé ?
Voir aussi
Fiche de lecture n° 8 – Sartre, L’existentialisme est un humanisme.
Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Dsirmtcom, janvier 2020.
Source de l’image mise en avant : http://www.gallimard.fr/
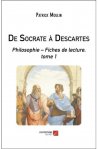

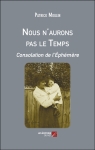


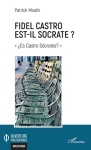
Un commentaire sur “FL – Sartre, Ouragan sur le sucre II (appendice)”