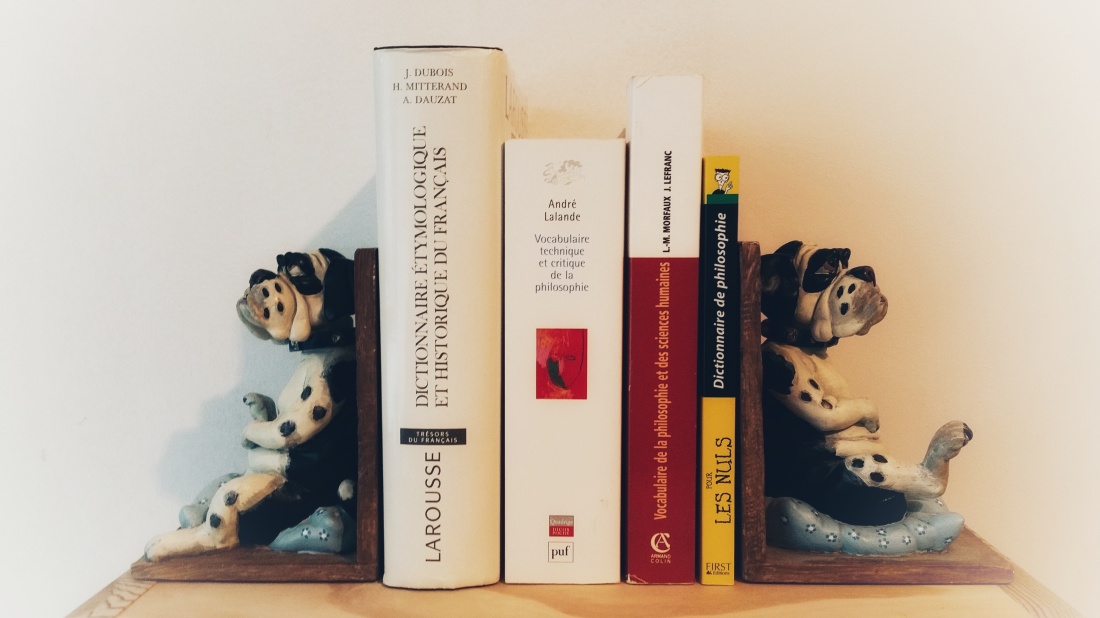
Les leçons de Philosophie – Bac Philo – Partie II. La Raison et le Réel – Fiche n° 1. De quoi parlons-nous ?
Fiche n° 1. La Raison et le Réel – De quoi parlons-nous ?
Étymologie
Larousse étymologique :
[Raison :] latin ratio, rationis, calcul, compte, d’où “faculté de raisonner, raisonnement, motif”, etc. Le français a gardé les principaux sens latins, notamment celui de “motif” (avoir raison, la raison d’une attitude), mais a perdu plusieurs emplois usités en ancien français (raison au sens de “parole, discours”, et au sens de “compte” dans livre de raison, usuel jusqu’au XVIe siècle.
[Réel :] latin médiéval realis, de res, chose.
Gaffiot :
[Ratio, rationis :]
- A. 1. Calcul, supputation. 2. Compte. B. [sens dérivés] 1. Compte des opérations que l’on fait avec quelqu’un, [d’où] relations commerciales, d’intérêts. 2. Calcul, compte, considération, égard. 3. Système, procédé, méthode, plan, etc. 4. Evaluation d’une chose. a) [de ce qui la constitue] sa nature, son espèce, sa manière d’être, ses modalités, son système, son régime, etc. b) [évaluation de ce que comporte, de ce qu’embrasse une chose] son champ, son domaine, sa sphère, son cadre.
- 1. Faculté de calculer, de raisonner, raison, jugement, intelligence. 2. Manière de faire raisonnable, judicieuse. 3. Explication qui rend compte d’une chose, explication, raison. 4. Raison, considération, raisonnement. 5 [Philosophie] argumentation, raisonnement en forme. 6. Ce qui est rationnel, fondé sur la raison, dirigé par la raison. 7. Théorie, principes théoriques, doctrine, système scientifique.
[Res :]
- Chose, objet, être, affaire, fait, circonstance.
- 1. Le fait, l’acte, la réalité. 2. Ce qu’on possède, bien, avoir. 3. Intérêt, avantage, utilité. 4. Affaire, relations d’affaire. 5. Affaire judiciaire, litige. 6. Actes, faits [militaires]. 7. Cause, raison. 8. Res publica, la chose publique, l’État.
Définitions
Lalande :
[Raison :]
- En tant que faculté :
- Faculté de raisonner discursivement, de combiner des concepts et des propositions. […] La Raison est presque universellement considérée, en ce sens, comme le propre de l’homme.
- Faculté de “bien juger”, [Descartes, Méthode, I, 1], c’est-à-dire de discerner le bien et le mal,le vrai et le faux (ou même le beau et le laid) par un sentiment intérieur, spontané et immédiat.
- Connaissance naturelle, en tant qu’elle s’oppose à la connaissance révélée, objet de la foi.
- Système de principes a priori, dont la vérité ne dépend pas de l’expérience, qui peuvent être logiquement formulés, et dont nous avons une connaissance réfléchie.
- Plus spécialement, faculté de connaître d’une vue directe le réel et l’absolu, par opposition à ce qui est apparent ou accidentel.
- En tant qu’objet de connaissance :
- Rapport. “Moyenne et extrême raison. – Raison d’une progression.”
- Principe d’explication, au sens théorique ; raison d’être : ce qui rend compte d’un effet.
- Au sens normatif, cause ou motif légitime, justification.
[Réel :] Qui est une chose ou qui concerne des choses.
- Par opposition à l’apparent, à l’illusoire, au fictif : ce qui agit effectivement ; ce sur quoi l’on peut compter.
- Par opposition au relatif, et en particulier au phénoménal, en tant que celui-ci est conçu, soit comme une relation entre des termes substantiels, entre des choses et un esprit ; soit aussi comme une apparence que revêtent les choses dans l’esprit.
- Dans l’ordre de la représentation, ce qui est actuel, donné : 1° Par opposition soit au possible, soit à l’idéal : les choses telles qu’elles sont, non telles qu’elles pourraient être ou devraient être. 2° Par opposition à la forme de la connaissance, ce qui en constitue la matière.
- Qui concerne les choses et non les personnes. “Droits réels”.
- Qui concerne les choses, et non les mots.
Morfaux :
[Raison :]
- Logique, rationnel, raisonnable. Ratio, qui a d’abord le sens de compte, d’évaluation, d’intérêt commercial, sert en philosophie depuis Cicéron à traduire le grec logos auquel il ne correspond que partiellement (au sens de discours, parole, ce sera plutôt en latin oratio ou verbum).
- Définir l’homme comme animal doué de raison selon la tradition aristotélicienne prolongée jusqu’à nos jours (homo sapiens) revient à articuler une psychologie et une métaphysique. […] On notera la substitution du terme d’intelligence, d’apparence plus positive, plus psychologique, au terme de raison, plus philosophique, métaphysique.
- Raison, intellect, entendement. La raison peut avoir une signification très large, englobante, désignant moins une faculté déterminée que le bon usage des facultés intellectuelles : elle s’oppose alors à déraison ou à démence (du latin mens, esprit). Le plus souvent, la raison est donnée comme faculté de raisonnement discursive, par opposition à une faculté intuitive : latin intellectus traduit par intellect (grec nous).
- Cause et raison. Ce qui dans le monde physique s’appelle cause, dans le monde moral s’appelle raison.
- Raison pratique. La sagesse pratique ou prudence selon Aristote se distingue déjà de la raison proprement dite (logos), mais c’est Kant qui sépare nettement un usage théorique de la raison et un usage pratique qui ne se confond lui-même ni avec un usage technique, ni avec un usage pragmatique (dont relève finalement la prudence). Seule la raison pratique peut fonder la loi morale dans son exigence d’universalité, au-delà de la contingence sociale, historique des valeurs invoquées. Kant affirme ainsi la supériorité de l’usage pratique de la raison sur son usage théorique qui reste limité par les conditions de possibilité de l’expérience.
[Réel :]
- Qui concerne les choses par opposition aux personnes, acception conservée en droit.
- Par opposition à la définition nominale, la définition réelle ou définition de choses énonce l’essence de ce qu’elle définit.
- Qui existe en fait, objectivement, par opposition à ce qui est imaginé, fictif, construit par l’esprit.
Le réel est l’ensemble des objets donnés à la connaissance, en particulier à la connaissance scientifique, sans que celle-ci puisse jamais être exhaustive.
Godin :
[Raison :] Désigne à la fois la faculté, propre à l’homme, de penser avec rigueur et méthode (la rationalité du rationnel) et d’agir selon des principes cohérents et universels (la rationalité du raisonnable). Par ailleurs la raison est l’ensemble des actions produites par ces deux formes, théorique et pratique, de rationalité.
[Réel :] Ce qui appartient au monde extérieur, par opposition au monde imaginaire (ou irréel) forgé par l’esprit humain.
Le réel qualifie ce qui est doué d’une existence objective par opposition d’une part à l’imaginaire, ou l’irréel, et, d’autre part, à l’idéal. L’irréel n’a aucune réalité physique (tel est le cas d’un animal fabuleux), l’idéal est conçu comme supérieur à cette réalité.
En bref/L’essentiel
[Raison :] La raison est le propre de l’homme : elle est la faculté de penser (domaine du rationnel, de la connaissance notamment scientifique) et la faculté d’agir (raison pratique, domaine du raisonnable, du devoir moral. Au sens de motif, la raison est à la philosophie ce que la cause est au monde physique.
[Réel :] Les choses, le monde extérieur qui nous environne ; ce qui existe objectivement. S’oppose à imaginaire, fictif, virtuel.
Thème et notions connexes
| Thème | Notions connexes | Fiches “La Raison et le Réel” |
| La Raison et le Réel | Théorie et Expérience | 1. La Raison et le Réel – De quoi parlons-nous ?
2. De la Raison, du Réel et des hommes |
Voir aussi
Les différents articles du site.
Les Fiches de lecture.
Le Carnet de Vocabulaire Philosophique.
Les Citations.
La Grande Bibliothèque Virtuelle de la Philosophie.
Dsirmtcom, novembre 2019.
4 commentaires sur “Bac Philo – III. La Raison et le Réel – Fiche n° 1. De quoi parlons-nous ?”