Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Philosophie – Fiches de lecture
Fiche de lecture n° 28-2
Introduction – Idée générale de la Morale
Les références des citations indiquent la partie (“Int.” pour Introduction, “MR” pour Morale religieuse, “MI” pour Morale individuelle, “MS” pour morale sociale, “App.” pour Appendice), le numéro de la leçon (I, II, III, etc.), le numéro de la question (1, 2, 3, etc.).
Les quatorze leçons de cette partie traitent : de la Morale (définition générale et Morale pratique) ; des actions humaines, volontaires, involontaires ou contraintes ; de la liberté ; de la Prescience et de la Providence ; des obligations et devoirs moraux ; de la conscience morale ; du bien ; des preuves de l’existence de Dieu ; de l’immortalité de l’âme.
Morale
[La Morale est] la science de nos devoirs, autrement dit celle qui fixe les principes, et établit les maximes régulatrices des actions humaines dans la poursuite et l’accomplissement du bien. Int., I, 1.
La Morale générale traite des principes et des règles de conduite ; la Morale particulière les applique en déterminant les devoirs.
Auteur cité : Socrate.
Actions humaines
[Les actions humaines sont] les actions de l’homme faites avec réflexion et liberté, ou bien, la manifestation extérieure de l’activité intellectuelle de l’homme. Int., II, 8.
La volonté détermine la motivation (instinctive, égoïste, morale) des actions, leur finalité (par passion, intérêt ou vertu), et se détermine elle-même à agir.
Les actions humaines peuvent aussi être involontaires, causées par l’ignorance, ou contraintes (Leçon VI).
Liberté
Le mot liberté dans son acception la plus large, se définit par la faculté ou le pouvoir d’agir volontairement.- Cette définition comprend deux éléments : la détermination de la volonté, et le pouvoir d’agir. La détermination de la volonté est un fait interne, psychologique ou moral, qui est absolument libre dans le sens où ce n’est jamais une nécessité ; mais ce n’est pas pareil dans la manifestation externe de notre volonté ; alors notre pouvoir d’agir est soumis à une multitude de conditions et d’obstacles.- De là la nécessité de considérer la liberté interne [le libre arbitre] comme indépendante de la [liberté] externe. Int., III, 26.
L’existence de la liberté, en tant que libre arbitre, se démontre par la nature humaine, par sa conscience libre, rationnelle, morale , et par “le témoignage de la lignée humaine” dont le sentiment de liberté est un “fait général”.
Auteurs cités : Bossuet, Spinoza (doctrine du “fatalisme”).
Prescience et Providences divines
[La Prescience divine est] un des attributs de Dieu, par lequel il connaît parfaitement toutes les choses futures.- En désignant par le mot Prescience cette connaissance absolue, qu’a Dieu de l’avenir, nous employons un mot imparfait ; alors que pour Dieu, il n’y a pas de futur, tout lui est présent : parce que sa science est absolument actuelle. Int., IV, 33.
[“L’éminent théologien Maret” dit au sujet de la Providence divine :] “Nous ne connaissons pas d’erreur plus triste que celle du système qui, après avoir fait intervenir Dieu dans la création de l’Univers, le laisse alors dans une inaction absolue, abandonnant le monde à lui-même. Ceci est l’erreur du déisme, et il n’y a rien de moins philosophique, ni de plus indigne de Dieu. Le monde créé n’est pas abandonné à ses propres forces : la volonté qui l’a fait naître, le conserve et le développe : la main qui l’a sorti du néant, le soutient au-dessus de ses abîmes : Dieu est, alors toujours présent au monde : toujours il le vivifie, réalisant sans cesse en lui les substances, lui offrant sans cesse ses lois, ses forces, à tous les êtres, son efficacité : enfin, concourant en lui à tous les actes des créatures. La conservation du monde est “rigoureusement parlant une création continue.” Int., V, 37.
Auteur cité : Henri Louis Charles Maret, ecclésiastique et théologien catholique français (1805-1884).
Obligation morale
L’obligation morale est le devoir de conformer ses actions au bien, conçu comme une loi émanant d’une autorité supérieure.
[Différence entre obligation et devoir :] Quand il y a obligation il y a devoir, et quand il y a cela, il y a ceci : la loi nous impose l’obligation, et celle-ci engendre le devoir : l’obligation désigne l’autorité qui lie, et le devoir, le sujet qui est lié. Le devoir suppose l’obligation : nous sommes dans l’obligation de faire une chose, et notre devoir est de la faire. Int. VII, 53.
Les lois morales sont appelées du nom collectif de loi naturelle.
[La loi naturelle est] La suprême raison de Dieu établissant l’ordre naturel du monde, et prohibant son désordre, appliquée sous forme de loi aux actions de l’homme, et promulguée dans son esprit. Cicéron, De Legibus Livre 5, chapitre 6. (Cité par R. S. Casado, Int. VII, 56.)
La loi naturelle est caractérisée par sa justice intrinsèque, son immuabilité et son universalité.
La Moralité des actions humaines
Une action est morale si elle est conforme aux lois morales ou aux règles du devoir.
Les circonstances peuvent modifier la moralité d’une action. Elles sont aux nombre de sept : “la qualité du sujet, la qualité de l’objet dans lequel l’action opère, la finalité de l’action, les moyens employés pour la réaliser, le lieu et le temps dans lesquels elle s’exécute, et l’affection de l’âme la pratiquant.” (Int. VIII, 71).
Conscience morale
[La conscience morale est] la faculté par laquelle l’homme se juge lui-même, apprécie le bien le mal qu’il a fait, et discerne le juste et l’injuste. Int., IX, 73.
Le Bien
[Le Bien peut être considéré] sous trois formes : comme bien réel, sensible et moral. Le bien réel est la réalisation et l’accomplissement du bien ; le bien sensible, le sentiment du bien ; et le bien moral, la conformité des agents rationnels et libres avec le bien. Int. X, 85.
R. S. Casado effectue ici une théodicée – une justification de la bonté de Dieu malgré l’existence du mal dans le monde – sous deux formes. La seconde a pour arguments que les termes de bien et de mal sont relatifs, et que tout être infini est nécessairement imparfait, donc sujet au mal. La première est une synthèse des différentes doctrines philosophiques sur la question du mal, issues des philosophies orientale et grecque antique :
“Pour résoudre la difficulté, la philosophie orientale a imaginé deux Dieux ou Génies, qui ont pris part à la création de l’univers, produisant l’un le bien et l’autre le mal : hypothèse incompatible avec l’immensité et l’omnipotence du Dieu bon.- Parmi les Grecs Platon et ses disciples, ne voulant pas mettre Dieu comme cause, attribuèrent l’origine du mal à l’impuissance des Divinités inférieures, qui après avoir formé le monde, ont présidé à son gouvernement, ce qui ne disculpait pas le Dieu suprême de se servir d’artisans incapables de faire des choses meilleures.- Selon les Stoïques, l’existence du mal doit être attribué à la fatalité, à l’imperfection essentielle de la matière, qu’ils supposaient incréée et éternelle.- Les Épicuriens, attribuant tout au hasard, pensaient que les Dieux demeuraient indifférents aux choses d’ici-bas.- Ces diverses opinions se reproduiront chez les hérétiques, qui suivront l’établissement du Christianisme : ainsi, pendant que les Manichéens rénovaient le dualisme oriental, les Valentiniens apportaient les idées de Platon, et multipliaient dans leur fantaisie les générations des Génies, qui régissaient le monde ; et Pélage proclamait que les maux de ce monde étaient inhérents à la condition naturel de l’homme, et aux prédestinations, sans s’inquiéter de concilier le mal avec la bonté Divine, attribuant ces choses à la volonté purement arbitraire de Dieu.” Int. X, 89, note.
Auteurs cités : philosophie orientale, Platon, Stoïciens, Épicure, Pélage (v. 350 – v. 420), moine ascète breton.
Bien humain
[Le bien humain est] la correspondance entre l’homme et la finalité pour laquelle il a été créé.- Comme créature l’homme a la capacité du bien réel : comme créature sensible, celle du bien sensible : ce comme créature intelligente et libre, celle du bien moral. Int. XI, 91.
R. S. Casado effectue dans cette leçon une revue des différents systèmes philosophiques sur la notion de bien humain.
“[Cette] discordance sur un point aussi intéressant et transcendantal a été à l’origine à divers systèmes sur cela. Les uns, comme Épicure, Hobbes, Helvétius, Bentham, etc., prétendent le réduire à l’utile : les autres le considèrent comme essentiellement distinct de l’utile, certains disent, avec Platon, Zénon, Clarke, Kant, qu’il est ce qui est conforme à la pensée de Dieu, à la raison, à l’ordre, à l’essence et au destin des choses, au jugement de la conscience : et d’autres, avec Adam Smith qu’il est ce qui est propre à provoquer le sentiment de la sympathie, de l’approbation ; d’autres le situent dans la pratique de la vertu.” Int., XI, 93.
R. S. Casado regroupe ces systèmes en trois classes :
Systèmes égoïstes ou utilitaires : le bien est la réalisation de l’intérêt personnel ;
Systèmes sociaux : l’homme existe seulement pour la vie sociale, le bien unique est la société humaine ;
- Systèmes rationnels : les hommes participent d’une raison supérieure, impersonnelle et absolue.
Auteurs cités : Épicure, Hobbes, Claude-Adrien Helvétius (1715-1771, écrivain et philosophe français du courant des Lumières), Bentham, Platon, Zénon, Samuel Clarke (1675-1729, théologien britannique), Kant, Adam Smith.
Démonstration de l’existence de Dieu
R. S. Casado distingue quatre sortes de preuves de l’existence Dieu : physique, historique, métaphysique, et morale.
Les preuves physiques sont dans l’harmonie du monde : L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer / Que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger. Voltaire, Satires (cité dans Int., XII, 101). Dieu est le premier moteur du monde, sa cause active, comme l’énonce Platon, suivi d’Aristote. Dieu comme cause première est la preuve cosmologique (Kant, Aristote).
Les preuves historiques se retrouvent dans la croyance en tout temps – de l’Antiquité à l’âge moderne – et chez tous les peuples – des plus barbares aux plus civilisés -, dans l’existence d’une Cause suprême, d’un pouvoir supérieur aux lois de la nature.
Les preuves métaphysiques se retrouvent chez trois philosophes :
Descartes, avec les idées innées (le terme n’est pas cité explicitement dans les Lecciones) qui nous permettent de concevoir clairement la perfection ou l’infini, même s’ils ne sont pas en nous ;
- L’argument ontologique de Saint Anselme : l’insensé qui refuse de croire en Dieu peut concevoir un Être supérieur à tout ce qui existe, mais alors cet être étant douée de toutes les perfections existe, puisque l’existence est une perfection (cet argument est du même que la preuve ontologique de l’existence de Dieu, défendue par Descartes) ;
- Leibniz défend une preuve métaphysique identique à la précédente :
Elle vient à être la même que celle de Saint Anselme, exposée sous la forme d’un syllogisme: “Un Être dont l’existence peut se déduire de son essence, existe en effet, si cela est possible : Dieu est un Être dont l’existence peut se déduire de son essence ; alors, si “Dieu est possible, Dieu existe”. Int. XII, 106.
Les preuves morales viennent de notre sentiment inné du bien et du juste.
En effet, ce type de bonté et de justice parfaites, que nous concevons, ne peut procéder de l’Être imparfait que nous sommes ; parce que l’idée de perfection ne peut venir de celle de l’imperfection : pourtant, elle a été mise en nous par un Être infiniment bon et infiniment juste. Int. XII, 107.
Les attributs de Dieu sont ses perfections (décrites par Maret et Fénelon) : immuable, éternel, omnipotent, etc.
Auteurs cités : Voltaire, Platon, Aristote, Kant, Descartes, Anselme, Leibniz, Maret, Fénelon.
Immortalité de l’âme
Tout comme les éléments dont sont composés le corps subsistent après la mort physiologique, “comme le démontre la Chimie.” De même l’âme subsiste, ainsi que la personnalité de l’homme doué de conscience.
Trois sortes de preuves démontrent l’immortalité de l’âme :
- Psychologique : horreur de l’idée de la mort, douleur causée par la mort des autres ;
- Métaphysique : jugement de l’âme après la mort, récompensée ou punie “selon ses oeuvres” par la loi morale et la justice ;
- Morale : universalité de la croyance en l’immortalité de l’âme, démontrée notamment par le respect et le culte des morts.
Morale pratique
[La Morale pratique] traite particulièrement des devoirs moraux de l’homme dans leurs différentes circonstances et variétés de situation. Int., XIV, 116.
Les devoirs de l’homme se divisent en trois sortes :
Envers Dieu : adoration, soumission à sa volonté, supplication, culte, obéissance à ses lois ;
- Envers lui-même : conserver et développer sa nature, son âme triple (sensible, intelligente et libre), respecter et faire respecter la liberté en lui-même ;
- Envers autrui :
“L’état social qui est le véritable état naturel de l’homme, établit beaucoup de relations entre lui et ses semblables : chacun de nous est comme le centre d’une triple sphère sociale, “la famille, la nation, l’humanité.” La Morale sociale nous prescrit les règles de conduite, que nous devons suivre dans toutes les circonstances de la vie sociale ; mais son principe fondamental est le respect des droit d’autrui, en d’autres termes, la justice.” Int., XIV, 121.
La Morale pratique se compose de trois parties : Morale religieuse, individuelle et sociale. Celles-ci sont l’objet des parties suivantes.
Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Dsirmtcom, octobre 2020.
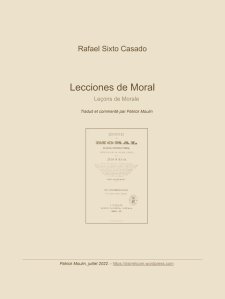
6 commentaires sur “FL – Rafael Sixto Casado, Lecciones de Moral – 2. Introduction – Idée générale de la Morale”