Notes contemplatives de lecture – Note contemplative n° 2
Aucune explication verbale ne remplace jamais la contemplation. Saint-Exupéry, Pilote de guerre.
Notes de lecture
Descartes, ayant à méditer, choisit son désert : la ville la plus commerçante de son époque [Amsterdam]. Il y trouve sa solitude et l’occasion du plus grand, peut-être, de nos poèmes virils : “Le premier (précepte) était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle”. p. 77.
“Savez-vous, dit Napoléon à Fontanes, ce que j’admire le plus au monde ? C’est l’impuissance de la force à fonder quelque chose. Il n’y a que deux puissances au monde : le sabre et l’esprit. A la longue le sabre est toujours vaincu par l’esprit.” p. 111.
Naturellement, c’est une tâche surhumaine. Mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout. p. 113.
Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. p. 114.
L’humanité, aujourd’hui, n’a besoin et ne se soucie que de techniques. Elle se révolte dans ses machines, elle tient l’art et ce qu’il suppose pour un obstacle et un signe de servitude. p. 120.
[Prométhée] Le héros enchaîné maintient dans la foudre et le tonnerre divins sa foi tranquille en l’homme. C’est ainsi qu’il est plus dur que son rocher et plus patient que son vautour. Mieux que la révolte contre les dieux, c’est cette longue obstination qui a du sens pour nous. Et cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure qui a toujours réconcilié et réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde. p. 124.
La pensée grecque s’est toujours retranchée sur l’idée de limite. Elle n’a rien poussé à bout, ni le sacré, ni la raison. Elle a fait la part de tout, équilibrant l’ombre par la lumière. pp. 133-134.
Un fragment attribué au même Héraclite énonce : “Présomption, régression du progrès.” Et, bien des siècles après l’Éphésien, Socrate, devant la menace d’une condamnation à mort, ne se reconnaissait nulle autre supériorité que celle-ci : ce qu’il ignorait, il ne croyait pas le savoir. La vie et la pensée les plus exemplaires de ces siècles s’achèvent sur un fier aveu d’ignorance. p. 135.
Alors que Platon contenait tout, le non-sens, la raison et le mythe, nos philosophes ne contiennent rien que le non-sens ou la raison, parce qu’ils ont les yeux sur le reste. La taupe médite. p. 137.
Nul homme ne peut dire ce qu’il est. Mais il arrive qu’il puisse dire ce qu’il n’est pas. p. 142.
[…] ce qui est nommé, n’est-il pas déjà perdu ? p. 142.
Pour se faire un nom dans les lettres, il n’est donc plus indispensable d’écrire des livres. Il suffit de passer pour en avoir fait un dont la presse du soir aura parlé et sur lequel on dormira désormais. pp. 143-144.
Dès l’instant où l’on dit que tout est non-sens, on exprime quelque chose qui a du sens. p. 148.
Aucun homme n’a jamais osé se peindre tel qu’il est. Au plus noir de notre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l’âme, mais par une fidélité instinctive à une lumière où je suis né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. p. 149.
Le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi, et qu’ils ne l’étaient plus. p. 156.
Élevé d’abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, j’avais commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, les polices, le temps de la révolte. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit : la beauté du jour n’était qu’un souvenir. p. 158.
Un jour vient où, à force de raideur, plus rien n’émerveille, tout est connu, la vie se passe à recommencer. C’est le temps de l’exil, de la vie sèche, des âmes mortes. Pour revivre, il faut une grâce, l’oubli de soi ou une patrie. p. 159.
Car il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. p. 163.
Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible. p. 164.
Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la vertu que j’honore le plus en ce monde. pp. 165-166.
Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais n’être jamais infidèle, ni à l’une ni aux autres. p. 166.
J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les luxes m’ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j’attends. J’attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. p. 169.
Bibliographie
Albert Camus, L’été, Folio Gallimard.
Voir aussi
« Le Syndrome du Funambule », Essai sur le Midi de l’Être, en compagnie de Nietzsche et de Camus.
« Fidel Castro est-il Socrate ? » [à propos de la révolte selon Camus].
Carnet de vocabulaire : Absolu ; Erreur ; Éthique ; Hybris (ou Hubris) ; Justice, Justesse, Juste ; Métaphysique ; Morale ; Nihilisme.
Doctrines et vies des philosophes illustres : Nietzsche.
Fiches de lecture : Camus, Le mythe de Sisyphe ; Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience.
Notes contemplatives de lecture : Camus : L’été ; Le premier homme ; L’Homme révolté ; Noces ; Jacques Chabot, Albert Camus “la pensée de midi” ; Rencontres méditerranéennes, Albert Camus et la pensée de midi ; Robert Antelme, L’espèce humaine ; Marcel Conche, Temps et destin ; Jean Grenier, Les Îles ; Héraclite, Fragments ; Jaspers, Introduction à la philosophie ; Gabriel Marcel, Homo viator ; Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception ; Nietzsche : Ainsi Parlait Zarathoustra I – II – III – IV.
Dsirmtcom, octobre 2020.
Notes contemplatives de lecture
Philosophie, Mardi c’est Philosophie, Contemplation
Camus, L’été


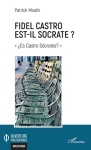
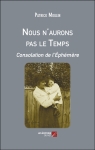

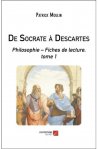

3 commentaires sur “NC – Albert Camus, L’été”