Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Philosophie – Fiches de lecture
Fiche de lecture n° 28-4
Morale individuelle
Les références des citations indiquent la partie (“Int.” pour Introduction, “MR” pour Morale religieuse, “MI” pour Morale individuelle, “MS” pour morale sociale, “App.” pour Appendice), le numéro de la leçon (I, II, III, etc.), le numéro de la question (1, 2, 3, etc.).
Les dix leçons de cette partie traitent : des devoirs de l’homme envers lui-même ; des devoirs de l’âme dans l’ordre de la sensibilité, de l’intelligence, de la volonté ; des obligations relatives au corps ; de l’usage convenable des plaisirs des sens ; de la défense de sa propre vie ; du suicide ; du duel ; de l’éducation.
Devoir de l’homme envers lui-même
Le devoir fondamental de l’homme est l’amour de soi-même, sans tomber dans l’excès de l’égoïsme. Il est un être composé de deux substances, l’âme et le corps, ayant chacune leurs obligations. R. S. Casado expose ainsi la conception du dualisme, sans pour autant citer Descartes, l’un de ses principaux défenseurs.
Les facultés de l’âme sont de “l’ordre de la sensibilité, de l’intelligence et de la volonté” (MI, XIX, 160). La conception d’une tripartition de l’âme est présente, sans reprendre toutefois celle de Platon (fonctions désirante, irascible, raisonnante) ni celle d’Aristote (âme nutritive, sensitive, intellective).
Devoirs de l’âme
L’âme sensible doit cultiver et perfectionner sa sensibilité, en moralisant ses sentiments : c’est la vertu de tempérance. La régulation des désirs par la tempérance consiste : “1.° En ce que tous soient assujettis à l’empire de la volonté, éclairée et dirigée par la raison.- 2.° En ce qu’ils n’excèdent pas en nombre et en énergie les besoins de la nature.- 3.° En ce que le plaisir qui accompagne leur satisfaction, ne se convertisse pas en la fin exclusive des actions.” MI, XX, 166. C’est la doctrine épicurienne qui transparaît ici sans être nommée, avec la classification des désirs naturels, nécessaires ou non, et des désirs vains.
L’âme intelligente doit cultiver et employer légitimement les facultés intellectuelles : c’est la vertu de prudence, qui consiste à discerner ce qu’il faire pour conformer nos actions au bien. Les conditions nécessaires pour exercer la prudence sont “selon ce que dit Cicéron : le souvenir du passé, l’intelligence du présent, et la prévision du futur : ce sont la mémoire, l’attention et la raison.” MI, XXI, 171.
Enfin, l’âme doit incliner la volonté au bien et à la maîtrise de soi-même : c’est la vertu de la force d’âme.
“[La force d’âme se trouve] dans la résignation contre l’inconstance de la fortune : dans la patience [tolérance] des douleurs et des travaux inséparables de notre condition présente : dans la fermeté de ne pas céder aux exigences de ceux qui peuvent nous favoriser ou nous nuire : et dans la promptitude aux sacrifices, pour coûteux qu’ils fussent, quand l’accomplissement du devoir les réclame.” MI, XXII, 182.
La force d’âme, avec ses vices par défaut – la pusillanimité -, et par excès – la témérité -, rappelle la vertu du courage, médiété selon Aristote entre le défaut – la lâcheté -, et l’excès de courage – l’intrépidité.
Auteur cité : Cicéron.
Obligations liées au corps
L’homme doit conserver et perfectionner son corps, “en faisant ce qui correspond pour le maintenir sain, et en s’abstenant de ce qui peut lui nuire.” MI, XXIII, 188. L’âme et le corps sont deux substance si intimement liées “que les deux forment une seule vie, un seul individu, une seule personne.” MI, XXIII, 187.
“Le travail contribue […] beaucoup, parce qu’en nous fournissant la production légitime des moyens de subsistance, il nous empêche de souffrir sans nécessité et sans mérite des conséquences physiques et morales de l’indigence : et parce que l’oisiveté, appelée communément et avec raison mère de tous les vices, nous prédispose à leur succomber, dont les conséquences ne sont pas seulement préjudiciables à la vie de l’âme, mais aussi à celle du corps.” MI, XXIII, 189.
Toutefois, l’excès de travail est contraire à la vertu de tempérance (MI, XXIII, 190).
Les vertus qui conduisent à un “usage convenable des plaisirs des sens” sont la sobriété, la frugalité et la chasteté (MI, XXIV, 191). Les vices qui y sont opposés sont “à la sobriété, l’ébriété : à la frugalité, la gourmandise : et à la chasteté, la luxure ou l’incontinence.” MI, XXIV, 195.
Il existe aussi des excès pour les affections sociales :
“[…] l’estime de soi-même et le désir de l’appréciation d’autrui, deux besoins sociaux de grand profit, tant qu’ils se maintiennent dans les limites de la modération, dégénèrent fréquemment, celle-là en orgueil, et celle-ci en vanité, vices dont le premier est si haïssable, comme est ridicule le second.- L’émulation peut, pervertie, dégénérer en ambition.- La justice exagérée, en sévérité et dureté.- Le soin pour la religion, la patrie et les lettres en fanatisme religieux, politique et littéraire.” MI, XXIV, 199.
Le cas particulier du suicide
Avant d’évoquer le suicide, R. S. Casado expose la situation de légitime défense qui s’inscrit dans les limites de la justice (MI, XXV), et ensuite celle du duel (MI, XXVII). Ce dernier est qualifié de “crime gravissime”, tout comme l’est le suicide. Cette condamnation radicale du suicide, qui peut sembler insupportable à nos yeux de contemporains du XXIe siècle, doit être replacée dans le contexte historique du XIXe siècle, notamment cubain, où la religion catholique condamne le suicide comme un acte de rébellion envers Dieu.
“La raison fondamentale de l’immoralité du suicide [est] que l’homme perturbe l’ordre naturel, détruisant une chose sur laquelle il n’a pas de contrôle : nous sommes usufruitiers de la vie, et en aucune manière propriétaires. L’homme ne peut effectivement s’appuyer sur rien pour se désigner propriétaire de la vie […].” MI, XXVI, 216.
La position rapportée par R. S. Casado est semblable à celle de Kant lorsqu’il évoque le suicide en lien avec l’impératif pratique “Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen” :
[…] selon le devoir nécessaire envers soi-même, celui qui médite le suicide se demandera si son action peut s’accorder avec l’idée de l’humanité comme fin en soi. Si, pour échapper à une situation pénible, il se détruit lui-même, il se sert d’une personne uniquement comme d’un moyen destiné à maintenir une situation supportable jusqu’à la fin de la vie. Mais l’homme n’est pas une chose ; il n’est pas par conséquent un objet qui puisse être traité simplement comme un objet ; mais il doit dans toutes ses actions être toujours considéré comme une fin en soi. Ainsi je ne puis disposer en rien de l’homme en ma personne, soit pour le mutiler, soit pour l’endommager, soit pour le tuer. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, p. 106.
L’argument est ici purement moral (même s’il a des sources religieuses) : nous ne disposons pas de notre corps, parce que l’être humain, nous y compris, n’est pas une chose, et donc n’est pas un simple moyen pour atteindre une fin (l’arrêt d’une situation insupportable par le suicide). Avec la religion, nous ne sommes pas propriétaires de notre propre vie ; avec la morale kantienne, nous ne pouvons pas réduire notre vie à une chose, à un moyen. Dans les deux cas, nous avons le droit de vivre, mais pas celui de disposer de notre vie. Ce type de débat alimente et alimentera encore longtemps les question éthiques dans le domaine de la fin de vie.
L’éducation
L’éducation comprend trois axes principaux : la vertu, l’instruction et la conduite morale (les “bonnes manières”). R. S. Casado explique chacun de ces points :
“Premièrement.- Dieu et son culte, la résignation dans sa volonté et l’obéissance à ses commandements, est le premier objet de notre bonne éducation ;parce qu’il n’y a rien à espérer d’un homme qui se comporte avec soi-même comme suit, qui ne donne pas aux aux ce qui leur doit, s’il ne donne pas à dieu ce qui lui est [dû], et s’il déprécie ses saints commandements. La religion, donc, et l’exercice des vertus morales sont une partie essentielle de la bonne éducation.
Secondement.- Toutes les connaissances, que l’homme peut acquérir selon les circonstances le sont également ; parce que l’homme instruit est très avancé pour juger avec droiture, et par conséquent par un choix certain dans la direction de sa conduite.
Troisièmement.- Ce n’est pas le moindre objet d’une bonne éducation que de s’accoutumer dès l’enfance à traiter les autres avec amabilité et avec respect, selon la qualité et la condition de chacun. L’homme bien éduqué sait comment il doit se conduire avec les supérieurs, avec ses égaux et avec les inférieurs, de façon qu’il n’offense pas, ni qu’il donne à personne des motifs justes de ressentiments et de plaintes.” MI, XXVIII, 237.
L’homme “bien éduqué” se conforme à toutes ses obligations : religieuse, individuelle et sociales. Ce sont les trois parties de la Morale, qui font l’objet des Lecciones, et qui se terminent par la Morale sociale que nous allons voir maintenant.
Sommaire
- Éléments contextuels et Synthèse globale
- Introduction – Idée générale de la Morale
- Morale religieuse
- Morale individuelle
- Morale sociale
- Appendice – Le Christianisme
- Bibliographie
- Texte intégral traduit en français par Patrick Moulin @dsirmtcom
Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Dsirmtcom, octobre 2020.
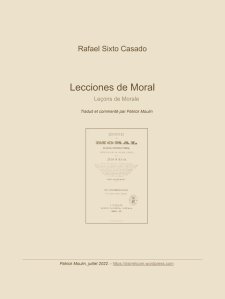
6 commentaires sur “FL – Rafael Sixto Casado, Lecciones de Moral – 4. Morale individuelle”