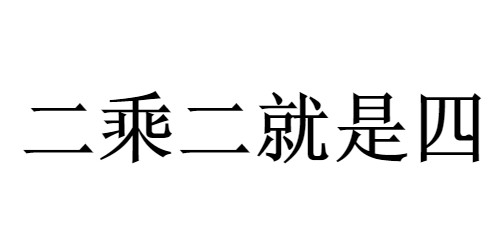
Source : Deux fois deux font quatre (Chinois, traduction Google traduction)
Malebranche – Le Devoir, l’ami et le chien
Malebranche, De la Recherche de la vérité
Je vois par exemple que deux fois deux font quatre, et qu’il faut préférer son ami à son chien ; et je suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne vois point ces vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient point dans le mien. Il est donc nécessaire qu’il y ait une Raison universelle qui m’éclaire, et tout ce qu’il y a d’intelligences. Car si la raison que je consulte, n’était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une raison universelle. Je dis : quand nous rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu’un homme préfère la vie de son cheval à son cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui dans le fond ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison universelle que tous les hommes consultent.
Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité.
Introduction
“Vérité au‑deçà des Pyrénées, erreur au‑delà.” Se pourrait-il, comme l’écrit Pascal dans ses Pensées, que la vérité, et même que notre devoir soit à géographie variable ? Lorsque nous ne nous posons pas de question, dans notre vie de “tous les jours”, il nous semble évident que nous partageons avec nos contemporains certaines vérités, et que nous avons en commun une façon de “vivre-ensemble” qui se fonde sur des devoirs implicites. Certaines vérités sont clairement et distinctement évidentes, dans leur contenu et dans leur application. Mais ce qui est implicite se fonde-t-il véritablement sur une communauté d’esprit ? Et jusqu’où, culturellement ou géographiquement, partageons-nous ce fond commun ? Comment accédons-nous à la vérité qui peut nous éclairer sur le chemin du devoir ? Enfin, la nature de la raison la prévient-elle de tout risque de déraison ?
Les deux voir
Dans le début de ce texte, Malebranche, évoque deux situations qu’il perçoit comme des vérités. La première est mathématique et relève plus précisément de l’arithmétique : la multiplication de deux par deux donne le résultat de quatre. Cette opération simple donne toujours le même résultat, c’est-à-dire la même vérité. Comme Descartes, dont il a étudié la doctrine, Malebranche recherche une vérité qui soit certaine et ne puisse être mise en doute. Le premier précepte de la méthode cartésienne est de ne considérer comme vraie que “ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute” (Discours de la méthode, seconde partie). Sous réserve d’avoir appris l’arithmétique, il est évident, clair et distinct, que lorsque nous multiplions deux par deux, nous obtenons le résultat de quatre à chaque fois. Ce résultat est clair, distinct , indubitable : c’est une chose vraie. Voici comment Descartes explique que la science de l’arithmétique, comme celle de la géométrie, permet de “connaître d’une manière certaine et indubitable” :
On tire évidemment de ces considérations le motif pour lequel l’Arithmétique et la Géométrie sont beaucoup plus certaines que les autres disciplines : c’est qu’elles sont les seules à porter sur un objet si pur et si simple qu’elles n’ont à faire absolument aucune supposition que l’expérience puisse rendre douteuse et qu’elles sont tout entières composées de conséquences à déduire rationnellement. Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, II.
La vérité de l’arithmétique est liée à l’utilisation de la raison : c’est vrai parce que c’est rationnel. La deuxième situation que Malebranche prend pour exemple est donnée comme équivalente à la première en terme de vérité indubitable : “il faut préférer son ami à son chien”. L’utilisation du verbe “falloir” marque la notion d’un devoir. La conséquence rationnelle de la multiplication “2 x 2” est quatre ; le devoir d’agir rationnellement, c’est-à-dire selon la raison, est de préférer un humain à un animal, quand bien même ce dernier fut-il nôtre. Le chien, souvent décrit comme “le meilleur ami de l’homme”, ne peut ni égaler ni être supérieur à l’homme qui est notre ami. Si nous modélisons arithmétiquement les relations homme/ami/chien, l’addition homme + ami donne un résultat supérieur – en raison – à celui de l’addition homme + chien. Ce qui est vrai en arithmétique devient vrai mais aussi nécessaire : il le faut parce que c’est rationnel. Il est de notre devoir de préférer un humain à un animal.
Malebranche avance une autre certitude, qui lui est propre : ces vérités qu’il constate, tout homme peut, comme lui, les constater. L’utilisation de la première personne du singulier – “Je vois” – indique qu’il part de son expérience personnelle, singulière, mais que cette expérience est généralisable à tout homme. Chacun peut ainsi percevoir que deux et deux font quatre, et que notre devoir est d’accorder notre préférence à un humain plutôt qu’à un animal. Il s’agit ici d’une déduction qui peut prendre la forme du syllogisme suivant : Malebranche fait l’expérience de la vérité dans ses deux exemples ; tous les hommes sont comme Malebranche ; tous les hommes peuvent faire l’expérience de la vérité dans les deux exemples qu’il donne. Notons aussi l’utilisation du verbe “voir”. La signification de ce verbe n’est pas celle d’une perception purement physique. Si je regarde la phrase écrite en français “deux fois deux font quatre”, je vois à la fois les lettres qui composent les mots, et je comprends le sens de l’ensemble que forme cette phrase, à l’aide de la “vision” de la raison. Si je regarde la même phrase écrite en chinois “二乘二是四” ou en russe “два раза два четыре”, mes yeux verrons ce qui signifie “deux fois deux font quatre, mais ma raison – sauf à parler chinois ou russe – ne comprendra pas un traître signe de ce qui est écrit. La vision de la raison va sans doute même au-delà de cet exemple simple. Nous sommes plus proches de la “vision de l’esprit”, décrite par Socrate dans le Phédon, qui permet de percevoir la réalité du monde intelligible, bien plus véritable que celle du monde sensible, perçu par la vision physiologique de l’oeil.
L’universelle Raison
Ces vérités dont Malebranche relate son expérience, et dont il déduit avec certitude que chaque homme peut les voir “aussi bien” que lui, demeurent cependant invisibles d’un esprit à l’autre. Que ce soit avec la vision physiologique, comme avec celle de la raison, il n’est possible de constater directement que chacun perçoit les mêmes vérités. Partant de la conclusion d’un premier syllogisme, où il généralise son expérience subjective à celle de tous les hommes, et considérant cette conclusion comme vraie, Malebranche procède à une deuxième démonstration logique. Si tous les hommes peuvent faire la même expérience de la vérité, mais que chacun ne puisse faire que sa seule expérience en tant que sujet, il faut alors que quelque chose de supérieur, ou de commun à chacun, puisse transformer cette expérience subjective, individuelle, en vérité objective et collective.
Aristote définit l’homme comme un animal raisonnable : il est sociable et il est seul à posséder le logos, terme qui correspond à la fois au discours, au langage, et à la raison. Tous les hommes sont doués de raison : voici quelque chose de commun à chacun. Mais il faut encore que ce qui est commun aboutisse au même résultat de vérité. Si nous prenons une population où tous ont un permis de conduire – ce fait leur est commun -, il n’est pas certain que chacun conduise de la même manière son véhicule, ni ne se comporte de façon parfaitement identique au volant. Pour que chacun et tous à la fois perçoivent les mêmes vérités, et les comprennent de façon parfaitement identique, il faut que cette raison spécifiquement humaine soit universelle. Ce qui est universel va s’appliquer à tous de la même manière : quel que soit l’individu, une même situation donnera toujours un même résultat, une même cause donnera toujours le même effet. Malebranche poursuit dans le domaine visuel : la “Raison universelle” va “éclairer” toutes les “intelligences” humaines de la même façon. Il est nécessaire qu’il en soit ainsi, pour que l’expérience singulière soit généralisable et universalisable. Même si nous ne pouvons pas la percevoir dans l’esprit d’autrui, c’est la même Raison universelle qui guide vers la vérité tous les hommes.
Pour apporter une autre preuve que c’est bien la Raison universelle qui nous guide, Malebranche va prendre l’exemple des Chinois. Lors de l’évangélisation de la Chine, des missionnaires français ont apporté des ouvrages de Malebranche, qui ont remporté plus de succès auprès que la philosophie d’Aristote. Trente ans après l’ouvrage De la Recherche de la vérité, Malebranche a publié, en 1707-1708, Entretien d’un philosophe chrétien et d’un philosophe chinois sur l’existence et la nature de Dieu. L’ouvrage a pour objet de confronter les idées de Malebranche avec celles des disciples de Confucius. Il va surtout prendre le parti de la doctrine de Spinoza, mais retenons ici cette volonté de concilier deux modes a priori très différents de pensées. L’intérêt que porte Malebranche aux Chinois le conduit à leur appliquer aussi cette nécessité de la Raison universelle, qui éclaire tout homme, qu’il soit disciple de Confucius ou lecteur assidu de Descartes. La démonstration s’apparente plus à une vérité de La Palice qu’à celle d’une logique indiscutable : si les Chinois n’avaient pas la même raison, ils ne verraient pas les mêmes vérités. Malebranche utilise même une formulation redondante pour son affirmation : “il est évident” qu’il ne serait pas certain de ce qu’il pense. Quoi qu’il en soit, lorsque nous consultons la raison, c’est la même Raison universelle qui nous répond, que nous soyons Chinois ou Parisien (comme Malebranche).
Déraison des raisons particulières de la passion
Après avoir établi cette lumière unique et universelle de la Raison majuscule, Malebranche va préciser d’une part comment nous accédons à cette raison, et d’autre part, ce qui caractérise sa nature. Pour accéder à la Raison universelle, Il utilise le verbe “consulter”, qui vient du latin consultare, avec le sens de prendre conseil, d’interroger, de poser une question en vue d’obtenir une réponse. C’est le même verbe que Platon prendra pour décrire la démarche de Chéréphon, compagnon de jeunesse de Socrate, lorsqu’il va consulter l’Oracle de Delphes pour “lui demander s’il y avait un homme plus sage” que Socrate (Apologie de Socrate). Mais ici, lorsque nous consultons la raison, point n’est besoin de nous rendre au temple d’Apollon, il suffit de rentrer “dans nous-mêmes”. Là où le compagnon de Socrate sollicite un conseil venant de l’extérieur, nous devons aller chercher à l’intérieur de nous-mêmes, pour y trouver la lumière de la raison. Voici pour la première précision concernant l’accès à la Raison universelle.
La seconde précision porte sur la nature de la Raison universelle, et c’est à une analyse différentielle que va s’atteler Malebranche. Il va distinguer la raison intérieure, qui réside “en nous-mêmes” et la raison, qui va s’avérer plurielle, de la passion. Le mécanisme tout d’abord est différent : nous allons d’un côté chercher activement notre raison intérieure, pour la questionner ; de l’autre côté, c’est l’homme va suivre la raison de sa passion, qui va la subir. Le terme “passion” vient du latin passio, de pati, souffrir, subir ; et du grec pathos, qui donnera le mot “pathologie”, qui a trait aux maladies. L’“homme passionné” est passif – la racine étymologique est la même -, il subit ce qui lui arrive, de façon irrationnelle et involontaire. C’est ici une maladie de l’âme ou de l’esprit. Lorsque Malebranche “dit” cette Raison universelle où nous rentrons activement en nous-mêmes, il ne “parle” pas de la déraison involontaire de la passion. Dire, c’est exprimer par la parole ; parler, c’est utiliser cette parole pour exprimer sa pensée. La différence entre ces deux termes se perçoit mieux en mettant en miroir l’expression “parler pour ne rien dire” : “dire pour ne rien parler” serait exprimer une pensée vide. Lorsque Malebranche pose les mots sur la Raison universelle, il exprime que sa pensée ne la confond pas avec les raisons de la passion.
Le second exemple de vérité, évoqué au commencement du texte étudié, que peut voir Malebranche comme tout homme au monde, y compris parmi les Chinois, concerne la relation entre les humains et avec un animal : le devoir nous indique, via la Raison universelle, “qu’il faut préférer son ami à son chien”. Il y a la notion de relations singulières, avec l’adjectif possessif “son” : ce n’est pas n’importe quel humain, ni n’importe quel chien. La préférence, elle, est exprimée de façon générale : ce sont les relations sans autre précision de contexte. Malebranche prend un nouvel exemple, qui fait écho à celui que nous venons de rappeler : il s’agit des relations entre un homme, son cheval, son cocher. Si nous appliquons la même logique de la vérité et du devoir, l’homme doit encore une fois préférer son cocher – un humain – à son cheval, et ce malgré les relations singulières (l’usage à nouveau de l’adjectif possessif “son”). Une précision de contexte intervient : dans cette préférence, il en va de la vie de l’humain ou de l’animal. Si nous poussons ce nouvel exemple jusqu’à l’extrême, l’homme va préférer la mort de son cocher à celle de son cheval. Malebranche nous indique tout de même que cet homme “a ses raisons”. Voici venir la précision sur la nature de la Raison universelle, dans son opposition avec “les” raisons plurielles que suit un homme assurément aveuglé par la passion. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de raison rationnelle, mais de raison de causalité ou de motivation. Ce qui motive l’homme passionné n’a rien de rationnel, ni même de raisonnable : les raisons de la passion “sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur.”
La force qui pousse l’homme à suivre sa passion n’a rien d’universel, et encore moins de rationnel. L’homme passionné ne se soumet pas volontairement à son devoir, obéissant librement devant ce qui est universel et s’applique à tout humain rationnel. La nature des raisons qui entraîne l’homme passionné n’est pas de l’ordre de la raison. Ce qui est raisonnable peut être raisonné ; ce qui est passionnel n’est pas accessible au rationnel, parce que fondamentalement différent. Il est ainsi conforme à la Raison universelle de préférer son ami à son chien, son cocher à son cheval – surtout s’il s’agir d’une question de vie ou de mort. Cela est conforme à notre devoir d’être humain. Si, dans notre recherche de la vérité, nous voulons être à la fois sujets et acteurs, et ne pas obéir aveuglément à ce qui relève de la déraison d’un sujet assujetti, inféodé à la passion, il nous faut nous soumettre à une seule souveraineté : celle de la Raison universelle, aussi vrai que deux fois deux font quatre.
Conclusion
La vérité mathématique est des plus évidentes, et ainsi en va-t-il également du devoir qui nous fait choisir l’humain avant toute autre chose. Ces vérités invisibles pour les yeux physiques, et même pour ceux de l’esprit, démontrent notre communauté de raison. Si pour Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée, c’est la Raison universelle qui, pour Malebranche, éclaire chacun de nos actes, et nous fait parvenir à la certitude. Cette raison universelle, comme son nom l’indique, est partagée entre tous les hommes, qu’ils viennent de Chine ou de France. C’est en entrant en nous-mêmes, par une recherche active que nous pourrons alors consulter cet oracle intérieur que nous possédons tous. Mais la Raison n’a pas de déraison que la raison ne puisse reconnaître. Les raisons de la passion n’ont rien de raisonnable. Loin des difformités irrationnelles, la seule conformité qu’il nous faut rechercher, pour trouver la vérité et accomplir notre devoir, est celle de la “souveraine raison” ou “Raison universelle”.
Voir aussi
Les différents articles du site.
Le Bac Philo.
Les Fiches de lecture.
Le Carnet de Vocabulaire Philosophique.
Les Citations.
La Grande Bibliothèque Virtuelle de la Philosophie.
Dsirmtcom, juillet 2020.
#Philosophie #MardiCestPhilosophie #BacPhilo #Morale #Devoir #Platon #Bible #Kant #Jonas #Malebranche