Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Philosophie – Fiches de lecture
Fiche de lecture n° 28-5
Morale sociale
Les références des citations indiquent la partie (“Int.” pour Introduction, “MR” pour Morale religieuse, “MI” pour Morale individuelle, “MS” pour morale sociale, “App.” pour Appendice), le numéro de la leçon (I, II, III, etc.), le numéro de la question (1, 2, 3, etc.).
Les dix-neuf leçons de cette partie traitent : des devoirs sociaux ; de la justice (devoirs, obligations envers autrui, envers ses biens, envers ses opinions, charité, bonne volonté, bienveillance, aumône, gratitude) ; de la propriété ; des contrats ; de la société et de ses différentes formes ; des obligations des citoyens et du patriotisme.
Les devoirs sociaux
Les obligations morales envers autrui sont de l’ordre de la justice et de la charité. Les préceptes moraux qui résument ces obligations sont : pour ce qui est prohibé, “Ne fais pas à autrui, ce que tu ne voudrais qu’on te fasse à toi-même” ; pour ce qui est commandé, “Fais aux autres, ce que tu voudrais qu’on te fasse.” (MS, XXIX; 244). Ces obligations morales sont à comparer avec l’impératif pratique de Kant, déjà évoqué plus haut avec le cas du suicide :
Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais comme un moyen. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs.
Les devoirs sociaux se fondent sur l’égalité naturelle entre tous les êtres humains.
La justice
[La justice est] une vertu par laquelle se donne à chacun ce qui lui est dû, et [par laquelle] se respectent les droits d’autrui. MS, XXX, 246.
La différence entre les droits et les obligations est la suivante :
“La loi morale dans ce quelle ordonne à chaque homme qu’il accomplisse sa fin pour laquelle Dieu l’a placé sur la terre, établit les obligations ; dans ce qu’elle ordonne à tous de respecter comme une chose sacrée, comme son commandement l’accomplissement de cette fin, crée les droits. Par exemple, conserver ma propre vie, est mon obligation ; empêcher que d’autres l’offensent est mon droit.” MS, XXX, 247.
La vertu de la justice est indispensable pour établir et conserver une société humaine (248). Elle se divise “en morale et civile, commutative et distributive, explétive et attributive.” (249 et suiv.). Elle peut aussi être classée en obligations relatives à la personne, aux biens et à l’opinion de nos sembles (257).
Obligations envers autrui, envers ses biens et ses opinions
Les obligations envers les autres hommes sont de respecter l’intégrité de leur corps, ce qui constitue leur âme (sensibilité, raison, volonté), et leur “liberté naturelle”, qui se définit ainsi :
Ne pas restreindre le droit qu’a naturellement tout homme de disposer de lui-même et de ses actions, que toujours autrui ne soit pas lésé dans son usage légitime de l’exercice de cette liberté. MS, XXXI, 259.
Nous avons vu que les devoirs sociaux se fondent sur l’égalité naturelle : l’homme est donc naturellement libre, et égal par nature à ses semblables. Il ne manque plus que la notion de fraternité pour établir une devise républicaine. Cette dernière sera évoquée dans l’appendice.
Le comble de la transgression de l’obligation de respecter la liberté naturelle de l’homme est l’esclavage (MS, XXXI, 260). L’esclavage est “l’aliénation de la liberté naturelle de l’homme en faveur d’un autre homme, et l’état qui résulte de ceci.” MS, XXXI, 261. A Cuba, l’esclavage sera aboli officiellement en 1886.
L’obligation envers leurs biens consiste à respecter ce qui leur appartient, ce qui est leur propriété. Le titre de propriété le plus juste est “Le travail employé à la production d’un objet” (MS, XXXII, 274).
Propriété et contrat
L’acquisition de la propriété se fait avec ou sans contrat.
Les modes d’acquisition sans contrat sont : “l’occupation, l’accession, l’héritage, la donation et la prescription.” (MS, XXXIII, 277).
Les contrats sont “L’accord volontaire entre deux ou plusieurs personnes; les obligeant naturellement et civilement à donner ou à faire quelque chose.” (MS, XXXIV, 285).
L’usure – le prêt avec intérêts visant un profit – est prohibée car contraire au principe d’égalité.
Les offenses contre l’opinion de nos semblables ‘commérage, calomnie) sont condamnées.
Charité, bonne volonté et bienveillance
La charité est “une vertu surnaturelle pour laquelle nous aimons Dieu pour lui-même dans toutes les choses, et le prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu.” (MS, XXXVII, 303). Elle comporte les devoirs de bienveillance et de bientraitance. Les obligations de la charité sont “la générosité, la clémence, la compassion, la tolérance, l’indulgence et l’urbanité.” (MS, XXXVIII, 313).
L’aumône est “le don qui se fait à une personne nécessiteuse, sans plus d’objet que de satisfaire une dette d’humanité et sans autre incitation que celle de sentiments charitables.” (MS, XXXIX, 321).
Les autres obligations envers notre prochain sont “ la gratitude, l’accomplissement des promesses, le serment et la bonne foi.” (MS, XL, 329).
L’état social
Le fondement des relations humaines est “l’état social”, qui est “la situation morale qui résulte par effet de quelque association humaine, formée et régie par des lois.” (MS, XLI, 338). L’état social est le véritable état naturel de l’homme.
“[…] rien n’est plus faux que le prétendu état de nature, imaginé par certains philosophes, comme Hobbes, Spinoza et Jean-Jacques Rousseau, et dans lequel les hommes auraient vécu isolés entre eux, sans lois, sans gouvernement, sans religion, en un mot, sans lien d’aucun genre.- Cette doctrine non seulement est démentie par l’expérience et par l’histoire, mais elle est aussi inadmissible comme simple hypothèse scientifique, parce qu’elle implique une contradiction, et se détruit elle-même.” MS, XLI, 340.
R. S. Casado critique la position de certains philosophes sur un “prétendu état de nature” dans lequel l’homme aurait vécu isolé socialement et politiquement. Reprenons synthétiquement les positions des trois auteurs mis en cause.
Thomas Hobbes (1588-1679) décrit l’état de nature comme un état de “guerre de tous contre tous”, reprenant la phrase de Plaute “L’homme est un loup pour l’homme”. Les hommes ne sont pas naturellement disposés à vivre en société. C’est l’instinct de conservation qui les gouverne. Et c’est pour le seul motif de cette conservation qu’ils concluent un pacte social pour faire cesser cet état de guerre.
La nature, c’est-à-dire l’instinct de conservation, guidé par la raison, enseigne donc qu’il faut, pour notre conservation, chercher la paix si on peut l’obtenir ; pour cela, il faut cesser de vouloir exercer son droit sur toute chose. Les hommes sont donc, par la loi de la nature et la raison, portés à faire entre eux des contrats […]. Le pacte, ou promesse d’observer le contrat, a donc pour seul motif notre conservation […]. E. Bréhier, Histoire de la philosophie, pp. 848-849.
L’état de nature selon Hobbes n’est donc qu’une simple étape avant l’état social, et l’homme est malgré tout soumis à une loi, celle de la nature. Les hommes, dans cet état de nature, ne sont donc pas véritablement isolés – puisqu’il se font la guerre -, ni totalement dépourvu de loi – celle de la nature, et la raison qui s’y ajoute.
Chez Spinoza, l’état de nature se déploie au sein de la vie sociale :
L’état de nature semble plutôt renvoyer à la situation dans laquelle se trouvent les hommes lorsque leurs passions sont livrées à elles-mêmes. T. Ménissier, La philosophie politique de Spinoza, 5 : les hommes dominés par les passions.
L’homme serait donc en même temps à l’état de nature – par ses passions – et à l’état social. La passion liée à l’état de nature ne peut s’exprimer que dans un état social, donc non isolé d’autrui. L’homme serait naturellement social ou socialement naturel. Il n’y aurait donc pas de distinction entre ces deux états, telle que relevée par R. S. Casado.
Enfin, chez Rousseau, c’est bien dans une sorte d’expérience de pensée qu’il envisage l’état de nature. Il s’agit d’une hypothèse de droit, mais non de fait.
Commençons d’abord par écarter tous les faits, par ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles ont peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels ; plus propres à éclaircir la nature des choses, qu’à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
Ce n’est donc pas une doctrine absolue, ni une “simple hypothèse scientifique” que décrit Rousseau, mais bien un effort d’imagination. Voilà comment il décrit son expérience de l’homme à l’état de nature, à la première personne du singulier :
Je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et voilà ses besoins satisfaits. Ibid., première partie.
C’est presque un rêve romantique que nous narre Rousseau, évoquant un Baloo du Livre de la Jungle fredonnant : “Il en faut peu pour être heureux !”. Plus sérieusement, c’est un cadre de travail, où il va développer sa théorie sur l’inégalité entre les hommes, et l’évolution possible des sociétés humaines. L’homme est toutefois bien décrit dans un passé, non défini, seul et sans loi. La confusion avec une affirmation d’une période historique où l’homme a été isolé de ses semblables et de toute règle positive ou de toute loi non naturelle.
La critique de l’état de nature que fait R. S. Casado est donc à la fois en partie recevable sur le fond et surtout explicable sur ses écarts d’interprétation par la forme : la base documentaire dont il disposait était sans doute important, mais limité à la caractéristique d’une île des Caraïbes, distante des ressources physiques de “l’Ancien monde”, au XIXe siècle. Qui plus est, même si le premier professeur de José Martí parlait plusieurs langues, dont le français, il a pu être confronté à quelques écueils de traduction.
Auteurs cités : Hobbes, Spinoza, Rousseau.
Diverses formes de sociétés
La société conjugale se constitue “par le consentement mutuel de l’homme et de la femme de vivre toujours unis, pour procréer des enfants, les éduquer, et augmenter leur propre bonheur avec l’amour et les services réciproques.” MS, XLII, 344.
La société paternelle (espagnol “paterna”) se fonde sur “l’obligation naturelle qu’ont les parents d’éduquer leurs enfants ; obligation qu’ils contractent par le simple fait d’être parents de créatures essentiellement morales.” MS, XLIII, 355.
La société hérile (du latin herilis, du maître, ou de la maîtresse) ou dominicale (du latin dominicus, qui appartient au maître de maison, domus) est constituée par le maître et les domestiques qui sont à son service dans sa maison. La société hérile se différencie de l’esclavage (MS, XXXI, 260, 261) par les obligations maître envers ses domestiques :
Traiter les domestiques avec la considération due à l’homme : être attentif à ce qu’ils soient instruits de leurs devoirs moraux et religieux, et qu’ils les accomplissent : et les protéger, non seulement pendant qu’il reçoit d’eux les services auxquels ils sont obligés, mais aussi jusqu’à ce que, après avoir épuisé leurs forces par l’âge ou par les maladies, ils soient incapables de les continuer [les services]. MS, XLIV, 365.
Société civile ou politique
La leçon XLV sur la société civile présente, sans les citer, des liens avec les doctrines de Rousseau et Montesquieu. Nous mettrons en “Lumières” les passages concernés.
La société civile ou politique est “la réunion de beaucoup de familles constituées sous un même régime public, afin de pourvoir au mieux au bien-être commun.” MS, XLV, 367.
Dans cette leçon, R. S. Casado distingue les différentes dénominations de la société politique :
“Elle s’appelle nation, pour exprimer la communauté d’origine entre les associés : peuple, pour dénoter la continuité de territoire, qu’ils occupent : et État, pour signifier la communauté de lois, avec lesquelles ils sont gouvernés.” MS, XLV, 368.
La comparaison avec les définitions données par Rousseau de la personne morale que constitue la société politique permet de voir des similitudes ou des complémentarités :
Cette personne qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chapitre VI “Du pacte social”.
La notion de “citoyen” est exposée dans l’ultime leçon (XLVII), avec celle de patriotisme. R. S. Casado reprend auparavant une classification des États selon leur forme de gouvernement. Il en distingue deux espèces principales : “la monarchie et la république” (MS, XLV, 369). A la différence de Montesquieu, qui compte trois espèces de gouvernement – le républicain, le monarchique, et le despotique (De l’esprit des lois, Livre II, 1).
Monarchie et despotisme
Selon R. S. Casado, le gouvernement despotique est une forme du gouvernement monarchique. Voici les définitions de ce dernier :
“Le gouvernement monarchique est celui où un seul individu règne en toute autorité, et prend le nom d’Empereur, Roi, Tsar, Sultan, etc. Il [le gouvernement monarchique] peut être électif, héréditaire, modéré, constitutionnel, absolu, despotique et tyrannique.- Électif, quand la nomination du Souverain dépend de la nation.- Héréditaire, quand il revient par succession d’individus de la même famille.- Modéré, quand le Souverain se trouve limité par quelque institution dans l’exercice de son pouvoir.- Constitutionnel, quand le pouvoir [du] Souverain est limité par un pacte national des principaux représentants de la nation.- Absolu, quand le Souverain a le droit de dicter ses lois arbitrairement.- Despotique, quand il abuse de ce pouvoir, en disposant à sa volonté des propriétés, de la liberté et de la vie de ses vassaux.- Tyrannique, quand le souverain a usurpé le trône.” MS, XLV, 370.
Comparons ici ces définitions avec celles de Montesquieu :
[Le gouvernement monarchique est] celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Op. cit.
La différence entre monarchie et despotisme tient à l’autorité des lois : respectées et suivies dans la première, ignorées et bafouées dans le second. On retrouve chez Montesquieu la déclinaison faite par R. S. Casado de la monarchie comme gouvernement modéré, et du despotisme comme gouvernement corrompu en lui-même, et pratiquant l’abus de pouvoir. Selon l’auteur de L’esprit des lois, le principe du gouvernement despotique est la crainte :
Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s’estimer beaucoup eux-mêmes seraient en état d’y faire des révolutions. Il faut donc que la crainte y abatte tous les courages, et y éteigne jusqu’au moindre sentiment d’ambition.
Un gouvernement modéré peut, tant qu’il veut, et sans péril, relâcher ses ressorts. Mais lorsque, dans le gouvernement despotique, le prince cesse un moment de lever le bras ; quand il ne peut pas anéantir à l’instant ceux qui ont les premières places, tout est perdu […]. Op. cit., Livre III, 9.
R. S. Casado évoque le despotisme dans la Leccione XVIII sur la prière, avec les grâces temporelles concernant le “despotisme des Princes qui oppriment les peuples”. Nous avions envisagé le contexte historique cubano-hispanique : c’est la situation de Félix Varela, partisan de l’indépendance de Cuba et de l’abolition de l’esclavage, député aux Cortes de Madrid, et condamné à mort vers 1823, après la prise de pouvoir de Fernando VII, monarque absolu ayant tous les traits du despote. D’autres événements sont historiquement proches de ce contexte cubain. Un siècle avant la publication des Lecciones, la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776 argumente leur droit d’être des États libres et indépendants par leur volonté de se dégager “de toute obéissance envers la couronne de Grande-Bretagne” par les injustices répétées du “tyran” britannique :
Mais lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd’hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L’histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l’histoire d’une série d’injustices et d’usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l’établissement d’une tyrannie absolue sur ces États. Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776.
Une colonie du Nouveau monde qui souffre du joug d’une monarchie devenue despotique, qui veut s’en libérer et proclame son indépendance. La situation des États-Unis d’Amérique de 1776 se reproduit à Cuba en 1902 lorsque cette dernière accède enfin à son indépendance. Mais l’île connaît déjà en 1868 – un an après la publication des Lecciones – une première étape, avec le “Cri de Yara”, la proclamation de l’indépendance cubaine, et de l’abolition de l’esclavage, par Carlos Manuel de Céspedes. Celle-ci marque le début de la première guerre d’indépendance des “Dix ans”. Il en faudra encore deux autres, et c’est durant la troisième guerre d’indépendance que José Martí perdra la vie, le 19 mai 1895. La classification du despotisme comme une forme secondaire de la monarchie, dans les Lecciones, prend sans doute son origine dans cette évolution similaire des monarchies espagnole et britannique, vers un despotisme toujours plus affirmé envers leurs colonies.
République démocratique et aristocratique
“Le gouvernement républicain est celui dans lequel le pouvoir suprême est accessible à quelques individus de la société ou à tous. Il peut être aristocratique, démocratique et aristo-démocratique.- Aristocratique, c’est celui dans lequel le pouvoir réside dans certaines classes ou familles privilégiées.- Démocratique, quand le pouvoir est exercé par le peuple sans aucune exclusion de classe.- Aristo-démocratique, quand le pouvoir réside, non seulement dans une classe privilégiée, mais aussi dans le peuple par l’intermédiaire de ses représentants.” MS, XLV, 371.
Les deux formes démocratique et aristocratique du gouvernement républicain se retrouvent à l’identique chez Montesquieu :
Lorsque dans la république, le peuple en corps à la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une aristocratie. Op. cit., Livre II, chapitre 2.
L’auteur de L’esprit des lois ne fait pas mention expresse d’un régime mixte aristo-démocratique, mais il y fait allusion, en prenant notamment l’exemple de la République d’Athènes durant l’Antiquité :
Dans l’État populaire, on divise le peuple en de certaines classes, […] Solon divisa le peuple d’Athènes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus : et, laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut que, dans chacune de ces quatre classes, on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats. Ibid.
L’anarchie
Avant de passer à l’étude des lois, considérées comme essentielles pour tout gouvernement, R. S. Casado expose la situation d’un État sans lois : l’anarchie, terme issu du grec anarkhia, et composé du privatif a[n], et de arkhê, commandement.
“La confusion et la destruction de l’ordre légal établi, occasionnées par l’ambition d’individus et de partis, qui usurpent alternativement le pouvoir suprême.- Quand cette usurpation est promue par des familles privilégiées, elle s’appelle ochlocratie ; et quand [elle est promue] par le peuple, démagogie.” MS, XLV, 372.
Notons qu’il n’y a pas une absence totale et stricte de commandement dans la description faite ici de l’anarchie, mais plutôt l’usurpation du pouvoir par un groupe d’individus ou par l’intermédiaire d’un peuple. Une véritable anarchie correspondrait à “l’absence d’État, de pouvoir politique dans une société” (Morfaux). Le terme “ochlocratie” vient du grec oklokratia, formé de ockhlos, la masse ou la foule, et de kratein, dominer. En voici la définition :
Régime livré à la domination des mouvements de foule, forme dégénérée de la démocratie (le “pouvoir dans la rue”). Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines.
Cette notion de “pouvoir dans la rue” ne correspond pas véritablement à une usurpation “par des familles privilégiées”, qui se rapproche plutôt de l’oligarchie, ce “système politique dans lequel la souveraineté est détenue par un petit nombre d’individus ou des familles” (Morfaux). La suite de cette définition peut nous éclairer :
[…] généralement, l’oligarchie gouverne, non dans l’intérêt commun, mais dans son propre intérêt, et tend à la perpétuation d’un statut privilégié pour ses membres. Morfaux, Op. cit.
Sans pouvoir déterminer si R. S. Casado avait une intention sous-jacente, ou un message caché dans ce paragraphe sur l’anarchie, voici deux éléments de contexte qui permettent d’initier malgré tout un questionnement.
Le premier élément est lié au despotisme. De 1834 à 1838, Miguel Tacón, militaire espagnol, a été gouverneur de Cuba. Il fut considéré comme un despote par les Cubains, en particulier par les “Créoles”, nom donné aux Espagnols nés à Cuba.
Il est dit de Tacón qu’il fut un despote qui gouverna par “talonnades” [“taconazos”, jeu de mots en espagnol avec le nom de Tacón, qui signifie “talon”] : il a réprimé durement les conspirations […], exilé José Antonio Saco [sociologue, journaliste, opposant à l’esclavage et partisan de l’identité nationale cubaine], il a empêché la restauration de la Constitution de 1812, a réussi à expluser les députés cubains des Cortes en 1837, il a recommandé avec succès que Cuba soit considérée comme une colonie et non comme une province de l’Espagne, a exclu tous les Cubains des charges publiques et à démontré qu’un gouvernement autonome à Cuba serait utopique. R. E. Chao, Raíces cubanas.
La Constitution de 1812, promulguée à Cadix, est la première constitution espagnole, qui a établi une monarchie constitutionnelle, autrement dit une monarchie modérée, comme celle décrite dans la classification des gouvernements présentées dans les Lecciones. Miguel Tacón était donc un fervent opposant de tout pouvoir constitutionnel, même monarchique, et de tout ce qui pouvait s’apparenter à un début d’autonomie des Cubains, y compris dans les simples emplois publics. Cuba devait être gouverné par un petit nombre d’Espagnols, ayant ainsi un privilège de statut et donc de pouvoir, pris aux dépens du peuple cubain. L’usurpation du pouvoir suprême, promue par des familles privilégiées : c’est l’ochlocratie, la domination de la masse.
Le second élément tient au “pouvoir de la rue”. A partir de 1863, et jusqu’en 1895, date de début de la troisième guerre d’indépendance de Cuba, des jeunes partisans indépendantistes se sont réunis à La Havane, sur les trottoirs du Gran Café El Louvre. Ces jeunes créoles qui ont organisé des réunions patriotiques, engendrant des conflits avec les autorités espagnoles, étaient connus comme les Muchachos de la Acera del Louvre. Beaucoup d’entre eux ont rejoint ensuite l’armé de libération de Cuba. La “destruction de l’ordre légal établi”, occasionnée par l’ambition de ces jeunes partisans, est née de ce peuple cubain : c’est toujours l’ochlocratie, mais perçue plutôt du côté des colonisateurs. “L’usurpation” du pouvoir devient ici la rébellion contre celui qui l’a véritablement usurpé. Il est très vraisemblable que Rafael Sixto Casado, habitant et travaillant à La Havane, ait eu connaissance du mouvement des Muchachos de la Acera del Louvre. Mais il était sans doute difficile, dans les Lecciones de moral, de parler ouvertement d’une future indépendance de Cuba, émanant de sa propre jeunesse, de ce “pouvoir de la rue” qu’il fallait sans doute mieux qualifier d’anarchie. Le terme utilisé pour décrire cette promotion de l’anarchie par le peuple est la “démagogie”. Il vient du grec dêmagôgia et est formé de agein, l’art de conduire (comme dans “pédagogie”), et de dêmos, le peuple, le tout dérivant de dêmagôgein, qui signifie “amener le peuple à soi” (Morfaux). Le colonisateur verra les démagogues comme des flatteurs du peuple ; le partisan de l’indépendance verra dans cette “démagogie, la jeunesse cubain qui conduit le peuple à renverser l’ordre établi, pour accéder enfin à la liberté.
L’esprit des lois
Les lois sont les conditions essentielles et nécessaires de tout gouvernement. R. S. Casado utilise la métaphore du “corps politique” en décrivant les lois comme les muscles qui unissent et rassemblent les membres de cette société qui ne peut exister sans elles. Cette métaphore se retrouve chez Rousseau, ainsi que la notion de conservation induite par les lois : cette leçon s’intitule en effet “Conservation des sociétés politiques.”
Par le pacte social nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. Rousseau, Du contrat social, Livre II, chapitre VI “De la loi”.
Notons la distinction entre les lois naturelles et les lois de la société politique. Les premières sont définies dans les leçons sur la Morale : les lois constitutives de l’obligation morale se dénomment “plus communément les lois naturelles, et avec un nom collectif, la loi naturelle.” (Int., VII, 54).
Les lois des sociétés politiques dérivent donc bien de cette nécessité d’établir des lois pour organiser et conserver ces sociétés humaines, après les avoir fondées. Ces lois, établies par les humains, sont dénommées “lois positives” par Montesquieu (Op. cit. I, 3).
En voici la définition :
“[La loi est] un précepte commun, juste, dirigé vers le bien public, imposé par l’autorité suprême de l’État, promulgué et sanctionné.- Il s’appelle précepte, parce qu’il produit une obligation : commun, parce qu’il oblige tous sans aucune exception : juste, parce qu’il doit être fondé sur la loi naturelle : promulgué, pour qu’il soit connu de tous : et sanctionné, avec des récompenses pour ceux qui les observent, et des châtiments pour ceux qui les enfreignent.” MS, XLVI, 375.
Les lois se divisent en lois civiles, criminelles, administratives et politiques. Ces dernières déterminent la forme du gouvernement et la répartition des pouvoirs.
Citoyens, société et patriotisme
Les citoyens sont les membres de la société civile. Le corps moral qu’ils forment en s’associant est appelé peuple (MS, XLVI, 381). Ceci est à comparer avec les définitions données par Rousseau, dont s’inspire R. S. Casado :
A l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particuliers citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. Rousseau, Du contrat social, LIvre I, chapitre VI “Du pacte social”.
R. S. Casado attribue la même origine que Rousseau au terme “citoyen” : il vient de la Cité antique, “les citoyens font la cité” (Rousseau; Op. cit.).
Les devoirs des citoyens sont d’obéir aux lois, de respecter l’autorité de l’État, de coopérer au bien commun, d’aimer la société à laquelle ils appartiennent, d’être prêts à se sacrifier pour la défendre. (MS, XLVII, 382).
Le patriotisme est “la fidélité dans l’accomplissement des devoirs sociaux, spécialement dans les occasions, où pour les accomplir il faut faire des sacrifices coûteux.” MS, XLVII, 383. Cette conception du patriotisme correspond à celle de Félix Varela, prêtre du Seminario de San Carlos, et penseur philosophique cubain majeur. Dans son ouvrage principal, Miscelánea Filosófica, Félix Varela consacre un chapitre complet au patriotisme. Il le décrit comme l’amour de la patrie, fondé dès l’enfance, et le compare à l’amour pour une mère. L’homme doit défendre sa patrie contre celui qui la méprise. L’ouvrage est publié en 1819, alors que Cuba est encore sous domination de la couronne espagnole. R. S. Casado, comme Félix Varela, introduit doucement la notion de patriotisme, avec l’amour du pays où l’homme est né – en sous-entendant Cuba et non l’Espagne -, et la volonté de défendre cette patrie lorsqu’elle est mise en danger. Les termes restent prudents, puisque l’indépendance cubaine est encore loin. Ils préfigurent pourtant le “Patria o muerte” [“La Patrie ou la mort”] des révolutionnaires de Fidel Castro des années 1950, et avant lui le sacrifice de José Martí en 1895, au début de la troisième guerre d’indépendance.
Les lois positives doivent s’appuyer sur les lois morales, autrement dit, la société politique doit se fonder sur la Religion. Le Christianisme est la meilleure des religions pour favoriser la prospérité des peuples, parce sa loi morale proclamant l’égalité, avant même les lois positives, garantit les libertés civiles.
Sommaire
- Éléments contextuels et Synthèse globale
- Introduction – Idée générale de la Morale
- Morale religieuse
- Morale individuelle
- Morale sociale
- Appendice – Le Christianisme
- Bibliographie
- Texte intégral traduit en français par Patrick Moulin @dsirmtcom
Retour à la page des Essais Philosophiques Cubains
Dsirmtcom, octobre 2020.
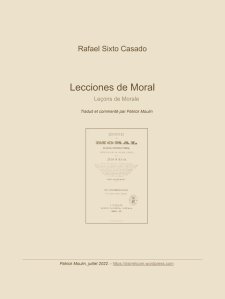
6 commentaires sur “FL – Rafael Sixto Casado, Lecciones de Moral – 5. Morale sociale”