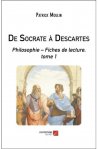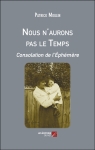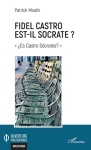Philosophie – Carnet de Vocabulaire Philosophique
Juger (Faculté de), jugement [Kant]
Auteur, ouvrages
Kant, Critique de la raison pure
Dans tous les jugements où le rapport d’un sujet au prédicat se trouve pensé […], ce rapport est possible de deux manières. Ou bien le prédicat B appartient au sujet A comme quelque chose qui est contenu dans ce concept A (de façon implicite) ; ou bien B est tout à fait extérieur au concept A, bien qu’il soit tout de même en connexion avec lui. Dans le premier cas, j’appelle le jugement analytique, dans l’autre synthétique. Introduction, p. 100.
Les jugements d’expérience, comme tels, sont tous synthétiques. Car il serait insensé de fonder un jugement analytique sur l’expérience, étant donné que je n’ai nullement besoin de sortir de mon concept pour formuler le jugement et que nul témoignage de l’expérience ne m’est donc nécessaire pour cela. Qu’un corps soit étendu, c’est une proposition qui trouve sa consistance a priori, et non par dans un jugement d’expérience. Ibid., p. 101.
Dans toutes les sciences théoriques de la raison sont contenus des jugements synthétiques a priori faisant fonction de principes. Ibid., p. 103.
[Des] propositions proprement mathématiques sont toujours des jugements [synthétiques] a priori et ne sont pas empiriques, parce qu’elles apportent avec elles une nécessité qui ne peut être tirée de l’expérience. Ibid., p. 104.
Tout aussi peu analytique est un axiome quelconque de la géométrie pure. Que la ligne droite soit, entre deux points, la plus courte, est une proposition synthétique. Car mon concept de ce qui est droit ne contient aucune détermination de grandeur, mais seulement une qualité. Le concept de ce qui est le plus court est donc entièrement surajouté et ne peut être par aucune analyse tiré du concept de la ligne droite. Il faut donc s’aider ici de l’intuition, par l’intermédiaire de laquelle seulement la synthèse est possible. Ibid., p. 105.
Kant, Critique de la faculté de juger
Le jugement sur la finalité inscrite dans les choses de la nature – une finalité qui est considérée comme fondant la possibilité de celles-ci (en tant que fins naturelles) – s’appelle un jugement téléologique. Première introduction, p. 123.
La faculté de juger en général est le pouvoir de penser le particulier comme compris sous l’universel. Si l’universel (la règle, le principe, la loi) est donné, la faculté qui subsume sous lui le particulier est déterminante […]. Mais si seul le particulier est donné, pour lequel l’universel doit être trouvé, la faculté de trouver est simplement réfléchissante. Introduction, p. 158.
Ici se fonde la division de la critique de la faculté de juger en critique de la faculté de juger esthétique et critique de la faculté de juger téléologique : par la première, on entend le pouvoir de porter un jugement appréciatif sur la finalité formelle (dite aussi, par ailleurs, subjective) par l’intermédiaire du sentiment de plaisir ou de peine ; par la seconde, le pouvoir de porter un jugement appréciatif sur la finalité réelle (objective) de la nature par l’intermédiaire de l’entendement et de la raison. Ibid., p. 173.
Le jugement de goût détermine son objet du point de vue de la satisfaction (en tant que beauté) en prétendant à l’adhésion de chacun, comme s’il était objectif. […] Le jugement de goût n’est absolument pas déterminé par des arguments démonstratifs, exactement comme s’il était seulement subjectif. Analytique du sublime, p. 266, p. 268.
Kant, Logique
La faculté de juger est double : déterminante ou réfléchissante. La première va de l’universel au particulier ; la seconde, du particulier à l’universel. La seconde n’a qu’une validité subjective ; car l’universel auquel elle s’achemine en partant du particulier n’est qu’une universalité empirique ; un simple analogue de l’universalité logique. Éléments, Des raisonnements, p. 143.
Les raisonnements de la faculté de juger [réfléchissante] consistent en certaines façons de raisonner qui permettent de parvenir à des concepts universels en partant de concepts particuliers. […] Ils ne déterminent pas […] l’objet, mais seulement la façon de réfléchir sur l’objet pour parvenir à sa connaissance. Ibid.
Définition
Le jugement est une proposition qui relie un sujet et un prédicat, qui affirme ou ni quelque chose du sujet. Kant distingue les jugements analytiques, où le prédicat fait partie de la nature du sujet, et les jugements synthétiques, où le prédicat est indépendant du sujet et ajoute une connaissance sur lui. Il distingue également les jugements déterminants, qui partent de l’universel pour déterminer un objet particulier, des jugements réfléchissants, qui partent d’un objet particulier pour parvenir à l’universel.
Par exemple, affirmer que l’espèce humaine comprend les australopithèques comme Lucy, dont les ossements ont été découverts par Yves Coppens en 1974, est un jugement déterminant : il part du principe universel que les australopithèques font partie des hominidés, et l’applique à Lucy. Lorsque Yves Coppens découvre Lucy, il énonce d’abord un jugement réfléchissant : ces ossements particuliers peuvent prétendre représenter l’universalité de l’espèce humaine. Le jugement analytique qui suit démontre que Lucy est une australopithèque, et donc qu’elle fait partie de l’espèce humaine.
Étymologie
Larousse étymologique
[Juger :] “Décider, condamner” ; “émettre une opinion” ; latin judicare.
Gaffiot
[Judicare :] I. [Langage technique] 1. Dire le droit, juger, faire l’office de juge. 2. Rendre un jugement, prononcer un arrêt. 3. [en parlant du magistrat] Se prononcer sur la peine à requérir devant le peuple. 4. Condamner. II. [Langue commune] 1. Juger, décider. 2. Porter un jugement.
[Judicium :] I. [Terme technique] 1. Action judiciaire, procès. 2. Jugement, sentence, décision, arrêt. II. [Langue commune] 1. Jugement, opinion. 2. Faculté de juger, jugement, discernement ; goût.
Littré
[Jugement :] Du latin judicare, de jus, droit, et dicere, dire, prononcer.
Références
Lalande
Jugement (faculté de juger)
Psychologie
Décision mentale par laquelle nous arrêtons d’une façon réfléchie le contenu d’une assertion et nous le posons à titre de vérité.
Opération consistant à se faire une opinion sur laquelle on règle sa conduite, dans les cas où l’on ne peut atteindre une connaissance certaine.
Qualité qui consiste à bien juger des choses qui ne sont pas l’objet d’une perception immédiate ou d’une démonstration rigoureuse.
Logique
Le jugement logique, au sens le plus général, est le fait de poser (soit à titre de vérité ferme, soit à titre provisoire, fictif, hypothétique, etc.) l’existence d’une relation déterminée entre deux ou plusieurs termes.
On peut également le définir : l’acte de pensée qui peut être dit vrai ou faux.
La relation la plus usuellement considérée est celle de la prédication […], qui n’est pas réversible, on distingue pratiquement : 1° un terme dont on part, qu’on appelle le sujet ; 2° un terme généralement complexe, qu’on en affirme ou qu’on en nie ; on l’appelle prédicat.
Droit
Action de juger, audition de la cause.
Décision judiciaire.
Types de jugement
[Analytique :] Kant appelle analytique un jugement (attributif) dans lequel le prédicat est contenu dans le sujet.
[Déterminant :] Le Jugement déterminant est la faculté de subsumer sous un universel donné le singulier ou le particulier auquel il convient. Il s’oppose au Jugement réfléchissant.
[Réfléchissant :] Le terme ne s’emploie en philosophie que pour traduire l’expression kantienne [en allemand]. Tout jugement consiste à subsumer le “particulier”, sous un universel. Quand cet universel est donné d’avance, et que la faculté de juger s’exerce en désignant le particulier qui doit y être subsumé, elle est dite déterminante […] ; quand au contraire le “particulier” est donné et qu’il s’agit de découvrir l’universel (par exemple la règle générale) auquel il doit être subsumé, elle est dite réfléchissante.
Morfaux
Jugement (faculté de juger)
Le mot français désigne soit un pouvoir, une faculté […], soit l’acte, la décision qui en résulte […]. a) Au sens le plus général, la faculté de juger est celle de discerner le vrai et le faux, le juste et l’injuste, le beau et le laid […] ; b) plus précisément, le jugement est la mise en rapport d’un cas particulier avec une loi, une règle, un principe général, un corps de connaissance […]. Par là, juger implique choix, décision, volonté, liberté ; c) la faculté de juger est susceptible de perfectionnement ou de dégradation. […] En ce sens, l’obstacle à la formation du jugement est le préjugé […].
Classiquement, dans la tradition aristotélicienne, un jugement est une proposition qui relie un sujet et un prédicat par l’intermédiaire d’une copule (jugement d’attribution). […] Dans la Critique de la raison pure, Kant a proposé un tableau des formes du jugement selon la qualité (affirmatif, négatif, indéfini), la quantité (universel, particulier, singulier), la relation (catégorique, hypothétique, disjonctif), la modalité (problématique, assertorique, apodictique).
Chez Kant, jugements analytiques, synthétiques, a posteriori et a priori, jugement de goût ; […] à partir de la distinction kantienne entre un usage théorique et pratique de la raison, on distingue des jugements portant sur ce qui est (jugements de réalité, de fait, d’existence) et des jugements sur ce qui doit être (jugements de valeur).
Types de jugement
[Analytique :] Jugement analytique (opposé au jugement synthétique) : celui dont l’attribut appartient nécessairement à l’essence ou à la définition du sujet.
[Réfléchissant :] Le jugement est dit réfléchissant quand l’individuel étant donné, on y découvre l’universel […] ; par opposition, le jugement est déterminant si, l’universel étant donné, j’y découvre l’individuel ou le spécial. […] Le jugement réfléchissant désigne notamment les jugements esthétique et téléologique, qui, à la différence des jugements scientifiques, ne déterminent pas un objet de connaissance mais peuvent, par la réflexion, unifier subjectivement le divers empirique par la médiation d’une harmonie interne ou d’une certaine finalité.[Synthétique :] Chez Kant, jugements synthétiques a priori : notion originale qui pose le problème central de sa philosophie de la connaissance : comment une mathématique pure et une physique pure sont-elles possibles ? Comment la métaphysique est-elle possible à titre de disposition naturelle ? […] La réponse positive consiste à montrer que si tous les jugements d’expérience sont synthétiques, c’est-à-dire a posteriori, la réciproque n’est pas vraie, et qu’il existe des jugements qui ajoutent à la compréhension du sujet du jugement et qui pourtant ne dérivent pas de l’expérience, c’est-à-dire des jugements synthétiques a priori, ce qui est le cas de tous les jugements proprement mathématiques, des principes de la science de la nature ou physique et de la métaphysique “envisagée du moins dans son but”. Ces jugements rendent donc possibles la construction de la connaissance et son progrès tout en lui conférant la même rigueur objective que celles des jugements analytiques.
Voir aussi
Articles : Kantomania
Bac Philo : Théorie et expérience ; La Morale ; Le Devoir.
Carnet de vocabulaire philosophique : Antinomie ; Apodictique/assertorique/problématique ; A priori, a posteriori ; Autonomie/hétéronomie ; Concept ; Cosmologie rationnelle ; Déontologie ; Imaginer et concevoir ; Impératif (catégorique, hypothétique) ; Intuition ; Juger (Faculté de), jugement ; Métaphysique ; Morale ; Noumène ; Objectif/Subjectif ; Obligation ; Phénomène ; Prédicat ; Preuve ontologique ; Respect ; Schème ; Subsumer ; Transcendant ; Transcendantal ; Universel.
Doctrines et vies des philosophes illustres : Kant.
Fiches de lecture : Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs ; Qu’est-ce que les Lumières ? ; Vers la paix perpétuelle.
La Philo en 4 cases : Kant, Les quatre questions de la Philosophie.
Notes contemplatives de lecture : Kant, Que signifie s’orienter dans la pensée ?
Notes philosophiques : Kant – “On ne peut tout au plus qu’apprendre à philosopher ».
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Bibliographie
KANT E., Critique de la raison pure, Paris, GF Flammarion, 2006.
KANT E., Critique de la faculté de juger, Paris, GF Flammarion, 2000.
KANT E., Logique, Paris, Vrin, 2007.
Dsirmtcom, août 2022.
Philosophie, Vocabulaire, Kant, Antinomie, Raison, Connaissance, Jugement, Antinomie, Autonomie/hétéronomie, Concept, Concevoir, Cosmologie rationnelle, Déontologie, Dieu, Empirique, Entendement, Espace, Existence, Exister, Expérience, Goût, Imaginer, Impératif, Catégorique, Hypothétique, Intuition, Juger, Jugement, Métaphysique, Morale, Noumène, Objectif, Subjectif, Obligation, Phénomène, Prédicat, Preuve, Cosmologique, Ontologique, Schème, Sensibilité, Subsumer, Sujet, Temps, Transcendant, Transcendantal, Universel
#Philosophie #Vocabulaire #MardiCestPhilosophie #Kant #Jugement #Juger #Raison #Connaissance