Philosophie – Fiches de lecture
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Fiche de lecture n° 35-1
Sommaire
- Éléments contextuels et synthèse globale
- Préface – Question et avant-propos – Première partie
- Seconde partie – Bibliographie
Préface – Question et avant-propos – Première partie – Synthèse – Extraits
Afin d’alléger la lecture, l’ouvrage sera dénommé simplement Discours dans cette fiche.
La pagination renvoie à l’édition du Discours dans la collection “Les Classiques de la Philosophie”, Le Livre de Poche. Les notes numérotées sont celles de cette même édition.
Rousseau place en exergue du titre de son ouvrage une citation d’Aristote :
C’est plutôt chez les êtres conformes à la nature que chez ceux qui sont dégradés qu’il faut examiner ce qui est “par nature”. Aristote, Les Politiques, I, 5, 1254 a.
Le discours va réfuter la thèse aristotélicienne de l’homme comme étant naturellement un animal social. Les Anciens pensent l’homme et la Cité comme parties intégrantes du Cosmos, autrement dit de la Nature. Les Modernes, dont Rousseau, distinguent la nature, comme objet extérieur, et l’homme, comme sujet.
Le texte comporte ensuite une partie où Rousseau exprime sa reconnaissance et rend un hommage appuyé à la République de Genève.
Préface
La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l’homme et j’ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres de moralistes. p. 93.
Pour connaître la source de l’inégalité parmi les hommes, il faut commencer par connaître l’homme lui-même. Rousseau compare l’homme véritable à la statue du dieu marin Glaucus, méconnaissable après son séjour dans la mer. Il cite ici implicitement Platon :
[…] le fait est que nous l’avons envisagée [l’âme] dans un état analogue à celui de Glaucos, le Dieu marin, en le voyant actuellement, on aurait de la peine à voir encore sa primitive figure : des anciennes parties de son corps, les unes en effet ont été brisées, les autres se sont usées et ont été complètement endommagées par les vagues, tandis que d’autres corps sont venus s’y incruster, coquillages, algues, cailloux ; si bien qu’il ressemble à je ne sais quelle bête, plutôt qu’à ce qu’il était naturellement… ; c’est ainsi que l’âme est de même envisagée par nous dans l’état où l’ont mise des milliers de maux. Platon, La République, X, 611 c-d.
Le progrès a éloigné l’homme de son état primitif. L’inégalité est donc à chercher dans ces changements qui ont altéré les hommes.
Rousseau précise qu’il va présenter des “conjectures”, c’est-à-dire des hypothèses, pour tenter de répondre à la question posée par l’Académie de Dijon (voir plus loin).
Car ce n’est pas une légère entreprise de démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme, et de bien connaître un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. p. 95.
Les anciens philosophes considèrent que l’homme et tous les êtres sont soumis à la loi de la nature. Les modernes conçoivent la loi comme “une règle prescrite à un être moral” qui ne peut être que l’homme, animal doué de raison.
Pour Rousseau, il faut d’abord connaître l’homme naturel avant de déterminer à quelle loi il serait soumis. Deux principes sont antérieurs à la raison : la conservation de soi et la pitié envers son prochain.
De cette manière, on n’est point obligé de faire de l’homme un philosophe avant que d’en faire un homme ; ses devoirs envers autrui ne luis sont pas uniquement dictés par les tardives leçons de la sagesse ; et tant qu’il ne résistera point à l’impulsion intérieure de la commisération, il ne fera jamais du mal à un autre homme ni même à aucun autre être sensible, excepté dans le cas légitime où sa conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la préférence à lui-même. p. 98-99.
C’est la première présentation de l’homme comme naturellement bon, avant même d’être moral. Rousseau va justement analyser l’origine de l’inégalité morale, l’influence de la politique et de la société. C’est la distinction entre les puissants et les faibles, entre les riches et les pauvres. Il faut aussi distinguer “ce qu’a fait la volonté divine d’avec ce que l’art humain a prétendu faire” (p. 100). Rousseau le résume par cette citation de Perse, poète latin du Ier siècle.
Apprends ce que Dieu a ordonné que tu sois, et où est ta place dans le monde humain. Perse, Satires, III, 71-73.
Question et avant-propos
La question proposée par l’Académie de Dijon s’énonce ainsi lorsqu’elle est mise au concours dans le Mercure de France, en 1753 :
Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle.
Rousseau la reformule la recherche de la “source” en recherche de l’origine de l’inégalité, et va mettre de côté dans son ouvrage la notion de “loi naturelle” des académiciens pour se concentrer sur ce qui fonde réellement l’inégalité parmi les hommes. Voici la formulation telle qu’elle est présentée en tête du Discours :
Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle. p. 101.
Le titre de ce qui constitue un avant-propos est “Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes”. C’est la reformulation complète de la question initiale de l’Académie. Rousseau l’explicite en établissant une distinction dans l’inégalité parmi les hommes. D’une part, il y a l’inégalité naturelle ou physique : l’âge, la constitution du corps, les qualités de l’esprit. D’autre part, il existe une inégalité morale ou politique, qui dépend des conventions entre les hommes : les privilèges, la richesse, le pouvoir.
On ne peut pas demander quelle est la source de l’inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait simplement énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s’il n’y aurait point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités ; car ce serait demander, en d’autres termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l’esprit, la sagesse ou la vertu, se trouvent toujours dans les mêmes individus, en proportion de la puissance, ou de la richesse : question bonne peut-être à agiter entre des esclaves entendus de leurs maîtres, mais qui ne convient pas à des hommes raisonnables et libres, qui cherchent la vérité. p. 104.
Le Discours traite des effets néfastes, selon Rousseau, du progrès sur les rapports entre les hommes. Personne, toujours selon Rousseau, n’a encore réussi “à remonter jusqu’à l’état de nature”. Le problème vient de la confusion des faits et du droit. Il ne faut pas prendre les faits pour des vérités, mais partir d’eux pour les comprendre selon le droit. Rousseau s’imagine alors “dans le lycée d’Athènes” (là où Aristote enseignait), s’adressant à Platon, Xénocrate et au genre humain, pardonnez du peu !
Ô homme de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute. Voici ton histoire telle que j’ai cru la lire, non dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans la nature qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d’elle sera vrai. p. 106.
Traiter tous ceux qui ont écrits sur le sujet de l’être humain de menteurs, et se positionner comme le seul qui sache lire la nature, c’est-à-dire Dieu, soulignerait Spinoza, voilà qui peut faire comprendre pourquoi Rousseau est certes un penseur, mais surtout un “marginal des Lumières” (Folscheid).
Première partie
Quelque important qu’il soit, pour bien juger de l’état naturel de l’homme, de le considérer dès son origine, et de l’examiner, pour ainsi dire, dans le premier embryon de l’espèce ; je ne suivrai point son organisation à travers ses développements successifs. Je ne m’arrêterai pas à rechercher dans le système animal ce qu’il put être au commencement, pour devenir enfin ce qu’il est […]. p. 107.
La première partie du Discours est établie de façon synchronique : elle ne va pas étudier l’évolution de l’espèce humaine (l’ouvrage de Charles Darwin, L’Origine des espèces ne sera publié qu’en 1859, soit un siècle plus tard). C’est précisément un “état”, celui de nature, qui va être exposé, à un moment donné hypothétique, mais figé.
[…] je vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais, à tout prendre, organisé le plus avantageusement de tous. Je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et voilà ses besoins satisfaits. p. 108.
Le seul instrument de “l’homme sauvage” est son corps, bien plus puissant et plus robuste que celui de “l’homme civilisé”, aidé de toutes ses machines. Il ne s’agit pourtant pas d’un homme naturellement violent, vivant dans une condition de guerre de chacun contre chacun, comme l’affirme Hobbes (c’est la première critique de Rousseau contre l’auteur du Léviathan). Cet homme dans l’état de nature est timide et prêt à fuir. Il n’existe pas non plus d’animal qui fasse naturellement la guerre à l’homme. Les véritables ennemis de l’homme sont les infirmités naturelles (enfance et vieillesse) et les maladies qui sont plutôt l’apanage de l’homme vivant en société. La constitution de l’homme sauvage et sa vie réglée selon la nature le protège des maladies induites par les inégalités “dans la manière de vivre” que subit l’homme civilisé, et Rousseau inclut la santé mentale.
Si [la nature] nous a destinés à être sains, j’ose presque assurer que l’état de réflexion est un état contre nature, et que l’homme qui médite est un animal dépravé. p. 113.
Après avoir décrit l’aspect physique de l’homme sauvage, Rousseau va présenter son “côté métaphysique et moral”. L’homme suit librement ce que la nature lui commande. Sa capacité à choisir démontre “la spiritualité de son âme”. Rousseau épingle au passage Montaigne sans le nommer, lorsqu’il fait cette affirmation : “Il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu’il n’y en a de tel homme à telle bête” (Essais, I, XLII). L’homme diffère de l’animal parce qu’il est un “agent libre”, à l’état de nature [conception de la liberté qui se retrouve dans le Contrat social, avec la phrase célèbre : “L’homme est né libre, et partout il est dans les fers” (Livre I, chapitre I)].
Une des caractéristiques majeures qui distingue l’homme de l’animal est sa faculté de se perfectionner. Rousseau la nomme la perfectibilité. Elle n’est pas pour autant la garantie d’une évolution positive.
[La faculté de se perfectionner], à l’aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu., au lieu qu’un animal est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu’elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l’homme, reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? p. 117-118.
Une chose est de perdre ses acquis, mais la perfectibilité présente un danger bien plus grand : elle prive du “bonheur originel”.
Pour décrire le côté métaphysique et moral de l’homme à l’état de nature, Rousseau évoque une progression de ses facultés. Le désir et la crainte sont les premières fonctions. Ces passions se nourrissent de la capacité d’idéation. Ainsi, c’est sa nature humaine qui lui fera acquérir la peur de l’idée la mort.
[…] les seuls biens qu’il connaisse dans l’univers sont la nourriture, une femelle et le repos, les seuls maux qu’il craigne sont la douleur et la faim ; je dis la douleur et non la mort ; car jamais l’animal ne saura ce que c’est que mourir, et la connaissance de la mort, et de ses terreurs, est une des premières acquisitions que l’homme ait faites, en s’éloignant de la condition animale. p. 119.
Il y a ici une analogie, sans doute inconsciente, avec la Genèse. Adam, le premier homme découvre qu’il est mortel en goûtant au fruit de l’arbre de la connaissance ; Eve est plutôt un second rôle dans l’histoire biblique, même si ce rôle est loin d’être secondaire. Rousseau parle de l’homme sauvage comme d’un mâle, et c’est bien l’homme en tant qu’être masculin qui a le premier rôle : un des biens qu’il connaît est la “femelle”. Le progrès de ses connaissances lui apporte la “terreur” de la mort.
L’Histoire montre que les progrès de l’esprit sont liés aux passions, à l’augmentation des besoins à satisfaire. L’homme à l’état sauvage est dépourvu de la tentation (autre notion clé biblique). Tel que le décrit Rousseau, il semble être le plus parfait épicurien, satisfaisant ses seuls besoins naturels et nécessaires, philosophe inné, vivant dans la tranquillité de l’âme, cette ataraxie qui semble si difficile à atteindre pour les hommes civilisés.
[…] Son âme que rien n’agite, se livre au seul sentiment de son existence actuelle, sans aucune idée de l’avenir, quelque prochain qu’il puisse être, et ses projets, bornés comme ses vues, s’étendent à peine jusqu’à la fin de la journée. p. 120.
La faculté de communiquer est le mécanisme qui a réduit la distance entre l’homme sauvage aux “pures sensations” et les connaissances même les plus simples. Même si l’homme sauvage avait été le plus grand des philosophes, il n’aurait rien pu en faire sans la possibilité de communiquer et donc d’enseigner ou d’apprendre. Mais ce progrès a vraisemblablement pris beaucoup de temps.
Qu’on songe de combien d’idées nous sommes redevables à l’usage de la parole ; combien la grammaire exerce et facilite les opérations de l’esprit, et qu’on pense aux peines inconcevables, et au temps infini qu’a dû coûter la première invention des langues ; qu’on joigne ces réflexions aux précédentes, et l’on jugera combien il eût fallu de milliers de siècles, pour développer successivement dans l’esprit humain les opérations dont il était capable. p. 122-123.
Rousseau tente de comprendre quelle est l’origine des langues. Il postule qu’il fallait d’abord que l’homme sache penser avant de savoir parler. Puis il envisage les étapes de développement de la parole.
Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, et le seul dont il eut besoin, avant qu’il fallût persuader des hommes assemblés, est le cri de la nature. […] Quand les idées des hommes commencèrent à s’étendre et à se multiplier, et qu’il s’établit entre eux une communication plus étroite, ils cherchèrent des signes plus nombreux et un langage plus étendu […]. p. 125-126.
La grammaire n’étant pas encore inventée, les premiers mots devaient correspondre à des propositions entières. Les hommes distinguèrent ensuite les substantifs, les verbes et les adjectifs. Puis chaque objet fut désigné par un nom spécifique. Ainsi les idées générales et particulières remplirent l’esprit par le biais des mots. Les idées métaphysiques n’ayant aucun équivalent dans la nature devaient échapper aux hommes sauvages. Rousseau ne prétend pas ici résoudre le problème de l’origine précise des langues.
[…] je laisse à qui voudra l’entreprendre la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus nécessaire, de la société déjà liée à l’institution des langues, ou des langues déjà inventées à l’établissement de la société. p. 130.
Le problème de l’origine des langues est un cercle logique, du type de celui de l’œuf et de la poule. Pourtant Rousseau écrira un Essai sur l’origine des langues, vraisemblablement rédigé de façon contemporaine au Discours sur l’origine de l’inégalité. Il aurait été destiné à être inséré en appendice du Discours, mais n’a été publié qu’en 1781, après la mort de Rousseau (1778).
La nature n’a pas préparé les hommes à la sociabilité, pourtant l’état sauvage n’a rien d’un état misérable. Sa vie était bien plus supportable que la vie civile des contemporains de Rousseau, qui se plaignent presque tous de leur existence.
[L’homme sauvage] avait dans le seul instinct tout ce qu’il fallait pour vivre dans l’état de nature, il n’a dans sa raison cultivée que ce qu’il lui faut pour vivre en société. p. 131.
Nous devons “suspendre le jugement” [expression utilisée en phénoménologie] et “nous défier de nos préjugés” [mise en garde originelle faite par Descartes] sur la moralité de l’homme sauvage : il ne peut être ni bon ni méchant car il ignore le vice.
Rousseau critique l’hypothèse de Thomas Hobbes selon laquelle l’homme serait naturellement violent : Selon le philosophe anglais, l’état de nature est une état de guerre de chacun contre chacun, où l’homme est un loup pour l’homme.
[…] les sauvages ne sont pas méchants précisément parce qu’ils ne savent pas ce que c’est qu’être bons ; car ce n’est ni le développement des lumières, ni le frein de la loi, mais le calme des passions et l’ignorance du vice qui les empêchent de mal faire ; “Chez eux l’ignorance des vices est plus efficace que chez d’autres la connaissance de la vertu.” (citation en latin dans le texte). p. 133.
L’homme possède une seule vertu naturelle, celle des êtres faibles : la pitié. Elle semble même commune avec certains animaux.
Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion : telle est la force de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, puisqu’on voit tous les jours dans nos spectacles s’attendrir et pleurer aux malheurs d’un infortuné tel, qui, s’il était à la place du tyran, aggraverait encore les tourments de son ennemi. p. 134.
De la vertu naturelle de la pitié découlent les vertus sociales : générosité, clémence, humanité, et même bienveillance et amitié. A l’inverse, “l’état de raisonnement” isole l’homme et le fait se replier sur son seul amour-propre. La critique du philosophe et de sa raison est acerbe.
Il n’y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil du philosophe, et qui l’arrachent de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre ; il n’a qu’à mettre ses mains sur ses oreilles et s’argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l’identifier avec celui qu’on assassine. p. 135-136.
Nous retrouvons ici la considération selon laquelle l’homme qui médite est un homme dépravé (p. 113). La vertu naturelle de la pitié modère l’amour-propre, égoïste, et favorise la conservation de l’espèce. L’état de nature est altruiste. Rousseau préfigure l’impératif catégorique de Kant :
[C’est la pitié] qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée : fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente : Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible. p. 136.
Pour mémoire, une des formulations de l’impératif catégorique de Kant est : “Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais comme un moyen.” (Fondements de la métaphysique des mœurs). L’homme à l’état de nature selon Rousseau présente ainsi beaucoup de similitudes avec l’homme moral de Kant.
Les passions sont peu actives chez l’homme sauvage. Il n’y a pas de relation de commerce, donc ni estime, ni mépris, ni de notions de propriété ou de justice.
Rousseau va terminer le portrait métaphysique et moral de l’homme sauvage par la question du désir sexuel, en distinguant la pulsion physique du sentiment moral. La critique va ici viser d’abord la violence sexuelle engendrée par les pulsions.
Parmi les passions qui agitent le cœur de l’homme, il en est une ardente, impétueuse, qui rend un sexe nécessaire à l’autre, passion terrible qui brave tous les dangers, renverse tous les obstacles, et qui dans ses fureurs semble propre à détriure le genre humain qu’elle est destinée à conserver. Que deviendront les hommes en proie à cette rage effrénée et brutale, sans pudeur, sans retenue, et se disputant chaque jour leurs amours au prix du sang ? p. 137.
La critique se poursuit sur la législation, parfois elle-même génératrice de violence.
Il faut convenir d’abord que plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour les contenir : mais outre que les désordres et les crimes que celles-ci causent tous les jours parmi nous montrent assez l’insuffisance des lois à cet égard, il serait encore bon d’examiner si ces désordres ne sont point nés avec le lois mêmes […]. p. 137-138.
Faisons ici un parallèle succinct avec notre époque contemporaine, où la pédocriminalité, la violence sexuelle envers les femmes dénoncée par le mouvement #MeeToo ou encore la problématique de l’inceste mis en lumière au sein de supposées élites intellecutelles montrent la tragique actualité du constat de Rousseau. Les lois actuelles n’échappent pas non plus à la critique rousseauiste : la fixation d’un âge pour consentir à une relation sexuelle engendre de nos jours des débats parlementaires sans fins. La prescription de crimes sexuels peut également être à l’origine d’un sentiment d’impunité chez celui qui commet des actes irréparables.
A l’occasion de cette partie sur l’amour, Rousseau présente sa conception de la femme. Chez l’homme sauvage, l’amour est limité au désir physique : “toute femme est bonne pour lui”. Le tableau qu’il dresse de la gent féminine civilisée n’est guère plus flatteur.
Le physique est ce désir général qui porte un sexe à s’unir à l’autre ; le moral est ce qui détermine ce désir et le fixe sur un seul objet exclusivement […]. Or il est facile de voir que le moral de l’amour est un sentiment factice ; né de l’usage de la société, et célébré par les femmes avec beaucoup d’habileté et de soin pour établir leur empire, et rendre dominant le sexe qui devrait obéir. p. 138.
Rousseau souligne que c’est bien avec la société que l’amour a acquis une violence qui n’existe pas dans l’état de nature.
Ainsi l’homme sauvage vivait bien parce qu’il vivait “sans” : “sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre, sans nul besoin de ses semblables”. Sans progrès non plus puisque s’il découvrait quelque chose, il ne pouvait même pas le communiquer. Ses passions étaient rares et il se suffisait à lui-même.
L’art périssait avec l’inventeur ; il n’y avait ni éducation ni progrès, les générations se multipliaient inutilement ; et chacune partant toujours du même point, les siècles s’écoulaient dans toute la grossièreté des premiers âges, l’espèce était déjà vieille, et l’homme restait toujours enfant. p. 141.
L’inégalité naturelle était donc quasi inexistante. Il n’y avait ni servitude, ni domination, ni dépendance puisque l’homme sauvage ne possédait rien.
[…] chacun doit voir que, les liens de la servitude n’étant formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent, il est impossible d’asservir un homme sans l’avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d’un autre ; situation qui, n’existant pas dans l’état de nature, y laisse chacun libre du joug et rend vaine la loi du plus fort. p. 143.
C’est la perfectibilité, le développement des vertus sociales, l’usage de la raison qui ont détérioré l’homme “en le rendant sociable”. Rousseau introduit la seconde partie comme de nouvelles hypothèses, fondées sur la description de l’état de nature faite dans la première partie.
Dsirmtcom, mars 2021.
Philosophie, Mardi c’est philosophie, #MardiCestPhilosophie, Fiches de lecture, Rousseau, Lumières, Discours, Inégalité, Liberté, État, Nature, Société, Civil, Sociable, Propriété, Pitié, Perfectibilité, Hobbes, Locke, Léviathan, Violence, Guerre, Loup, Droit, Loi, Politique, Gouvernement, Despote, Lumières, Langage, Parole, Bon, Méchant, Bonté, Moral, Moralité, Volonté, Anthropologie, Richesse, Pauvreté, Puissance, Pouvoir, Force, Fort, Faiblesse, Domination, Désir, Maître, Esclave, Justice, Injuste, Légitime, Progrès, Histoire
#Philosophie #MardiCestPhilosophie #Rousseau #Inégalité #Liberté #Nature #Société #Hobbes #Locke
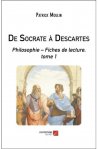

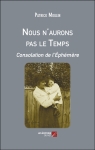


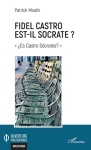
2 commentaires sur “FL – Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – Première partie”