Philosophie – Fiches de lecture
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Fiche de lecture n° 35-2
Sommaire
- Éléments contextuels et synthèse globale
- Préface – Question et avant-propos – Première partie
- Seconde partie – Bibliographie
Seconde partie – Synthèse – Extraits
Afin d’alléger la lecture, l’ouvrage sera dénommé simplement Discours dans cette fiche.
La pagination renvoie à l’édition du Discours dans la collection “Les Classiques de la Philosophie”, Le Livre de Poche. Les notes numérotées sont celles de cette même édition.
Seconde partie
Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût-on point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne. p. 146.
L’idée de propriété marque la dernière phase de l’état de nature. Rousseau a présenté cet état de façon synchronique dans la première partie : c’était l’état de nature à un moment donné. La seconde partie va être diachronique : c’est l’évolution de l’homme, depuis sa “naissance” jusqu’à l’état civil. Le Contrat social poursuivra cette histoire en exposant les principes politiques qui doivent régir une société, cet état civil organisé permettant ainsi de retrouver la liberté de l’état de nature.
Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l’industrie et des lumières, avant que d’arriver à ce dernier terme de l’état de nature. Reprenons donc les choses de plus haut et tâchons de rassembler sous un seul point de vue cette lente succession d’événements et de connaissances, dans leur ordre le plus naturel. p. 146-147.
La condition de “l’homme naissant” se limitait au sentiment de son existence, aux sensations et à l’instinct de conservation. Il fallait se nourrir et vaincre les obstacles de la nature. Selon les climats, les hommes développèrent des “manières de vivre” différentes, prenant conscience de leur supériorité face aux animaux
C’est ainsi que le premier regard qu’il porta sur lui-même y produisit le premier mouvement d’orgueil ; c’est ainsi que sachant encore à peine distinguer les rangs, et se contemplant au premier par son espèce, il se préparait de loin à y prétendre par son individu. p. 148-149.
Les premiers contacts permirent aux hommes de se considérer comme semblables. Leurs relations ébauchèrent les prémisses des sociétés, entre assistance et concurrence.
Dans le premier cas il s’unissait avec eux en troupeau, ou tout au plus par quelque sorte d’association libre qui n’obligeait personne, et qui ne durait qu’autant que le besoin passager qui l’avait formée. Dans le second cas chacun cherchait à prendre ses avantages, soit à force ouverte s’il croyait le pouvoir, soit par adresse et subtilité s’il se sentait le plus faible. p. 149.
C’est bien le temps qui caractérise la possibilité de l’état de société. L’homme sauvage n’ayant pas conscience du lendemain, les engagements mutuels se limitent au temps présent.
Avec l’appropriation du temps – dans la forme du contrat […] social et politique – l’homme cesse définitivement, pour son malheur selon Rousseau, d’être naturel. Histoire (temps humain de l’avenir) s’oppose ici à Nature (durée organique du présent). Note n° 21, p. 219.
Un embryon de société se constitue, accompagné de ses premiers ennuis.
Ce fut là l’époque d’une première révolution qui forma l’établissement et la distinction des familles, et qui introduisit une sorte de propriété ; d’où peut-être naquirent déjà bien des querelles et des combats. p. 151.
A l’opposé de ces conflits, les sociétés familiales engendrent “les plus doux sentiments” : l’amour conjugal et l’amour paternel. L’approche de Rousseau est très patriarcale :
Les femmes devinrent plus sédentaires et s’accoutumèrent à garder la cabane et les enfants, tandis que l’homme allait chercher la subsistance commune. p. 152.
Le temps du loisir augmentant crée de nouveaux besoins chez l’homme : le confort des “commodités” devient un premier joug.
[…] on était malheureux de les perdre, sans être heureux de les posséder. p. 152.
Le progrès du langage est rendu nécessaire par des catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, dérive des continents). Les hommes se regroupent en troupes, puis en une nation qui s’unit par des coutumes. Les idées et les sentiments se développent en même temps que les liens se resserrent. L’inégalité et le vice s’installèrent.
[…] de ces premières préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie ; et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l’innocence. p. 154.
L’homme naturel était retenu par la pitié. Il n’était pas naturellement cruel (référence implicite à Hobbes). Rousseau cite Locke : “Il ne saurait y avoir d’injure, où il n’y a point de propriété.” Cette dernière est une des causes de la “décrépitude de l’espèce” humaine. En devenant dépendant des autres, l’homme sauvage perd sa liberté et trouve l’inégalité.
[…] dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser à la sueur des hommes, et dans lesquelles ont vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. p. 156.
La révolution de la métallurgie et de l’agriculture ont perdu le genre humain. L’industrie du fer multiplia les ouvriers et la nécessité d’échanger le produit du travail contre des denrées. La société se divise en classes et renforce l’inégalité.
Les choses en cet état eussent pu demeurer égales, si les talents eussent été égaux, et que, par exemple, l’emploi du fer et la consommation des denrées eussent toujours fait une balance exacte ; mais la proportion que rien ne maintenait fut bientôt rompue ; […] le laboureur avait besoin de plus de fer, ou le forgeron plus besoin de blé, et en travaillant également, l’un gagnait beaucoup tandis que l’autre avait peine à vivre. p. 160.
Les progrès des autres arts, des langues, l’abus de richesses continuèrent à augmenter les inégalités. C’est la thèse que Rousseau a déjà développée dans le Discours sur les sciences et arts : le progrès des sciences et des arts corrompent les mœurs des hommes.
C’est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur force ou de leurs besoins une sorte de droit du bien d’autrui, équivalent, selon eux, à celui de propriété, l’égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre […]. La société naissante fit place au plus horrible état de guerre : le genre humain avili et désolé, ne pouvant plus retourner sur ses pas ni renoncer aux acquisitions malheureuses qu’il avait faites et ne travaillant qu’à sa honte, par l’abus des facultés qui l’honorent, se mit lui-même à la veille de sa ruine. p. 162-163.
Rousseau reprend ensuite sa critique de la société de Hobbes où chacun est soumis à la violence de l’État, et celle de Locke où la propriété conduit “à la servitude et à la misère.” Le droit civil devient la règle et la loi naturelle tend à disparaître. La description des sociétés dites civilisées devient tragique.
Les plus honnêtes gens apprirent à compter parmi leurs devoirs celui d’égorger leurs semblables ; on vit des hommes se massacrer par milliers sans savoir pourquoi ; et il se commettait plus de meurtres en un seul jour de combat et plus d’horreurs à la prise d’une seul ville qu’il ne s’en était commis dans l’état de nature durant des siècles entiers sur toute la face de la terre. Tels sont les premiers effets qu’on entrevoit de la division du genre humain en différentes sociétés. p. 166-167.
L’origine des sociétés politiques a plusieurs origines : la loi du plus fort, la richesse et la pauvreté, la nécessité d’une convention entre les pauvres n’ayant que leur liberté et les riches craignant pour leurs biens. Le dernier point est une nouvelle critique du Léviathan de Hobbes, où la soumission à l’État est définitive et sans condition.
[…] c’est la maxime fondamentale de tout le droit politique, que les peuples se sont donné des chefs pour les défendre et nous pour les asservir. Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c’est afin qu’il nous préserve d’avoir un maître. p. 169.
La servitude est là pour protéger de l’oppression. Rousseau vante une société civile dérivant du pouvoir paternel, où tous s’assemblent autour de celui qui détient l’autorité. Ceux qui sont soumis à un despote deviennent sa propriété en lui aliénant leur liberté. Ils deviennent ses esclaves.
Le concept du Contrat social est introduit sommairement par Rousseau.
Sans entrer aujourd’hui dans les recherches qui sont encore à faire sur la nature du pacte fondamental de tout gouvernement, je me borne en suivant l’opinion commune à considérer ici l’établissement du corps politique comme un vrai contrat entre le peuple et les chefs qu’ils se choisit, contrat par lequel les deux parties s’obligent à l’observation des lois qui y sont stipulées et qui forment les liens de leur union. p. 174.
Toutes les volontés sont réunies en une seule : c’est la future notion de “volonté générale” qui commence à apparaître. Ce contrat ne serait pas irrévocable (contrairement à celui de Hobbes).
Rousseau énoncent les formes de gouvernement : monarchie, aristocratie, démocratie. Chaque forme prend son origine dans les différences existant préalablement entre les individus. Trois phases politiques caractérisent la progression des inégalités : la loi et le droit de propriété ; la magistrature ; le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire. Chaque phase correspond à différents états civils des hommes : riche et pauvre ; puissant et faible ; maître et esclave.
Après un passage sur l’intérêt d’un ouvrage sur les avantages et les inconvénients de tout gouvernement, Rousseau parvient au “dernier terme de l’inégalité”, revenant à la question de départ. C’est une charge contre le despotisme.de l’Ancien Régime.
C’est ici que tous les particuliers redeviennent égaux parce qu’ils ne sont rien, et que les sujets n’ayant plus d’autre loi que la volonté du maître, ni le maître d’autre règle que ses passions, les notions du bien et les principes de la justice s’évanouissent derechef. C’est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l’un était l’état de nature dans sa pureté, et que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption. p. 183.
Le contrat social est dissous et la révolte des sujets devient aussi légitime que la force qui les opprimait injustement. L’homme libre de l’état de nature n’est plus, et il diffère totalement de “l’homme policé” de l’état civil.
Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et l’ataraxie même du stoïcien n’approche pas de sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s’agite, se tourmente sans cesse pour chercher des occurrences encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la mort, il y court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l’immortalité. p. 184-185.
La véritable différence est que l’homme sauvage vit en lui-même et l’homme sociable toujours hors de lui. C’est de l’opinion des autres qu’il tire le sentiment de son existence : “tout devient factice”.
[…] nous n’avons d’un extérieur trompeur et frivole, de l’honneur sans vertu, de la raison sans sagesse, et du plaisir sans bonheur. p. 186.
L’inégalité n’existe quasiment pas dans l’état de nature. L’inégalité morale résulte des abus des sociétés politiques.
[…] il est manifestement contre la loi de la nature […] qu’un enfant commande à un vieillard, qu’un imbécile conduise un homme sage et qu’une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude manque du nécessaire. p. 186.
Bibliographie
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Éd. Le Livre de Poche, Coll. Les Classiques de la Philosophie ; Essai sur l’origine des langues [Texte intégral et commentaires]
Aristote, Les Politiques.
Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, PUF, Coll. “Quadrige”.
Dominique Folscheid, Les grandes philosophies, PUF, Coll. Que sais-je ?
Thomas Hobbes, Léviathan.
Laurent Jaffro, Monique Labrune, Gradus philosophique, GF Flammarion.
Platon, La République, X.
Wikipédia : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ; Perse (poète).
Entendre aussi
France Culture, Chemins de la Philosophie, Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes :
- De l’état de nature à l’histoire ?
- Y a-t-il une « science de l’homme » ?
- L’invention de la propriété
- Les blessures de l’amour-propre
Voir aussi
Doctrines et vies des philosophes illustres : Rousseau.
Fiches de lecture : Rousseau, Du contrat social ; Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs.
Bac Philo : Chapitre I.4. Autrui – Fiche n° 2.b. Des “Autrui” et des hommes – La philosophie moderne.
Dsirmtcom, mars 2021.
Philosophie, Mardi c’est philosophie, #MardiCestPhilosophie, Fiches de lecture, Rousseau, Lumières, Discours, Inégalité, Liberté, État, Nature, Société, Civil, Sociable, Propriété, Pitié, Perfectibilité, Hobbes, Locke, Léviathan, Violence, Guerre, Loup, Droit, Loi, Politique, Gouvernement, Despote, Lumières, Langage, Parole, Bon, Méchant, Bonté, Moral, Moralité, Volonté, Anthropologie, Richesse, Pauvreté, Puissance, Pouvoir, Force, Fort, Faiblesse, Domination, Désir, Maître, Esclave, Justice, Injuste, Légitime, Progrès, Histoire
#Philosophie #MardiCestPhilosophie #Rousseau #Inégalité #Liberté #Nature #Société #Hobbes #Locke
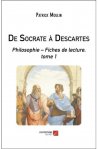

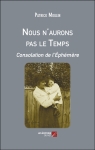


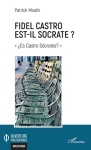
2 commentaires sur “FL – Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – Seconde partie”