Doctrines et vies des philosophes illustres
Retrouvez le portrait d’Aristote et l’analyse détaillée de l’Éthique à Nicomaque dans l’ouvrage
« De Socrate à Descartes – Philosophie – Fiches de lecture, tome I »
Éléments biographiques
Aristote naît en 385 avant notre ère, à Stagire. Son père, Nicomaque, est le médecin du roi des Macédoniens. Sa mère, Phaestis, est sage-femme, comme Phénarète, la mère de Socrate. Elle est originaire de Chalcis, ville proche d’Athènes. C’est là que mourra Aristote, en 322, à l’âge de soixante-trois ans. La cause de sa mort est incertaine : soit la maladie, soit l’ingestion d’aconit, une plante mortelle analogue à la ciguë qui fit trépasser Socrate.
Après des études à Athènes, Aristote intègre, en 367, l’Académie de Platon et en devient l’un des plus brillants disciples. Il y restera une vingtaine d’années. Il devient ensuite, en 343, le précepteur d’Alexandre le Grand, futur roi de Macédoine, alors âgé de treize ans. De retour à Athènes en 335, il fonde son école, le Lycée, où il enseignera pendant treize ans. Menacé par un procès pour impiété, Aristote quitte Athènes pour Chalcis où il mourra en 322.
Éléments de doctrine
Diogène Laërce, biographe du IIIe siècle, comptabilise 445 270 lignes au total, écrites par Aristote dans l’ensemble de ses ouvrages. Si ces chiffres sont sans doute erronés, il reste que le Stagirite aurait écrit plus de quatre cents traités. Il ne nous reste malheureusement que des écrits destinés à l’enseignement dans son Lycée. Les œuvres publiques ont été perdues.
Tous les humains ont par nature le désir de savoir. Métaphysique, 980 a.
Pour Dante, Aristote est “le maître de ceux qui savent”, le philosophe par excellence (La Divine Comédie, L’Enfer, Chant IV, 131). Les écrits qui nous sont parvenus montrent une volonté de constituer un savoir encyclopédique, dans de multiples domaines : physique, biologie, zoologie, astronomie, métaphysique, logique, éthique, politique, poétique, etc.
Aristote conçoit la science comme multiple. La science suprême est la science de l’être ou philosophie première, appelée aussi métaphysique. Les sciences peuvent se classer selon trois catégories :
- Théorétiques, visant la spéculation pure : mathématiques, physique, logique, théologie, métaphysique ;
- Pratiques, visant l’action : morale, éthique, politique, économie ;
- Poétiques, visant la création : poésie, rhétorique, dialectique.
La structure de la présentation synthétique de la doctrine d’Aristote ci-dessous est librement inspirée de celle de l’ouvrage de L. Jaffro et M. Labrune, Gradus philosophique (Cf. Bibliographie) qui divise le Corpus aristotélicien selon trois modes d’approches du réel : naturaliste, moraliste, logique. Nous inverserons ici les deux derniers modes, afin de mettre en valeur le volet moral de la doctrine d’Aristote.
La Nature
La science ne peut être qu’universelle. Nous connaissons les choses en tant qu’elles ont des caractères communs. Aristote va classer tout ce qui lui semble classable, catégorisable, regroupable. La science de la nature traite des corps et des grandeurs : il y a ainsi deux mondes, quatre éléments, quatre causes, dix catégories, trois âmes, etc. Elle traite également des mouvements et des principes qui régissent le monde réel.
Physique
L’univers en mouvement dans le temps
L’univers est divisé en deux mondes, départagé par la Lune : le ciel ou monde supralunaire comprend les corps célestes et le divin ; le monde sublunaire comprend la Terre et les êtres. L’ensemble est composé de sphères. Ceci a pour conséquence que la Terre n’est pas plate comme le prétendent Anaximène, Anaxagore et Démocrite, penseurs présocratiques. La preuve de la sphéricité de la Terre est démontrée lors des éclipses, lorsque l’ombre de la circonférence de la Terre se projette sur la Lune.
Quatre éléments composent les corps : le feu, l’air, l’eau et la terre. Les corps célestes ont la particularité d’être composés d’un cinquième élément : l’éther.
Tout ou presque est en mouvement dans l’univers. Les corps célestes se déplacent dans un mouvement circulaire. La Terre par contre est immobile et au centre de l’univers. Les êtres ont leurs mouvements propres comme nous le verrons plus loin.
Le temps est lié au mouvement, mais n’est pas un mouvement lui-même. Le temps est “le nombre d’un mouvement selon l’antérieur et le postérieur” (Physique, 219 b). Nous percevons ce qui est maintenant comme le présent, parce que nous percevons ce qui est avant, « l’antérieur” ou passé, et que nous envisageons ce qui est après, le « postérieur” ou futur.
[Le “maintenant”] est fin du temps passé et commencement du temps futur. Physique 222 b.
La fin et les causes
La doctrine d’Aristote est téléologique, finaliste : “la nature ne fait rien en vain” (La Locomotion des animaux, 704 b ; Politiques, 1253 a). L’important, c’est la fin, pour la Nature comme pour l’être humain, comme nous le verrons avec l’éthique. La physique se fonde sur la théorie des causes, au nombre de quatre, illustrées ici avec l’exemple classique de la statue de marbre :
- Cause matérielle : le marbre dans lequel est sculptée la statue ;
- Cause formelle : la forme déterminée de la statue ;
- Cause efficiente ou motrice : le travail du sculpteur ;
- Cause finale : le but à atteindre, ici la statue réalisée.
En acte et en puissance
La conception du mouvement se fonde sur la notion du devenir : tout est en mouvement, tout change. Ce mouvement comprend deux principes, qui se retrouvent dans la classification des causes : les notions de puissance et d’acte. La matière est puissance et la forme est en acte, autrement dit la statue ou l’être sont en puissance dans la matière, et lorsqu’ils se réalisent, ils sont en acte. L’acte est toutefois antérieur à la puissance : il faut un sculpteur en acte, c’est-à-dire un être humain fini ayant terminé d’apprendre à sculpter, pour réaliser en acte la statue qui est en puissance dans la matière brute. L’enchaînement est donc acte-puissance-acte. Si nous prenons un nouvel exemple avec l’être humain, il faut deux êtres humains en acte, adultes, pour donner naissance à un enfant, autre être humain, en puissance dans les gamètes de ses parents.
[U]n humain engendre un humain, l’individu, un individu. Métaphysique, 1070 a.
Métaphysique
Le terme de “métaphysique” vient d’Andronicos de Rhodes, philosophe péripatéticien du Ier siècle, et dernier recteur du Lycée, l’école fondée à Athènes par Aristote. Le nom “péripatétisme” (du grec peripatein, se promener) est donné à la doctrine d’Aristote, qui avait pour coutume d’enseigner en se promenant dans les allées du Lycée. Andronicos a classé les œuvres d’Aristote. Les livres qui venaient après la Physique traitent de l’être, de dieu et des essences : il les a regroupés sous le titre Métaphysique, ce qui signifie ce qui vient après les livres sur la physique. Cette dénomination a pris le sens de ce qui est au-delà du domaine de la physique : l’être, dieu, la mort, etc. Pour Aristote, la métaphysique correspond à la philosophie première, qui traite des objets les plus élevés.
Il y a une science qui étudie l’être, en tant qu’être, et les propriétés qui appartiennent à cet être en soi. Métaphysique 1003 a.
Être, substance et catégories
Dans la Métaphysique, Aristote reprend la classification des quatre causes en les appliquant à l’être et non plus seulement aux choses :
- La matière devient le substrat, c’est-à-dire le support “brut” sur lequel se formera l’être ;
- La forme est la substance, « l’être ce que c’est”, c’est la notion de quiddité ;
- La cause motrice est le principe d’où part le mouvement ;
- La fin est la cause opposée à la précédente, elle est aussi le bien [Cf. la notion d’éthique), puisqu’elle accomplit tout ce qui est engendré et tout ce qui est en mouvement.
Pour mémoire, les doctrines déterministes, comme celle de Descartes, ne retiendront que la cause efficiente ou motrice, dans le mécanisme de cause à effet.
Les attributs de l’être, comme d’ailleurs ceux des choses, peuvent être classés en dix catégories : essence (ou substance), qualité, quantité, relation, lieu, temps, position, possession, action et passion. Pour mieux les saisir, il faut leur faire correspondre ces questions élémentaires : Qui ? Quoi ? Comment ? Combien ? Avec quoi ? Où ? Quand ? De quelle manière ? De quoi ? Par quoi ?
Dieu : moteur immmobile, acte pur, Pensée de la pensée, cause finale universelle
La théologie d’Aristote est à la fois monothéiste : il y a une unité dans l’organisation de l’univers et un être suprême qui est à l’origine de tous les mouvements ; et à la fois polythéiste: en astronomie, il y a plusieurs moteurs qui entraînent les corps célestes.
Aristote expose les différents attributs de l’être suprême, c’est-à-dire de sa conception d’un dieu unique. Pour engendrer tous les mouvements qui ont lieu dans l’univers, il est nécessaire qu’il existe un premier moteur immobile. Si ce moteur est immobile, c’est parce que Dieu est acte pur, il n’a jamais été en puissance avant d’être en acte : il est éternellement réalisé, accompli, par essence. Dieu est pensée de la pensée : il se pense lui-même et aucun autre être ne le pense ; il n’y a aucun être intelligible qui lui soit supérieur. Dieu étant le premier moteur, il est la cause finale universelle : l’être suprême est la cause suprême.
L’âme, entéléchie du corps, et ses trois formes
L’entéléchie, chez Aristote, désigne la chose ou l’être achevé, réalisé, ayant accompli sa fin, et ayant atteint sa perfection. L’âme est ainsi la réalisation du corps, celui-ci n’étant qu’en puissance avant qu’il soit uni à l’âme : un corps sans âme n’a pas accompli sa fin.
Aristote distingue trois facultés de l’âme : végétative, sensitive et intellective. Les plantes ne sont dotées que de l’âme végétative, qui assure leur nutrition et leur croissance. Les animaux non humains disposent des âmes végétative et sensitive. Seul l’être humain possède les trois facultés de l’âme : l’homme est un animal raisonnable.
Logos et Organon
La classification d’Andronicos de Rhodes regroupe sous la dénomination d’Organon plusieurs traités : Catégories, Sur l’interprétation, Premiers et Seconds Analytiques, Topiques, Réfutations sophistiques. Deux autres traités sont parfois inclus dans l’Organon : la Rhétorique et la Poétique. Le mot grec organon signifie outil, instrument. L’ensemble de ces traités constitue donc l’instrument de la pensée, du discours ou logos. Le tout est aussi regroupé sous la dénomination de Logique formelle, car s’y retrouvent les déductions et les syllogismes. Il s’agit d’établir les règles du raisonnement.
Logique : le syllogisme
La science présentée dans l’Organon porte sur la démonstration et donne la définition des différents éléments qui concourent à l’atteinte de la vérité dans le logos. Parmi ceux-ci, le syllogisme tient une place majeure dans l’argumentation d’un discours.
Le syllogisme est un raisonnement déductif. Il vise, par l’argumentation, à affirmer ou nier ce qui est exprimé à propos d’une chose ou d’un être. Classiquement, il se compose de deux propositions, la prémisse majeure et la mineure, suivies d’une troisième, la conclusion, qui est la conséquence des deux premières. Le syllogisme peut aboutir à une vérité certaine ou seulement probable. Le syllogisme le plus répandu est celui-ci : Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. La fragilité du syllogisme en termes de vérité certaine se démontre dans cette version déformée : Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat.
Principes : non-contradiction, tiers exclus
Les propositions se composent d’un sujet, d’une copule, et d’un prédicat ou attribut du sujet. La copule est le verbe qui unit le prédicat au sujet, par exemple : Socrate (sujet) est (copule) mortel (prédicat qui affirme un attribut du sujet).
Deux principes régissent le fonctionnement des propositions : la non-contradiction et le tiers exclu. Le principe de non-contradiction pose que deux propositions contradictoires ne peuvent pas être à la fois vraies toutes les deux ou fausses toutes les deux : Socrate ne peut pas être à la fois mortel et immortel. Dans le principe du tiers exclu, il est impossible qu’il y ait un intermédiaire entre deux propositions, dont l’une est vraie et l’autre est fausse : Socrate ne peut pas être un peu mortel, ni un peu immortel.
Dialectique, Rhétorique, Poétique
Son maître Platon usait de la dialectique pour s’élever du particulier jusqu’aux essences les plus nobles que sont les Idées du Bien, du Beau, etc. Aristote distingue l’Analytique qui a pour objet la démonstration, de la Dialectique qui ne concerne que ce qui relève de l’opinion probable et des idées admises. Il considère la dialectique comme une méthode de déduction “éristique”, c’est-à-dire comme un art de la discussion comme le pratiquent les Sophistes, à partir de raisonnements spécieux, n’ayant que l’apparence de la vérité. Bref, la dialectique est “une déduction sans en être une” (Topiques, 100 b).
La Rhétorique est “le pendant de la dialectique” (Rhétorique, 1253 a). C’est une technique pour identifier ce qui peut persuader. Elle utilise l’enthymème, qui est un syllogisme basé sur la vraisemblance. Il s’agit ici de partir de lieux communs, et il n’est donc pas possible d’en tirer de réelles démonstrations sur la réalité.
L’art poétique partage avec la comédie et la musique d’être une représentation de la réalité humaine. La partie de la Poétique consacrée à la tragédie a inspiré les règles du théâtre classique de l’unité de temps et d’action. La tragédie représente ainsi le tout d’une action, avec un début, un milieu et une fin. Elle a pour vertu la purgation des émotions comme la pitié ou la peur, au moyen de la catharsis, terme grec signifiant la purification.
Morale et relations humaines
Politique, citoyenneté et justice
L’homme est par nature un animal politique (Politiques 1253 a). Il est donc fait pour vivre dans la Cité, qui est pour Aristote la communauté politique. Le terme vient du grec polis, qui signifie cité, que l’on retrouve dans le mot “métropole” par exemple. Celui qui vit hors de la Cité est ou une bête ou un dieu.
La Cité est composée de différents pouvoirs : l’homme politique, le roi, le chef de famille, le maître d’esclave, etc. Si l’homme est bien un animal politique, tous les êtres humains ne sont pas égaux aux yeux d’Aristote. L’homme, au sens masculin de l’appellation, sous réserve qu’il ne soit pas un barbare, c’est -à-dire un étranger non grec, est par nature capable de commander, d’être le maître. La femme est certes douée de pensée, mais faite pour exécuter : “sa parure c’est son silence” (Politiques, 1260 a). L’esclave est un “bien acquis animé” (Ibid., 1253 b), un instrument au service de son maître.
La justice est considérée comme la plus parfaite des vertus. Elle nécessite trois éléments chez l’homme : être apte à accomplir des actions justes, agir selon la justice, et vouloir ce qui est juste. Aristote définit ce qui est juste comme ce qui est conforme à la loi et qui respecte l’égalité. A côté de la vertu totale de justice se trouve la justice particulière, qui se présente sous deux formes : distributive et corrective. La justice distributive traite de la répartition des richesses et des honneurs, sur le principe d’une égalité proportionnelle, tenant compte des différences entre les membres de la Cité. La justice corrective ne tient compte que du dommage causé par un auteur à une victime, quels que soient leurs places dans la Cité : l’égalité est ici purement arithmétique.
Éthique des vertus
La vertu est une disposition à agir volontairement en vue du bien. Elle est un état intermédiaire, une “médiété”, entre deux états extrêmes, les vices, l’un par excès et l’autre par défaut. Dans la vertu du courage, le vice par excès est la témérité, celui par défaut est la lâcheté. Les conditions de l’acte vertueux ou moral, sont de savoir ce qu’on fait, de choisir librement l’acte à accomplir, en vue de cet acte lui-même, et de l’accomplir “dans une disposition d’esprit ferme et inébranlable” (Éthique à Nicomaque, 1105 a). C’est en accomplissant des actions vertueuses que l’on devient vertueux, et pas seulement en discutant de vertu.
L’homme, comme tout être ou toute chose, doit accomplir sa fonction pour se réaliser et tendre vers la perfection et l’excellence. Le mot grec aretê signifie à la fois excellence et vertu. Pour l’homme, le Souverain Bien “consiste dans une activité de l’âme en accord avec la vertu […] dans une vie accomplie jusqu’à son terme” (Éthique à Nicomaque, 1098 a). La doctrine d’Aristote est une éthique des vertus, un eudémonisme : elle vise l’atteinte du bonheur en tant que valeur éthique, intellectuelle, au moyen de la vertu, et par l’action morale.
Mais le bonheur ne s’atteint pas par une simple vie de plaisir. Comme dans les autres sciences, Aristote opère une classification dans le domaine de l’éthique. Il y a trois sortes de vies : la vie de jouissance, la vie politique et la vie contemplative. Nous y retrouvons la conception des différences entre les membres de la Cité : la vie de jouissance est la vie bestiale de la foule, plus proche de l’esclavage ; la vie politique est celle de hommes cultivés qui recherchent les honneurs ; la vie contemplative, celle des hommes sages et des philosophes comme Aristote.
La vie contemplative reste une vie active. Il s’agit d’utiliser l’intellect, cette partie divine de la raison qui est en nous. C’est une sagesse pratique, qui se réalise en actes, et non un état définitivement atteint et devenu stable. C’est pourquoi Aristote précise que le Souverain Bien est une activité qui se poursuit tout au long de l’accomplissement de la vie.
[C]ar une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour : et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l’œuvre d’une seule journée, ni d’un bref espace de temps. Éthique à Nicomaque, 1098 a.
Histoires particulières
Avec sa gueule de métèque
Le lieu de naissance d’Aristote, Stagire, une vieille colonie ionienne située en Macédoine et ancienne alliée d’Athènes, lui vaut le surnom de “Stagirite”, souvent utilisé comme synonyme de son nom. Cette origine lui donne aussi le statut de “métèque”, autrement dit de résident étranger, par rapport à la cité d’Athènes. Ceci a pour conséquence qu’il ne peut rien posséder d’autre que des biens meubles, conformément à la loi athénienne. Ainsi le Lycée, son école, ne lui appartient pas.
Aristote n’est pourtant pas macédonien, puisque sa mère, Phaestis, est originaire de la ville grecque de Chalcis, située en Eubée, à environ quatre-vingts kilomètres d’Athènes. Son testament est rédigé à Chalcis même, où il s’était réfugié en 323 av. J.-C., fuyant Athènes et la menace d’un procès pour impiété. Après Anaxagore, en 437, et Socrate, en 399, tous deux condamnés à mort pour le même motif d’impiété, il ne faisait pas bon être philosophe dans la Cité athénienne.
La Philosophie première, servante de la Scolastique
La postérité d’Aristote sera pendant un temps supérieure à celle de Platon. Les premiers néoplatoniciens comme Plotin (206-270) ou Augustin (354-430) cèdent la place au retour de la doctrine du Stagirite. Au Moyen Âge, les philosophes arabes comme Averroès traduisent Aristote, et les Scolastiques comme Thomas d’Aquin vont tenter de concilier la lumière surnaturelle de la révélation des textes religieux chrétiens avec la lumière naturelle de la raison de la philosophie première d’Aristote.
La Scolastique est l’enseignement pratiqué par les écoles ecclésiastiques et les Universités européennes du Xe au XVIIe siècle environ. La philosophie y est, selon l’expression de Thomas d’Aquin, la servante de la théologie. On y met notamment en pratique la logique formelle d’Aristote et ses syllogismes, au travers de la disputatio, sorte de joute oratoire où diverses questions sont discutées à force d’arguments et de contre-arguments.
Devenue trop formaliste, la Scolastique est critiquée puis abandonnée au profit d’un retour du néoplatonisme. Francis Bacon (1561-1626) rédige le Novum organum, par opposition à l’Organon d’Aristote, où il propose un nouveau système de logique qu’il considère comme supérieur aux syllogismes du Stagirite. Descartes (1596-1650) estime qu’Aristote a avancé ses propres principes comme vrais et assurés, sans pour autant les avoir fondés en vérité auparavant, comme lui-même le propose avec sa célèbre méthode.
Aristote […] n’eût point d’autres principes que les siens, il a entièrement changé la façon de les débiter, et les a proposés comme vrais et assurés, quoiqu’il n’y ait aucune apparence qu’il les ait jamais estimés tels. Descartes, Les Principes de la philosophie, Lettre-préface [Texte en ligne].
Bibliographie
Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, PUF.
Diogène Laërce, Vies et Doctrines des Philosophes Illustres, Livre de Poche. Abréviation utilisée dans cet article pour désigner cet ouvrage : [DL], suivi du numéro du livre et de la numérotation des fragments, exemple [DL, VI, 20] pour le livre VI et le fragment 20.
André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF.
Dominique Folscheid, Les grandes philosophies, Que sais-je ?
Christian Godin, La Philosophie pour les nuls, First Éditions.
Laurent Jaffro, Monique Labrune, Gradus philosophique, GF Flammarion.
Louis-Marie Morfaux, Jean Lefranc, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand Colin.
Patrice Rosenberg, La Philosophie – Retenir l’essentiel, Nathan.
Voir aussi
Retrouvez dix œuvres philosophiques majeures, dans les tomes 1 et 2 des Fiches de lecture de Philosophie ! (Cliquer sur l’image pour découvrir l’ouvrage)
Platon, Apologie de Socrate
Aristote, Éthique à Nicomaque
Épicure, Lettre à Ménécée
Arrien, Le « Manuel » d’Épictète
Descartes, Discours de la méthode
Découvrez aussi mes autres ouvrages :
Bac Philo : Chapitre IV.2. La Justice et le Droit – Fiche n° 2. De la Justice, du Droit et des hommes.
Carnet de vocabulaire philosophique : Accidentel – (En) Acte / En puissance – Aporie – Cause – Dialectique – Entéléchie – Éristique – Essence / Existence – Éthique – Étonnement – Eudémonisme – Fin – Formel – Matériel – Morale – Ontologie – Quiddité – Scolastique – Syllogisme – Vertu – Vice.
Doctrines et vies des philosophes illustres : Socrate ; Descartes.
Fiches de lecture : Aristote, Éthique à Nicomaque.
Notes contemplatives de lecture : Aristote, Corpus.
Notes Éthiques : Une “Vie accomplie” – Aider à mourir quand la vie n’a plus de sens ?
Dsirmtcom, décembre 2021.
Philosophie, Mardi c’est philosophie, #MardiCestPhilosophie, Philosophes, Biographie, Doctrine, Aristote, Organon, Acte, Puissance, Cause, Matière, Forme, Substance, Dialectique, Rhétorique, Syllogisme, Poétique, Éthique, Politique, Morale, Cité, Loi, Constitution, Être, Ontologie, Dieu, Entéléchie, Perfection, Vertu, Quiddité, Scolastique, Eudémonisme, Étonnement, Essence, Existence, État, Physique, Métaphysique, Âme, Végétative, Nutritive, Sensitive, Intellective, Raison, Fin, Finalisme, Téléologie, Socrate, Platon, Mouvement, Opinion, Doxa, Prudence, Excellence, Temps, Catharsis, Plaisir, Bonheur, Souverain Bien, Nature, Stagirite, Péripatéticien, Descartes, Scolastique, Thomas d’Aquin, Francis Bacon
#Philosophie #MardiCestPhilosophie #Philosophes #Biographie #Doctrine #Aristote

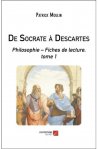

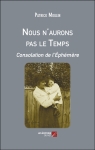


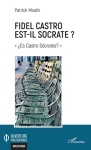
10 commentaires sur “Aristote (385-322 av. J.-C.)”